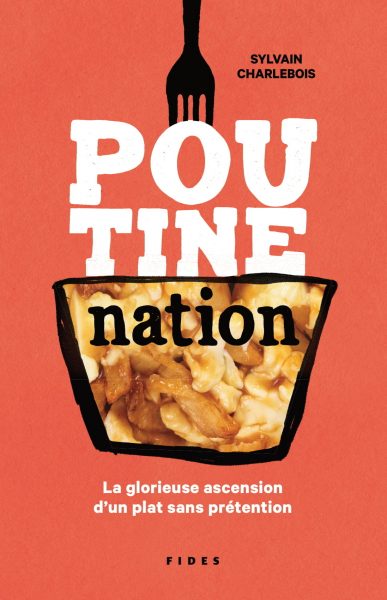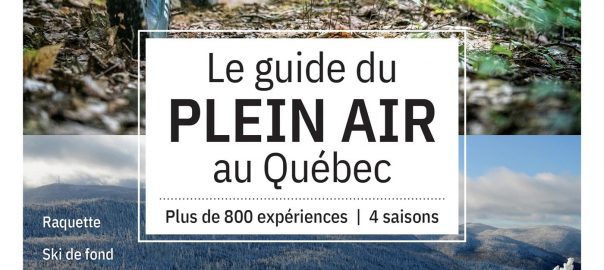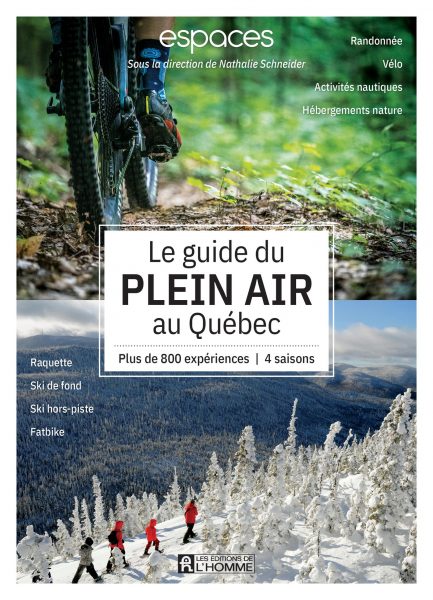L’académie Inverness, située dans la municipalité du même nom, dans la région du Centre-du-Québec, a de quoi plaire. Voici un tour d’horizon de son histoire et de ses particularités architecturales.
Un important établissement anglophone
Construite en 1889, l’académie Inverness est «un témoin privilégié du réseau scolaire anglophone établi dans les Cantons-de-l’Est au XIXe siècle».
En remontant le cours de l’histoire, on apprend que le territoire d’Inverness s’est surtout développé à partir de 1829, «grâce à l’arrivée d’un groupe d’Écossais en provenance de l’île d’Arran». Suivent des habitants en provenance de la Nouvelle-Angleterre et des îles britanniques. Ces derniers, qui accordaient beaucoup d’importance à l’éducation, ont instauré un réseau d’écoles sur le territoire. Ainsi, on retrouvait dans les Cantons-de-l’Est des écoles primaires, des académies et… une université! «La région se distingue par un taux de fréquentation scolaire plus élevé que le reste de l’actuel territoire du Québec au XIXe siècle», lit-on sur le site du Répertoire du patrimoine culturel du Québec.
L’académie Inverness, érigée sur un terrain acheté par la commission scolaire en 1887, compte trois salles de classe dans lesquelles viennent étudier des élèves de la première à la onzième année.
En 1966, la communauté anglophone n’étant plus assez nombreuse, l’établissement scolaire ferme ses portes. Après avoir abrité la bibliothèque municipale, l’académie est transformée en résidence privée. En 2006, son propriétaire entreprend d’importants travaux de restauration et l’ancienne école obtient sa place dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec l’année suivante.
Une architecture d’inspiration néo-italienne
Ce sont les architectes T. et J. A. McKenzie qui sont responsables des plans de l’académie Inverness. S’inspirant de l’architecture italienne de la Renaissance, alors très en vogue, ils proposent un édifice rectangulaire à deux étages, coiffé d’un toit en pavillon à larges avant-toits et surmonté d’un petit clocher.

On peut facilement imaginer les étudiants qui entraient dans cette école par la porte principale, sise à l’avant-corps central du bâtiment et munie d’un porche de bois.

Les nombreuses fenêtres, disposées de manière symétrique, permettent à un maximum de lumière naturelle d’éclairer l’intérieur.

Certaines «pièces» sont encore intactes, comme la scène, en vedette sur cette photo de l’actuelle salle familiale de la résidence.

Alors, quelle note sur dix donnez-vous à cette école convertie en maison?