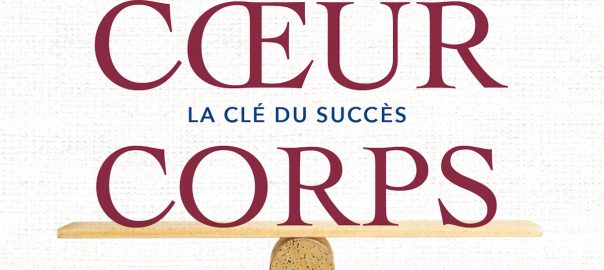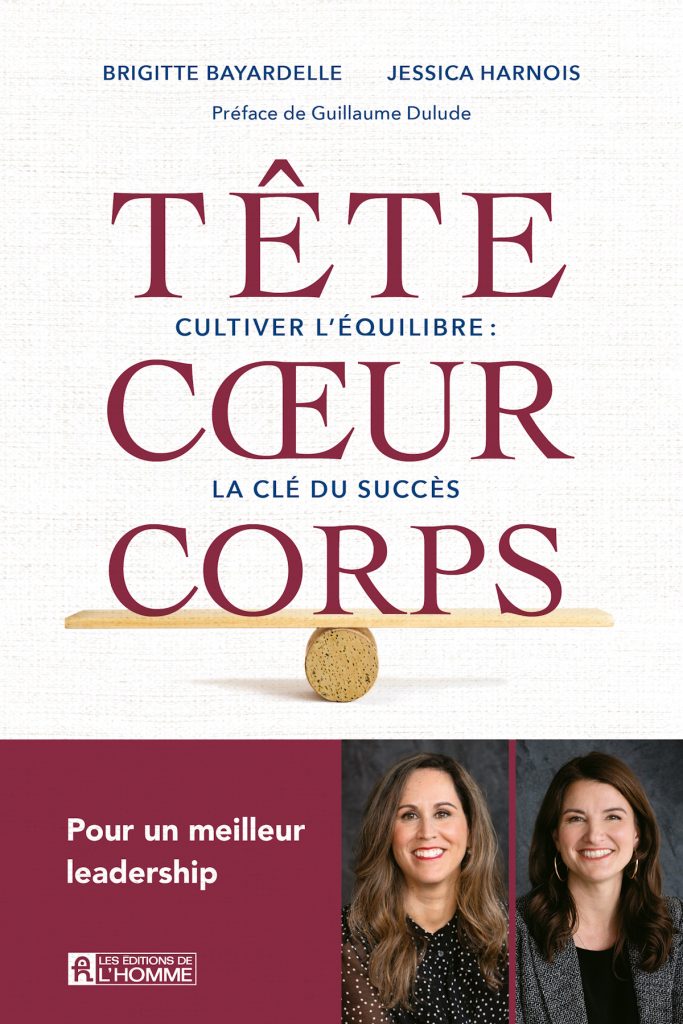Saviez-vous que La Malbaie a déjà été surnommée la Newport du Nord? Entre 1880 et 1930, des citadins fortunés y venaient de Québec, de Montréal, et même des États-Unis pour profiter de l’air du large et de la nature. La villa Les Hirondelles incarne encore cette époque révolue.
Sur le chemin des Falaises, les villas cossues aux noms poétiques, des Pivoines à La folie rose, se succèdent. Certaines s’inspirent du style Shingle, popularisé par l’école d’architecture de la Nouvelle-Angleterre, alors que d’autres empruntent les caractéristiques des maisons anglaises, normandes ou pittoresques.

Avec ses fenêtres à petits carreaux, celle des Hirondelles arbore une architecture traditionnelle québécoise. La taille de la résidence blanche aux volets turquoise impressionne, tout comme son imposante toiture.

Il s’agit de la dernière maison d’été construite selon les plans de l’architecte Jean-Charles Warren. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais cet autodidacte a marqué le paysage de Charlevoix. On lui doit plus d’une soixantaine de villas et de bâtiments publics, dont le Château Murray, l’ancienne auberge Donohue ou les villas Rayon d’or, Beaubien et Livingood.

La demeure Les Hirondelles est érigée en 1925-1926 pour le compte de l’ingénieur A. Sidney Dawes. Cet homme d’affaires montréalais est président de la compagnie Atlas Construction. Il a également été le premier président du Comité olympique canadien. La résidence reste dans la famille pendant 60 ans. Depuis 1988, elle appartient à un autre ingénieur, Paul Carrier.

L’intérieur est un cocon de bois. Les plafonds, les murs et les planchers sont recouverts de lattes blondes. Les chambres se parent aussi de lambris. Les multiples fenêtres, elles, donnent une vue sur le fleuve. On sent qu’on dormirait bien dans l’une des six jolies chambres de l’étage.

Si jamais l’envie vous prend de faire comme les vacanciers de la Newport du Nord, la propriété est présentement en vente. Tous les détails se retrouvent ici.