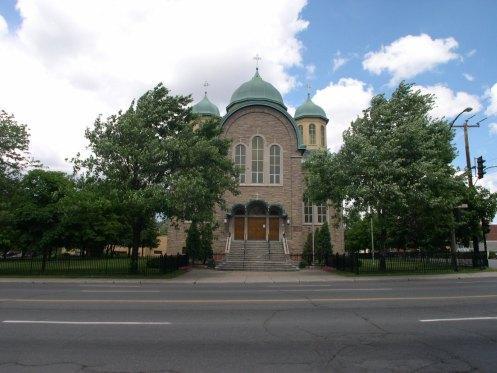Les applications mobiles qui permettent d’acheter, à moindre prix, des invendus d’épicerie, de restaurants ou d’autres commerces d’alimentation sont de plus en plus populaires au Québec. Découvrez-les!
Quand on sait qu’un aliment comestible sur trois est perdu au Canada, et que les consommateurs québécois jettent en moyenne 58% de leur nourriture à la poubelle, contribuer à la réduction du gaspillage alimentaire est devenu une nécessité à la fois environnementale et citoyenne.
Ce changement de culture est aussi de plus en plus motivé par des raisons économiques, alors que le prix de nos aliments s’envole et que les ménages cherchent des solutions pour économiser sur leur facture d’épicerie, qui devrait grimper de 966$ au cours de l’année 2022.
Alors, quels sont les moyens les plus simples pour marier ses valeurs personnelles et son porte-monnaie? Acheter moins, cuisiner plus et mieux conserver ses aliments, c’est sûr. Mais aussi utiliser des applications mobiles qui réduisent le gaspillage à la source, tout en proposant aux consommateurs d’acheter des produits frais ou transformés à une fraction du prix original.
Les applications des épiceries
Encore peu utilisées avant la pandémie de COVID-19, les applications développées par les grandes bannières épicières pour écouler des surplus dont la date de péremption approche – et qui sont souvent comestibles bien après – sont devenues incontournables pour de nombreux consommateurs.
Le groupe Loblaws (épiceries du même nom, ainsi que les bannières Maxi et Provigo) s’est doté du moteur Flashfood, tandis que, de leur côté, les bannières Métro et IGA affichent leurs surplus à petit prix sur FoodHero, une application développée par une start-up montréalaise. Les deux solutions numériques, qui offrent des rabais pouvant aller de 20% à 60% sur les produits proposés, ont à peu près le même fonctionnement, c’est-à-dire une sélection et un paiement en ligne, suivis d’une récupération de la commande en épicerie.

De nouvelles applications spécialisées
De nouveaux acteurs se sont récemment ajoutés à Flashfood et FoodHero pour élargir l’offre des épiceries à d’autres types de commerces alimentaires, comme les boulangeries, les cafés, les restaurants, les traiteurs et les centres de distribution. On peut par exemple penser à l’application Sauvegarde, implantée à Montréal (200 commerces à ce jour) en septembre 2021, et depuis moins d’un mois dans les villes de Québec, Gatineau et Sherbrooke.

Saluons aussi l’arrivée en 2021, à Montréal et à Québec, de l’application anti-gaspillage numéro un au monde Too Good To Go, présente dans 17 pays et à l’origine du sauvetage de 250 000 repas chaque jour. Là encore, le principe est de permettre aux marchands d’écouler leurs surplus et aux consommateurs de faire des économies. Et pourquoi pas, de faire des découvertes, puisque le contenu d’un panier de Too Good To Go et de Sauvegarde est toujours une surprise.