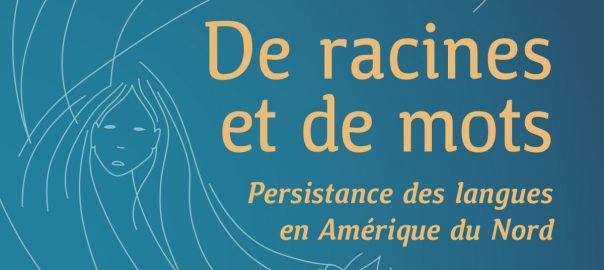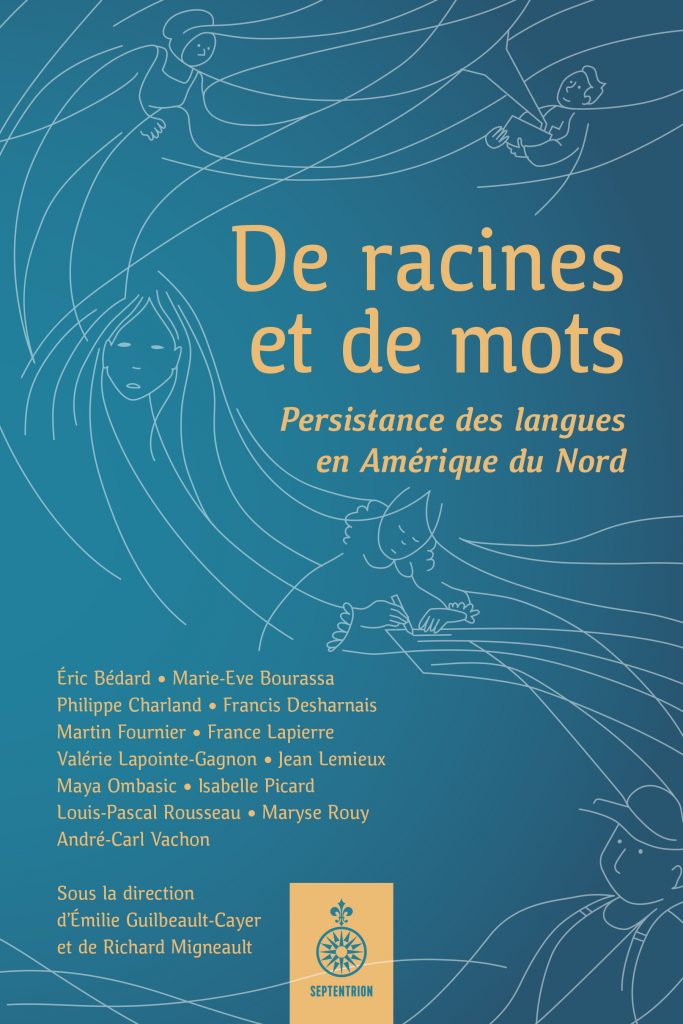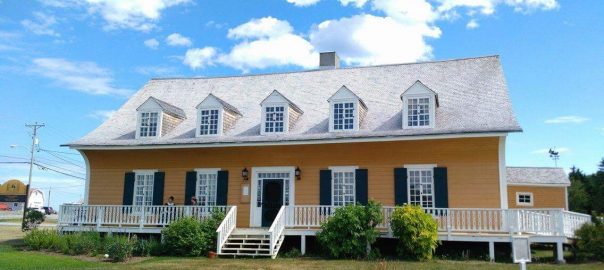Pour le recueil De racines et de mots, Émilie Guilbeault-Cayer et Richard Migneault, deux passionnés de littérature et d’histoire, ont invité des auteurs d’Acadie, d’Alberta, du Yukon et du Québec à raconter, par l’entremise de personnages et de leur petite histoire, l’histoire de la lutte et de la survie de leur langue.
Québécois, Acadiens et Autochtones partagent une même réalité en terre d’Amérique du Nord, celle de la survie de leur langue. Une lutte qui s’inscrit dans leur histoire, dans leur culture. Dans les gestes quotidiens, dans les grandes mouvances, dans les luttes sociales, politiques, des hommes et des femmes ont lutté pour que leur identité survive. Et ils ont réussi et transmis à leurs descendants l’amour de leur langue et les devoirs de mémoire. Une lutte que des immigrants venus en terre d’Amérique ont dû mener aussi.
Bien sûr, on peut raconter ces histoires, ces Histoires, de mille façons. Dans des essais complexes et documentés, comme le feraient des historiens, dans des romans, comme l’ont fait de nombreux auteurs. Mais pourrait-on rallier les émotions de la littérature et la rigueur de l’histoire en un seul ouvrage?
C’est le défi que deux passionnés de littérature et d’histoire, Émilie Guilbeault-Cayer et Richard Migneault, se sont lancé. Autour du thème «Persistance des langues en Amérique du Nord», ils ont invité 13 auteurs d’Acadie, d’Alberta, du Yukon et du Québec à raconter, par l’entremise de personnages et de leur petite histoire, l’histoire de la lutte et de la survie de leur langue tantôt française, tantôt wendate ou abénaquise, acadienne, ladino ou bosniaque.
L’idée est originale et inclusive à n’en pas douter. L’ouvrage offre 13 textes aux tons et aux styles très variés. Certains plus romanesques, comme celui de France Lapierre, un de mes coups de cœur, En hommage à Marie Oudin, une femme ayant véritablement vécu de 1639 à 1721 et venue s’établir en Nouvelle-France pour échapper à sa condition et dont la passion émouvante pour les lettres et la langue française s’est perpétuée à travers sa descendance. Ici, l’expression «langue maternelle» prend tout son sens.
«Marie a tellement vanté la beauté de la langue française et insisté sur la nécessité de bien parler et d’écrire avec justesse que ses filles Ursule et Marguerite choisissent de consacrer leur vie à l’éducation. Elles prononcent leurs vœux perpétuels chez les sœurs de la congrégation Notre-Dame à Montréal en 1680. Marie voit avec chagrin s’éloigner ses aînées. Toutefois, elle se console, car dans ce pays qui le leur, elles transmettront la fierté de parler français à des centaines d’enfants. Mère Sainte-Ursule sera même une des premières enseignantes à parcourir le pays en canot pour rejoindre les colons éloignés.»
D’autres, plus didactiques, comme celui d’André-Carl Vachon, Fuir pour vivre en français, qui raconte la tortueuse et difficile survie du peuple acadien sous la domination britannique en Nouvelle-Écosse où, malgré la déportation et les perpétuelles embûches légales et économiques, subsiste encore aujourd’hui une communauté acadienne francophone. On y trouve aussi de petits bijoux, comme ce très beau texte d’Isabelle Picard, Entre deux torrents où, en trois scènes, à travers les yeux d’hommes et de femmes de sa communauté, on revisite la disparition, la préservation et la renaissance de la langue wendate. La première scène se passe en 1835, alors que les droits de la communauté se réduisent comme peau de chagrin et que Thomas se lève et affirme son refus de disparaître.
«À partir de maintenant je serai Wawandaronhe, comme on m’a nommé. Je parlerai la langue de mes ancêtres, je chasserai et couperai le bois où je le voudrai. J’enseignerai à mes petits-enfants les secrets de la terre, ceux qu’ont laissés nos ancêtres de l’est sur ces terres depuis des lunes. Tant pis pour ceux qui ne comprennent pas. Je parlerai ma langue de guerriers. C’est ça notre guerre. Et c’est maintenant.»
Puis, en 1911, à la deuxième scène, un jeune scientifique vient documenter, en les enregistrant au gramophone, les contes et chants des anciens en langue wendate, que presque plus personne ne parle au village. Et finalement, en 2011, alors que la langue est à nouveau enseignée, bien qu’encore timidement, Sébastien, au pied d’un immense pin blanc au pays du Wendake, se fait la promesse que les premiers mots que ses enfants apprendront seront en wendat.
Chaque histoire est suivie de deux pages consacrées à l’auteur. Une courte biographie et une lecture qu’il recommande, un moment historique qui l’a frappé, un personnage historique qu’il admire et sa bibliographie. On reconnaît là la trace des premières amours des deux auteurs, qui ont œuvré comme enseignants, avec une volonté claire d’informer et d’éduquer. Mais il y a surtout dans cet ouvrage une volonté de faire devoir de mémoire et de raconter de l’intérieur comment des hommes et des femmes ont vécu intimement les menaces contre leur langue, leur culture, les luttes pour la conserver et l’espoir de la voir survivre.
Comme tout recueil, ça se lit facilement, par morceaux, c’est un livre à offrir aux amoureux d’histoire ou de la langue, ou simplement pour se rappeler que rien n’est acquis et que notre langue est un trésor à protéger et à transmettre.
De racines et de mots, sous la direction d’Émilie Guilbeault-Cayer et Richard Migneault, éditions du Septentrion, 2021, 248 pages. 24,95$ (disponible en format PDF).
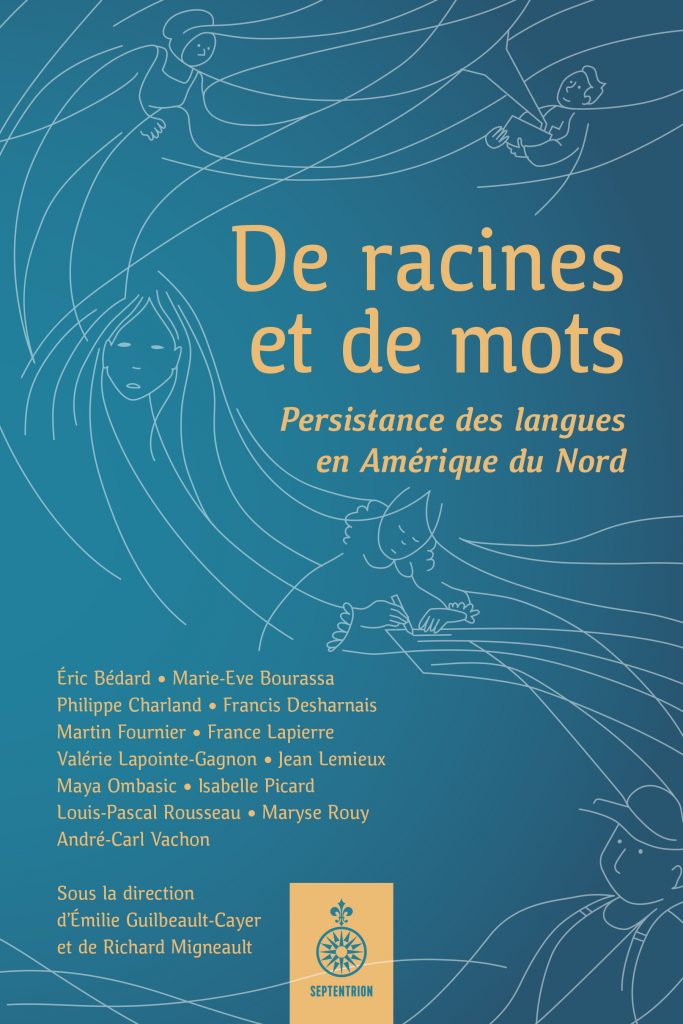
Émilie Guilbeault-Cayer est titulaire d’une maîtrise en histoire de l’Université Laval et d’un diplôme en édition de l’Université de Sherbrooke. Elle œuvre dans le domaine de l’histoire depuis 15 ans et a collaboré à de nombreux projets en histoire autochtone, institutionnelle et urbaine. Elle a publié Les sœurs de la Charité de Saint-Louis au Québec de 1902 à 2019 (éditions du Septentrion, 2018).
Richard Migneault a œuvré dans l’enseignement tout au long de sa carrière. Lecteur passionné, amoureux du polar et de la nouvelle, il tient le blogue Polar noir et blanc, signe aussi des chroniques sur le polar sur Avenues.ca. Il a dirigé trois recueils de nouvelles (Crimes à la librairie, Crimes à la bibliothèque et Crimes au musée [Druide]) et deux titres (Mystères à l’école et Les nouveaux mystères à l’école) à l’intention des 12-14 ans pour les inciter à lire.