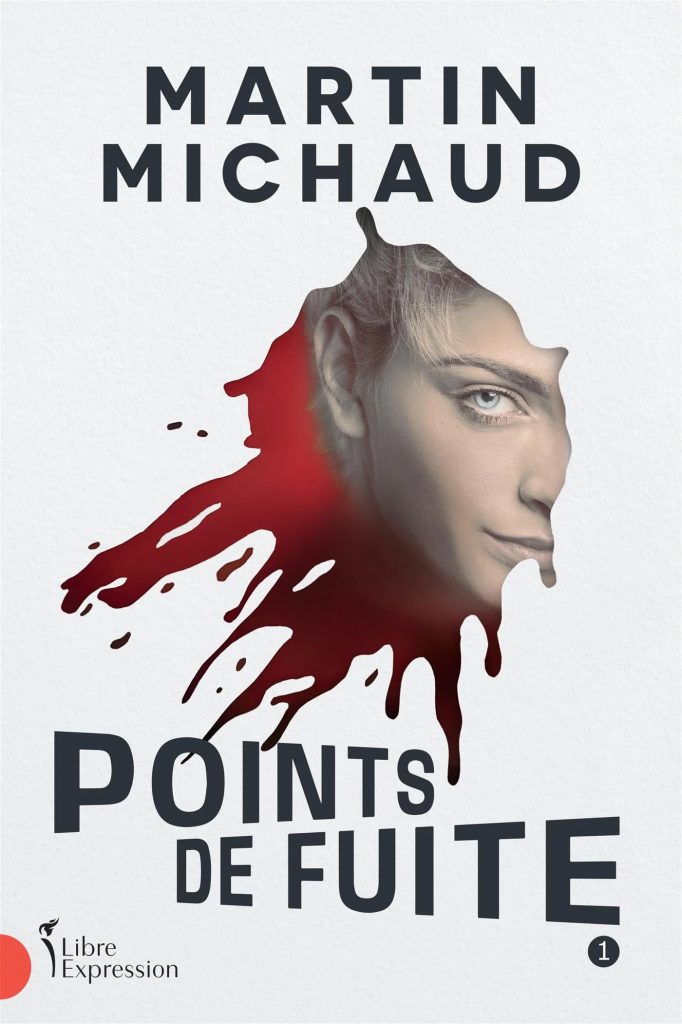Cette année encore, les marchés de Noël vous raviront avec leurs décors enchanteurs et leurs talentueux artisans. Voici le répertoire 2023 des marchés de Noël du Québec.
Les marchés de Noël permettent de dénicher des trésors et des œuvres originales d'artisans québécois. Vous trouverez dans ce répertoire les dates et les sites Internet des différents marchés et événements pour l'année 2023. Surveillez toujours leurs calendriers d’activités, car plusieurs animations spéciales peuvent s’ajouter.
Quelques conseils avant de visiter les marchés de Noël de la province
- Portez des vêtements chauds, car vous passerez sûrement quelques heures à l’extérieur.
- Faites un tour complet du marché avant d’effectuer vos achats. Plusieurs marchands offrent des produits similaires et vous pourrez ainsi les comparer avant de prendre une décision.
- Il fait plus chaud en journée, certes, et plusieurs activités ont lieu pendant le week-end, mais lorsque cela est possible, visitez les marchés le soir pour admirer les jeux de lumière festifs.
- Apportez de l’argent comptant, car certains producteurs et marchands n’acceptent pas les cartes.
- Buvez un verre de vin chaud à notre santé, d’accord?
Abitibi-Témiscamingue
- Le marché du père Noël en folie, Amos, 11 novembre
- Noël au terroir, Centre communautaire de La Motte, 18 novembre
- Marché de Noël de Lorrainville, 18 et 19 novembre
- Marché de Noël d'Abitibi-Ouest, 25 novembre
- Marché de Noël à la campagne, 25 novembre
- Marché public de la Vallée-de-l'Or, édition des fêtes, 26 novembre
- Marché de Noël de Malartic, 8 décembre
- Marché de Noël d’Amos, 2 décembre
- Marché de Noël de La Corne, 3 décembre
- Marché de Noël de Rouyn-Noranda, 2 et 3 décembre

Bas-Saint-Laurent
- Marché de Noël de La Pocatière, 25-26 novembre
Cantons-de-l’Est
- Noël au Marché de la Gare de Sherbrooke, les fins de semaine entre le 18 novembre et le 17 décembre
- Marché de Noël des Collines de Sainte Catherine de Hatley, 18-19 novembre
- Marché de Noël à la Poudrière, 18-19 novembre
- Marché de Noël de Magog, 19 novembre
- Salon des artisans de Granby, 24, 25 et 26 novembre
- Marché de Noël de Statford, 25 novembre
- Marché de Noël de Way's Millls, 25-26 novembre
- Marché de Noël de Sutton, 25-26 novembre et 2-3 décembre
- Les rendez-vous agroalimentaires des Fêtes, 26 novembre (Roxton Pond), 27 novembre (Waterloo), 2 au 4 décembre (Granby), 11 décembre (Saint-Joachim-de-Shefford)
- Marché de Noël de Cowansville, 1-2-3 décembre
- Marché de Noël des Bedford Lofts, 1-2-3 décembre
- Salon de créations du P'tit bonheur de Saint-Camille, 2 décembre
- Marché de Noël du Centre Jardin Dansereau, Stanstead-Est, 2-3 décembre
- Festif Bromont, 2-3 décembre
- Folie de minuit Lac-Brome, 9 décembre
- Marché de Noël de Farnham, 9 décembre
- Fééries de Noël d'Eastman, 9 décembre
- Marché de Noël au Musée Beaulne, 9-10 décembre
- Marché de Noël de Frelighsburg, 16-17 décembre
- Le Marché de Noël des Pas Pressés à Dunham, 16-17 décembre

Centre-du-Québec
- Marché de Noël du cercle des fermières de Gentilly, 18-19 novembre
- Marché de Noël des artisans, 26 novembre
- Village québécois d'antan, toutes les fins de semaine de décembre
- Meunier tu fêtes à Bécancour, les fins de semaine du 1er, 8 et 15 décembre
- Marché de Noël Érable Arthabaska, 25-26 novembre et 2-3 décembre
- Marché Godefroy de Noël, 2-3, 9-10 et 16-17 décembre
- Marché de Noël - Rendez-vous gourmand Victoriaville, 9-10 décembre
Charlevoix
- Marché de Noël de Baie-Saint-Paul, 1 au 10 décembre

Chaudière-Appalaches
- Marché de Noël de Sainte-Justine, 25-26 novembre
- Les Trouvailles de Noël de Lévis, 25-26 novembre
- Marché de Noël de Beauceville, 25-26 novembre
- Le Grand Marché de Beauce-Sartigan, Coopérative de Solidarité, 1,2,3 et 9-10 décembre
- Le Noël magique de Saint-Flavien, 8-10 décembre
Gaspésie
- Salon des artisans de Maria, 24-25-26 novembre
- Marché de Noël à Sainte-Flavie, 25 novembre
- Marché de Noël de Noël en Gaspésie à New Richmond, 2-3 décembre
Lanaudière
- Marché de Noël de Joliette, 24 novembre au 23 décembre
- Marché de Noël de l’Assomption, 24 novembre au 23 décembre
- Marchés de Noël Joliette-Lanaudière, 26 novembre au 23 décembre
- Marché de Noël de Terrebonne, 1er au 17 décembre

Laurentides
- Marché de Noël de Prévost, 18-19 novembre
- Marché de Noël de Nominingue, 18-19 au 25-26 novembre
- Marché de Noël d'Oka, 24 au 26 novembre
- Salon des métiers d’art de Blainville, 24 au 26 novembre
- Marché des Fêtes de Mont-Tremblant, 24 au 26 novembre
- Foire de Noël saveurs et culture d’Argenteuil, 8 au 10 décembre
- Marché de Noël de Mirabel, les fins de semaines du 25 novembre au 17 décembre
- Marché de Noël de Sainte-Agathe-des-Monts, 2-3 décembre
- Salon des artisans de Val-David, 2-3 décembre
- Le Village de Noël de Sainte-Thérèse, 30 novembre au 17 décembre
- Marché de Noël du Vieux-Saint-Eustache, 1-2-3 et 8-9-10 décembre
- Marché de Noël de Sainte-Adèle, 2-3 décembre
- Marcher Noël à Saint-Jérôme, 1-2-3 décembre
- Féria d'hiver et marché de Noël de Val-Morin, 9-10 décembre
- Marché de Noël de Rosemère - Etsy Laurentides, 8-9-10 décembre
- Marché de Noël de Val-David, 9 et 16 décembre

Laval
- Marché de Noël de Laval, 1 au 3 et 8 au 10 décembre
- La Foire Enchantée de Noël, 2 décembre

Mauricie
- Salon de Noël des artisans de Saint-Alexis-des-Monts, 11-12 novembre
- Marché des Fêtes Etsy Trois-Rivières et La Meraki, 11-12 novembre
- La Foire Mékinoise, 11-12 novembre
- La grande kermesse de Noël à La Tuque, 11-12 novembre
- Salon des artisans de Saint-Sévère, 12 novembre
- Salon POP des Artisans de Saint-Étienne-des-Grès, 18 novembre
- Marché de Noël de Maskinongé, 18-19 novembre
- Marché de Noël de Sainte-Ursule, 20 novembre
- Salon des artisans de Noël Montcarmelois, 25-26 novembre
- Marché de Noël de Saint-Tite, 1-2-3 décembre
- Marché des Fêtes Shawinigan, 2-3 décembre
- Marché de Noël de Trois-Rivières, 9-10 décembre
- Marché de Noël de Saint-Mathieu-de-Beloeil, 9-10 décembre
- Marché de Noël du Duché de Bicolline, 1-2-3 décembre
- Salon de Noël de la MRC de Maskinongé, 9-10 décembre
- Marché de Noël de Trois-Rivières au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, 9-10 décembre
- Marché de Noël de l'Érablière Ladouceur, 23 décembre
Montérégie
- Marché de Noël de Brossard, 17-18-19 novembre
- Petit marché de Noël Saint-Marc-sur-Richelieu, 18-19 novembre
- Foire de Noël à Dundee, 24-25 novembre
- Marché de Noël et des traditions de Longueuil, 3-10-17 décembre
- Marché de Noël – marché des saveurs de l’Île Perrot, 25-26 novembre
- Marché de Noël de Coteau-du-Lac, 25-26 novembre
- Marché de Noël de La Prairie, 1-2 -3 décembre
- Marché de Noël victorien de Saint-Constant, 1-2-3 décembre
- Village de Noël de Sainte-Julie, 2 décembre
- Marché de Noël de Sorel-Tracy, 2 au 17 décembre

Montréal
- Marché des Trouvailles, 4-5 novembre
- Le Grand Marché de Noël, 25 novembre au 30 décembre
- Le village de Noël de Montréal-Est, 25-26 novembre
- Marché des Fêtes à la japonaise, 25-26 novembre
- SOUK, 29 novembre au 3 décembre
- Le Village de Noël de Montréal, 30 novembre au 24 décembre
- Marché des Artisans Récupérateurs, 1 au 3 décembre
- Marché de Noël de Pointe-aux-Trembles, 2-3 décembre
- Marché de Noël de Jean-Talon, 2 au 24 décembre
- Puces POP, 8-9-10 et 15-16-17 décembre
- Marché de Noël de l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud, 9 décembre
- Marché des Fêtes - Collectif Créatif Montréal, 17-18-19 décembre (Verdun), 25-26 novembre et 2-3 décembre (Locoshop Angus)
- Salon des métiers d’art du Québec, 7 au 17 décembre

Outaouais
- Foire marchande de Gatineau, fins de semaine du 28 octobre au 12 novembre
- Marché Pontiac, Noël dans la Vallée, 4 novembre
- Salon de Noël de Plaisance, 4-5 novembre
- Marché de Noël de la Guilde des tisserandes de Gatineau, 11 novembre
- Salon de Noël de Papineauville, 11-12 novembre
- Marché de Noël Ninja Gatineau, 11-12, 18-19 novembre
- Marché de Noël au Domaine de l'Ange Gardien, 17-18-19 novembre
- Boutique de Noël de Cantley, 17-18-19 novembre
- La Foire de Noël au Presbytère de Blue Sea, 18 novembre
- Marché de Noël Sous les flocons de Ripon, 18-19 novembre
- Marché de Noël du Vallon, 19 novembre
- Le Marché de Noël du Musée, 23 au 26 novembre
- Marché de Noël Croquez l'Outaouais, 24 novembre au 24 décembre
- Noël dans le Vieux-Aylmer, 24-25-26 novembre et 1-2-3 décembre
- Marché de Noël d'antan de la Maison Culturelle George Bryson, 25 novembre
- Le marché du temps des fêtes Larose, 25 novembre
- Marché de Noël école aux Quatre-Vents, 25 novembre
- Marché de Noël de Montebello, 1-2-3 et 8-9-10 décembre
- Marché expo Noël autour du monde, 2 décembre
- Marché de Noël de Bowman, 2 décembre
- Marché de Noël au profit du Centre alimentaire Aylmer, 2-3 décembre
- Marché de Noël de Val-des-Monts, 2-3 décembre
- Marché de Noël ALÉO, 2-3 et 9-10 décembre
- Marché de Noël de La Fée des Bois, 2-3 et 16-17 décembre
- Pop up de Noël à la Place du Centre, 5-6-7-12-13-14 décembre
- Foire de Noël à Wakefield, 9 décembre
- Le marché des souvenirs, 9 décembre
- Marché de Noël de Gatineau, 9-10 décembre

Québec
- Marché de Noël de Limoilou, 11-12 novembre
- Marché de Noël à l'École New Liverpool, 18-19 novembre
- Noël des artisans de Pont-Rouge, 18-19 novembre
- Marché de Noël allemand, 23 novembre au 23 décembre
- Le Grand Marché de Noël, 24 novembre au 24 décembre
- Marché du Noël d'antan à Cap-Santé, 24 au 26 novembre
- Marché de Noël de l'île d'Orléans, 1-2-3 décembre
- Salon des Artisans et des Métiers d’Art de Québec, 1 au 10 décembre
- Marché de Noël Stoneham-et-Tewkesbury, 1-2-3 et 8-9-10 décembre

Saguenay-Lac-Saint-Jean
- Marché de Noël agroalimentaire, 23 au 26 novembre
- Marché de Noël d'Albanel, 24-25-26 novembre
- Marché de Noël européen de Saguenay, 30 novembre au 3 décembre et 7 au 10 décembre
- Marché extérieur de Noël d'Alma, 8 au 10 décembre
- Marché de Noël de Saint-Gédéon, 17 décembre

Bonne visite des marchés de Noël de la province!