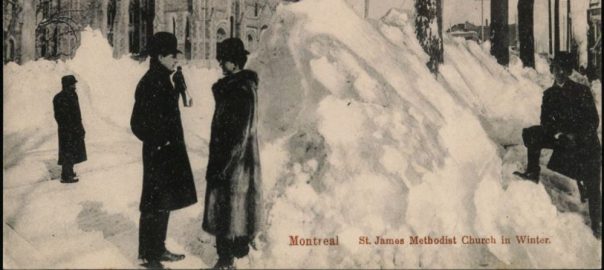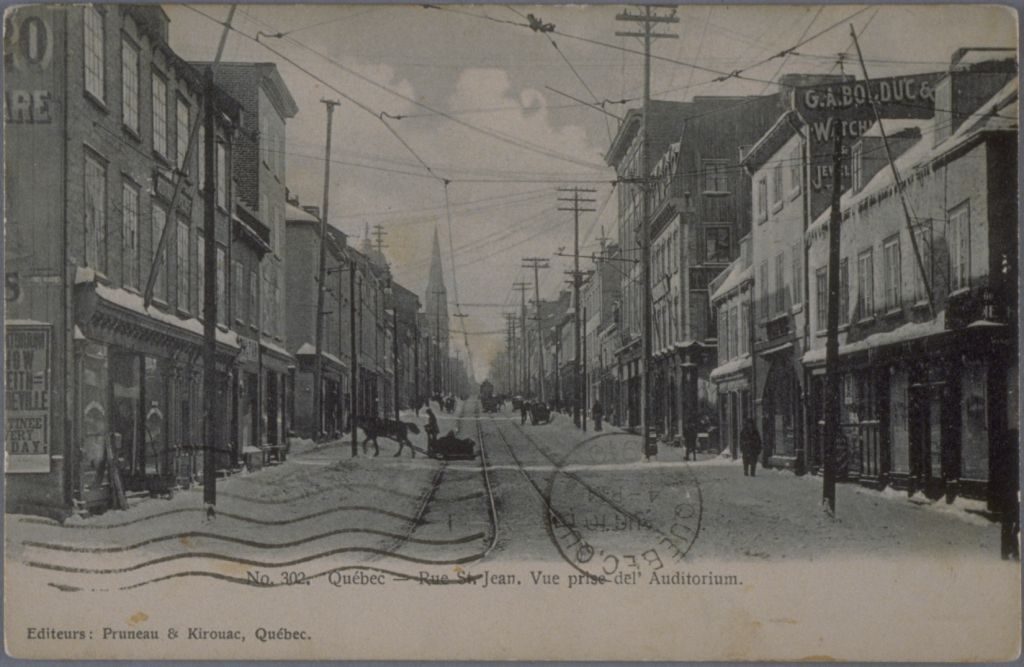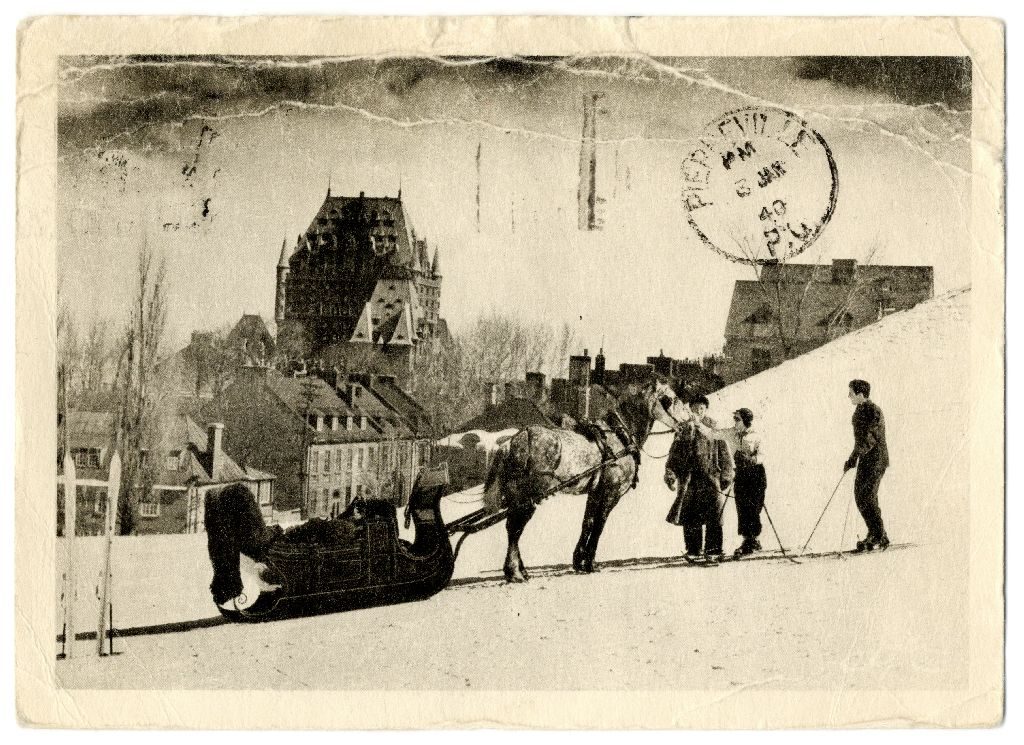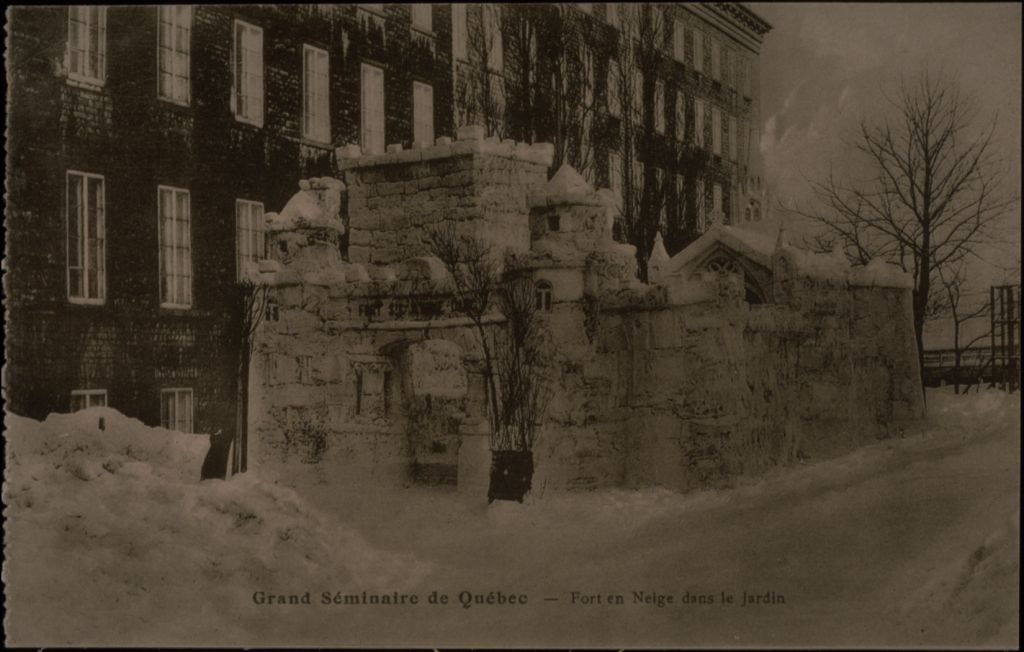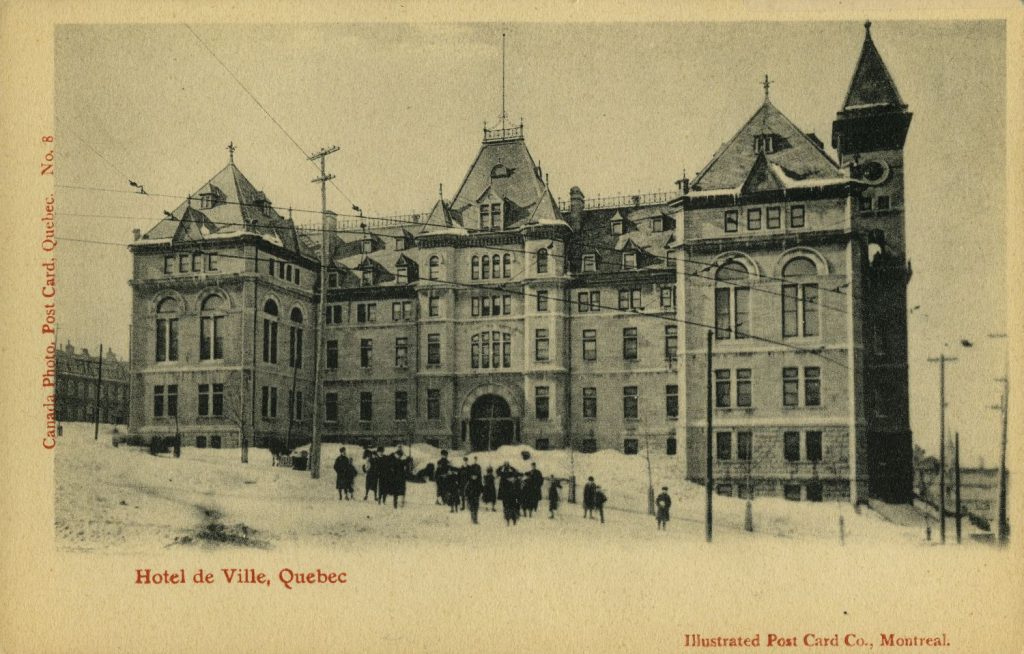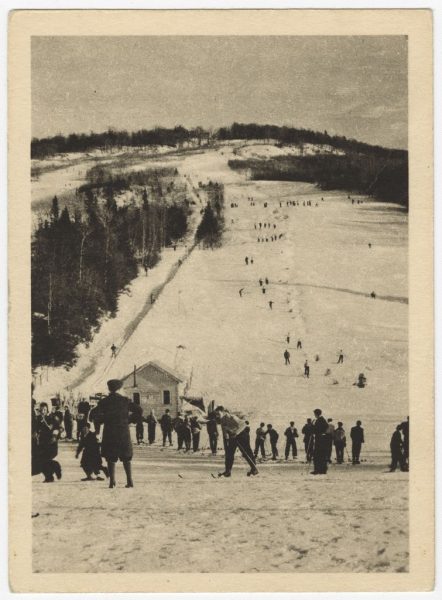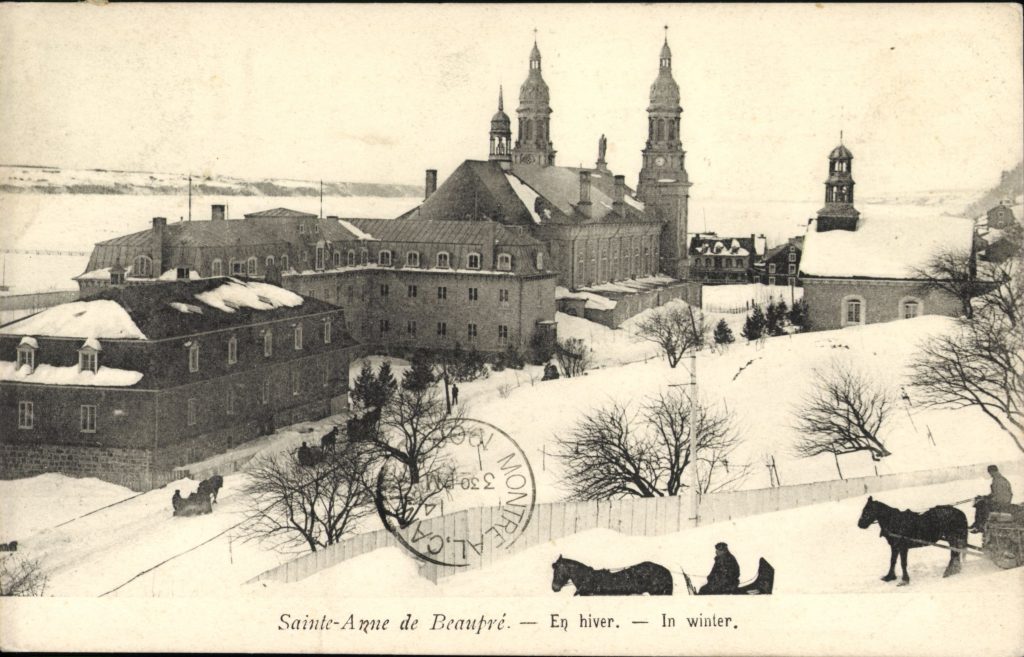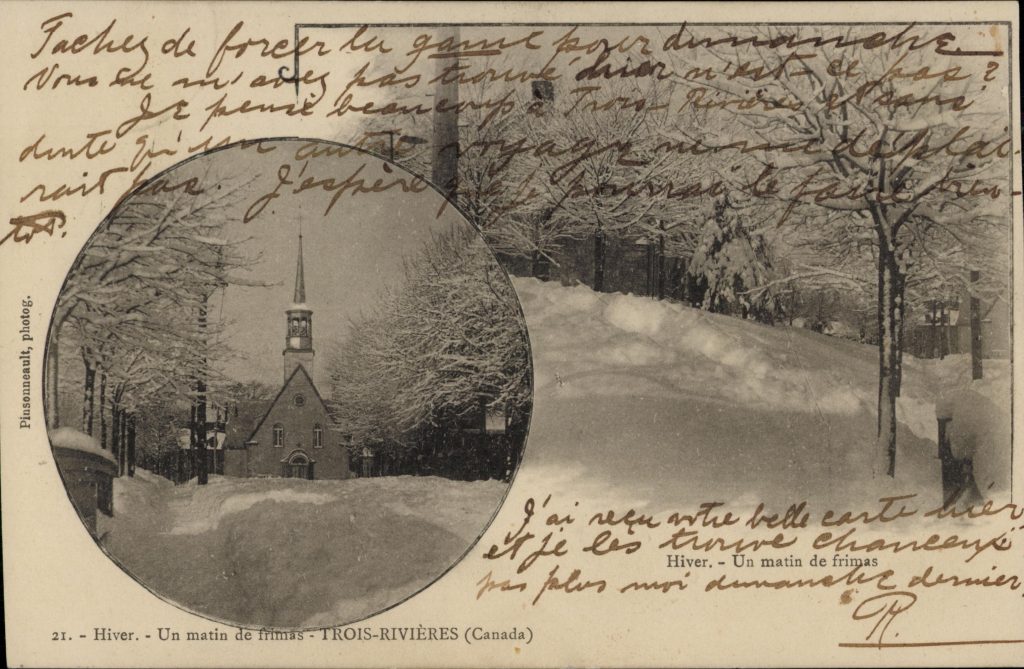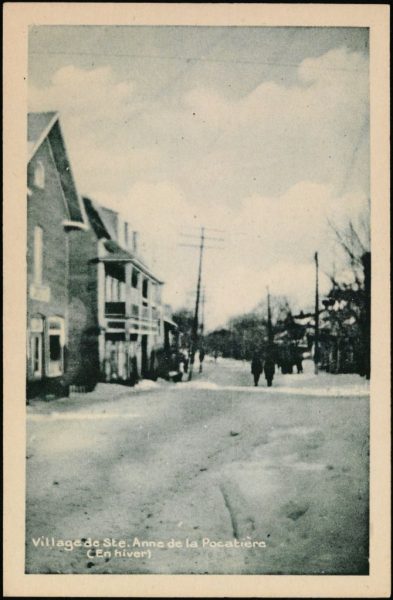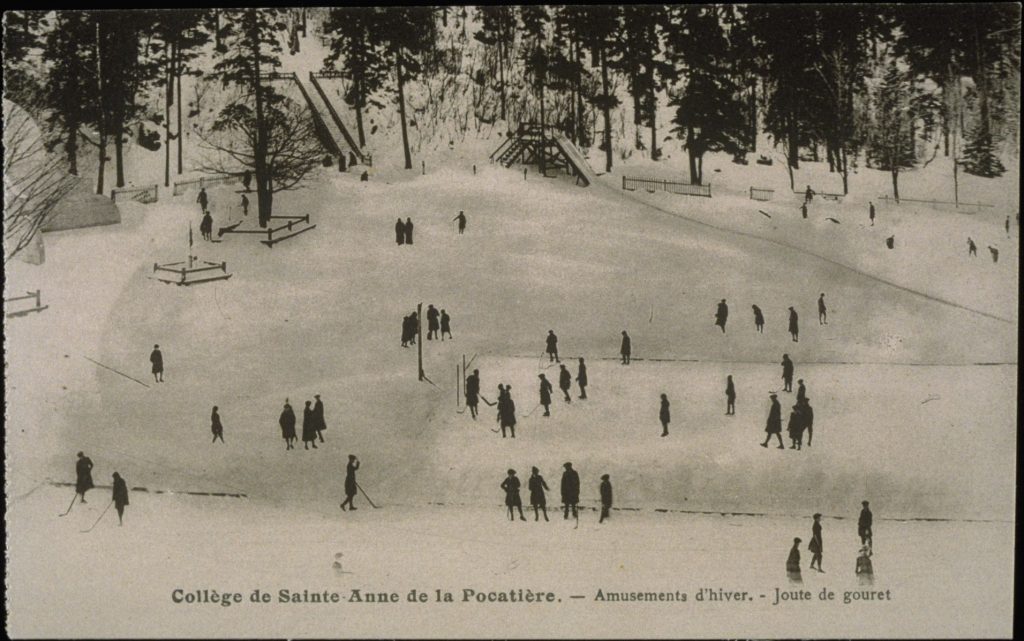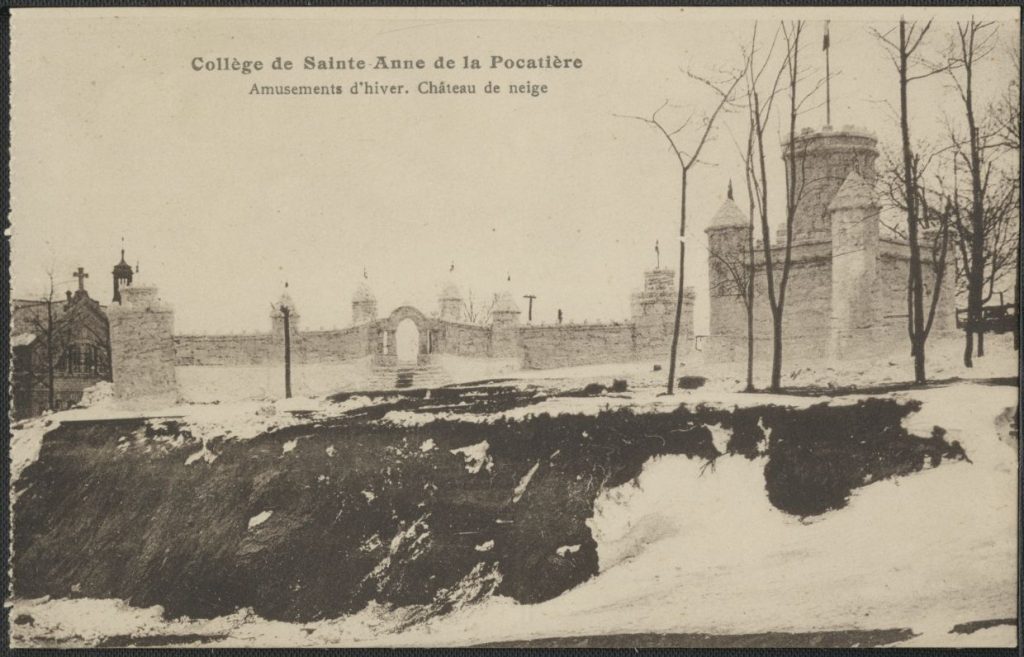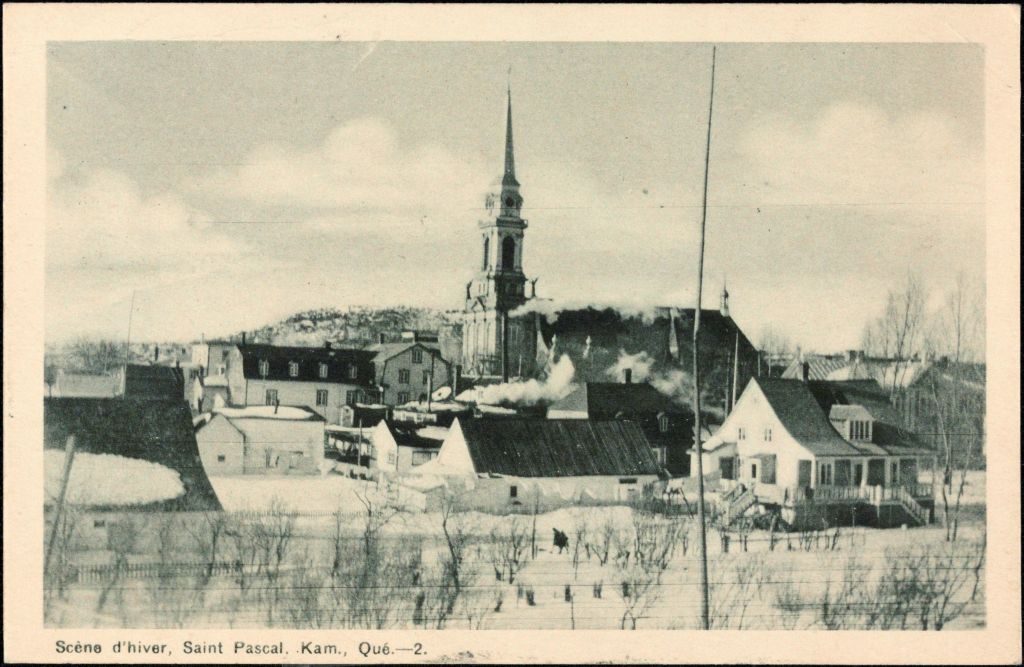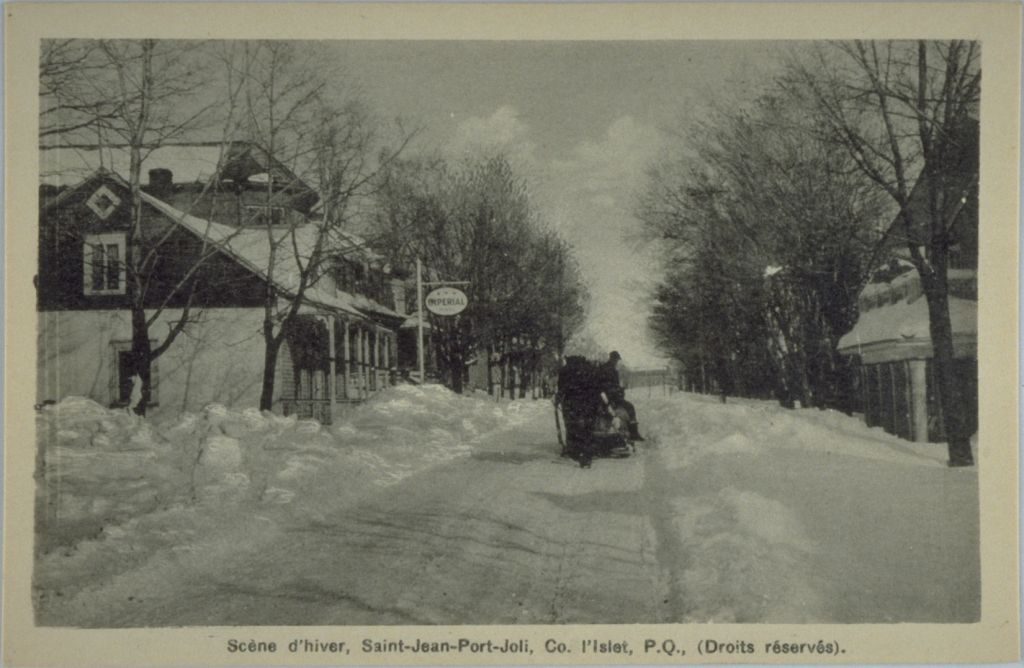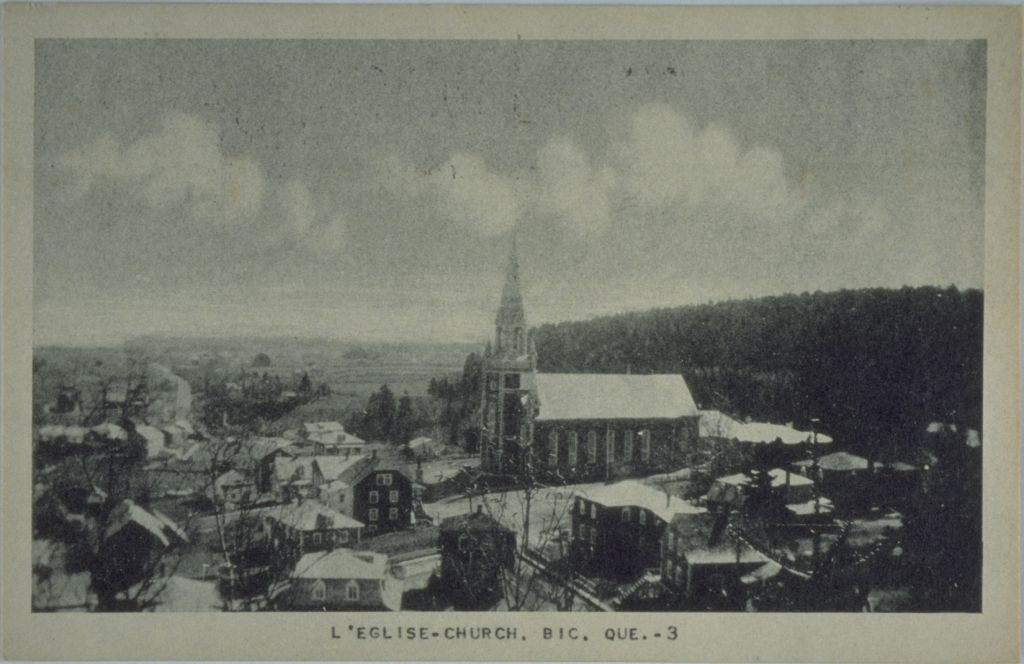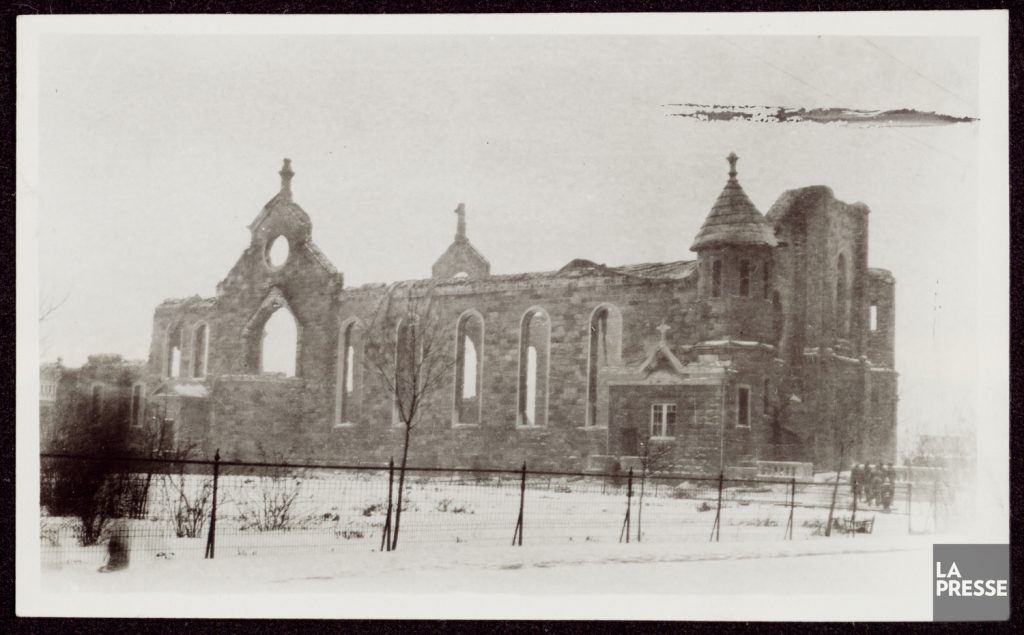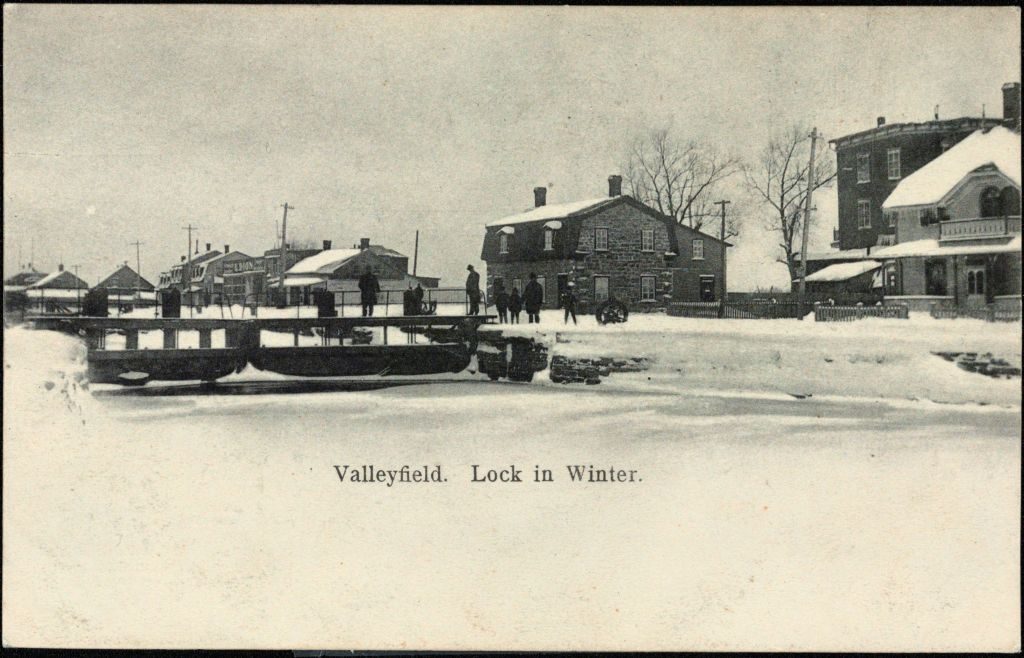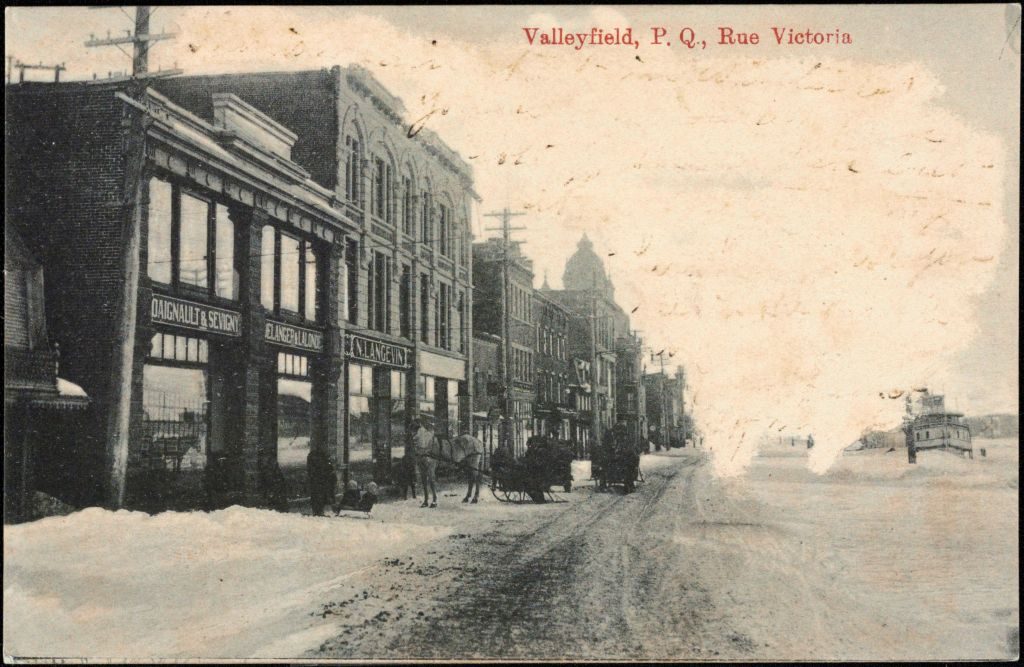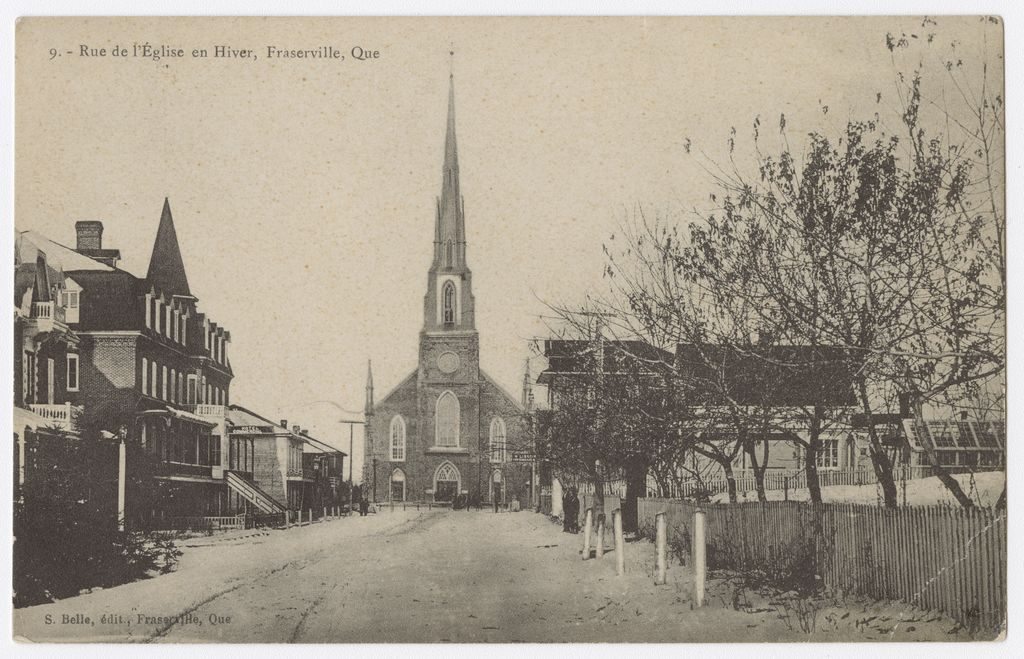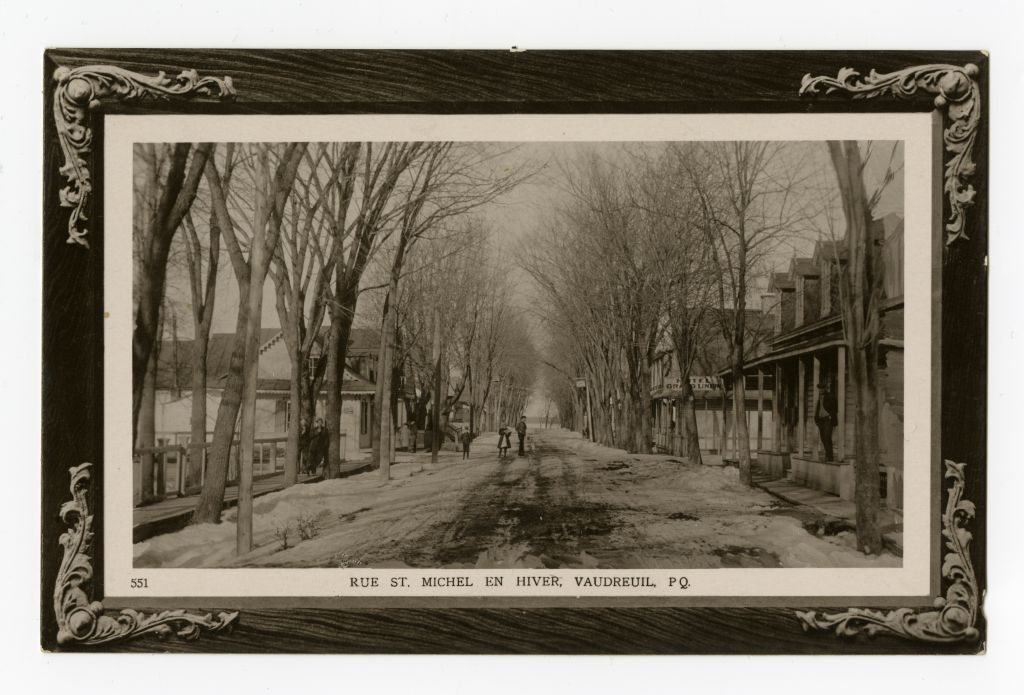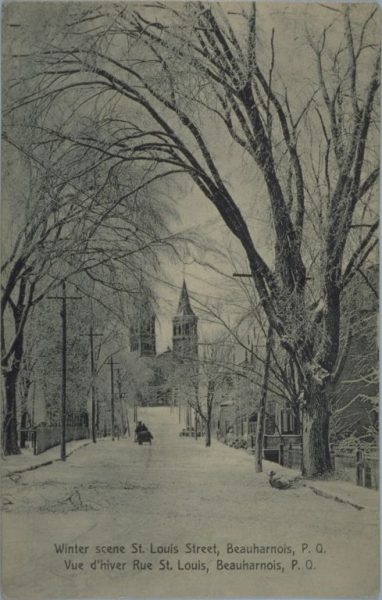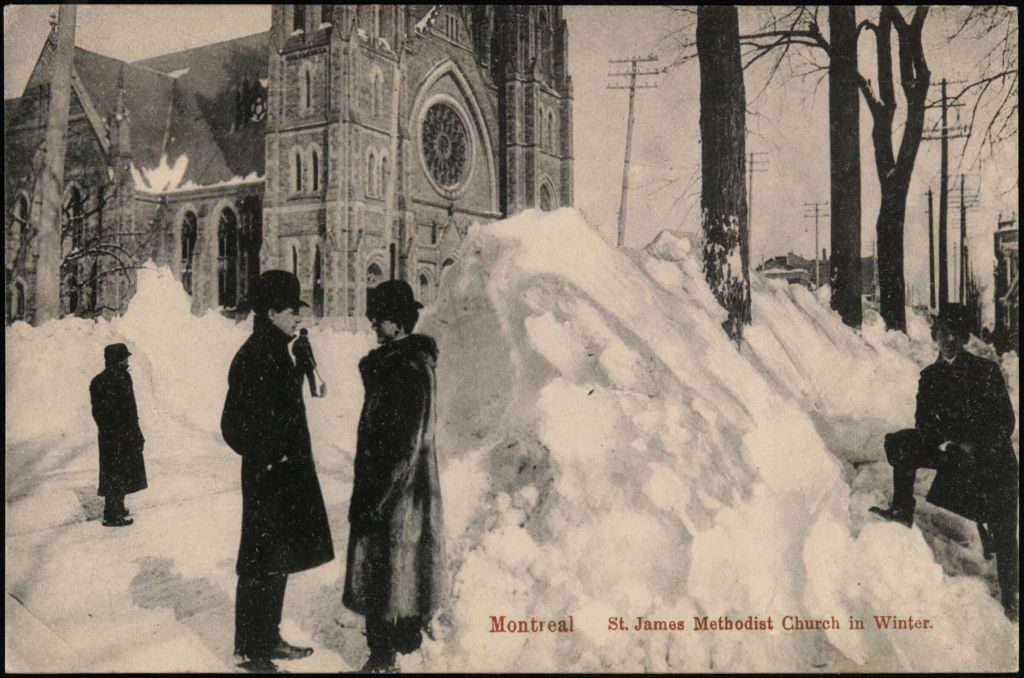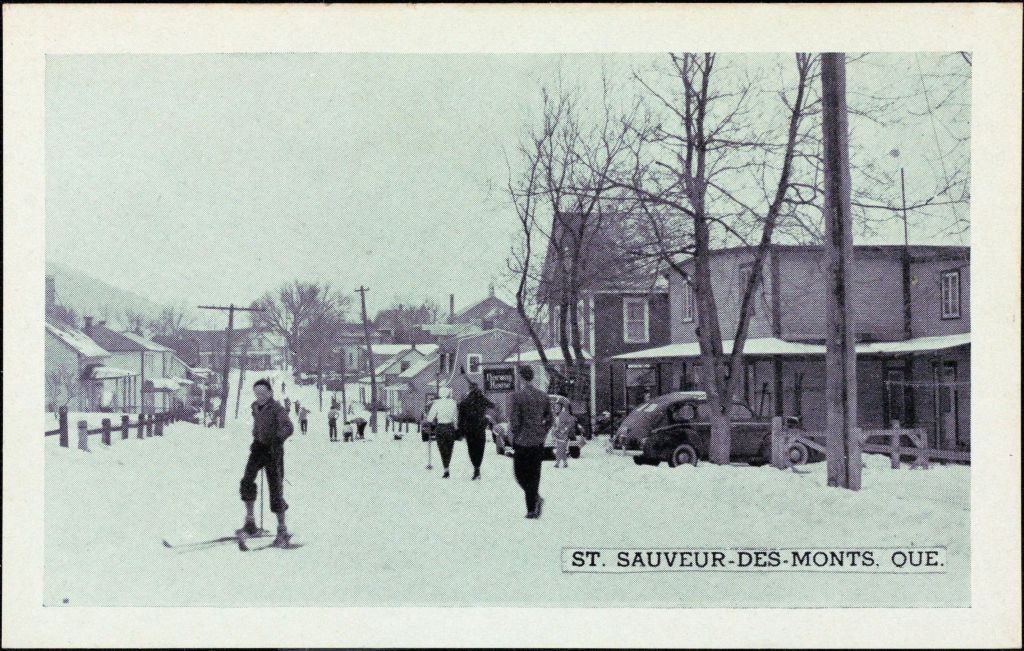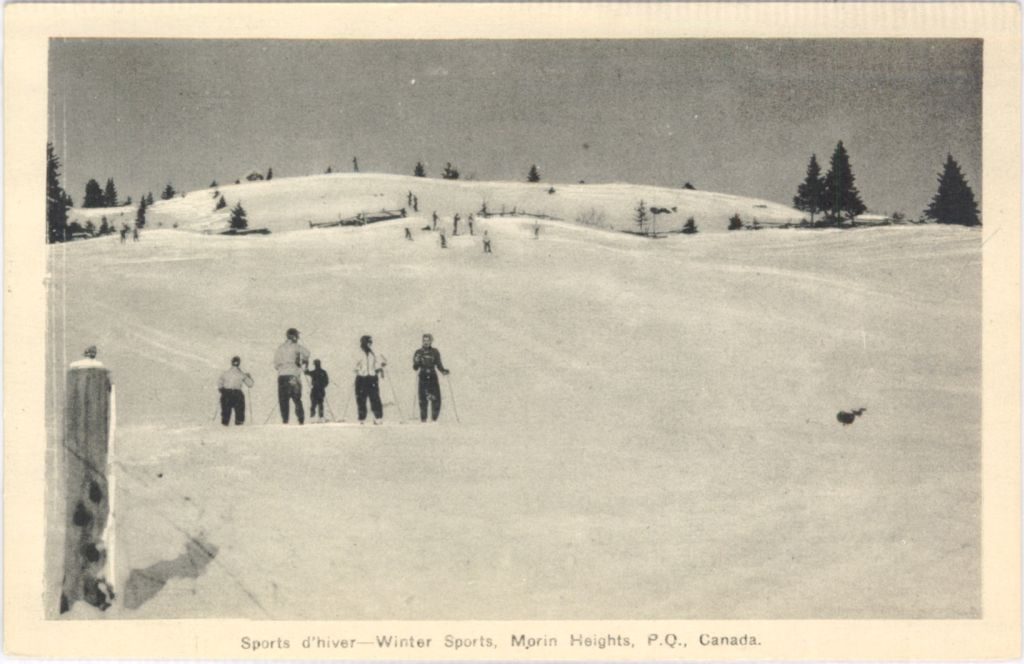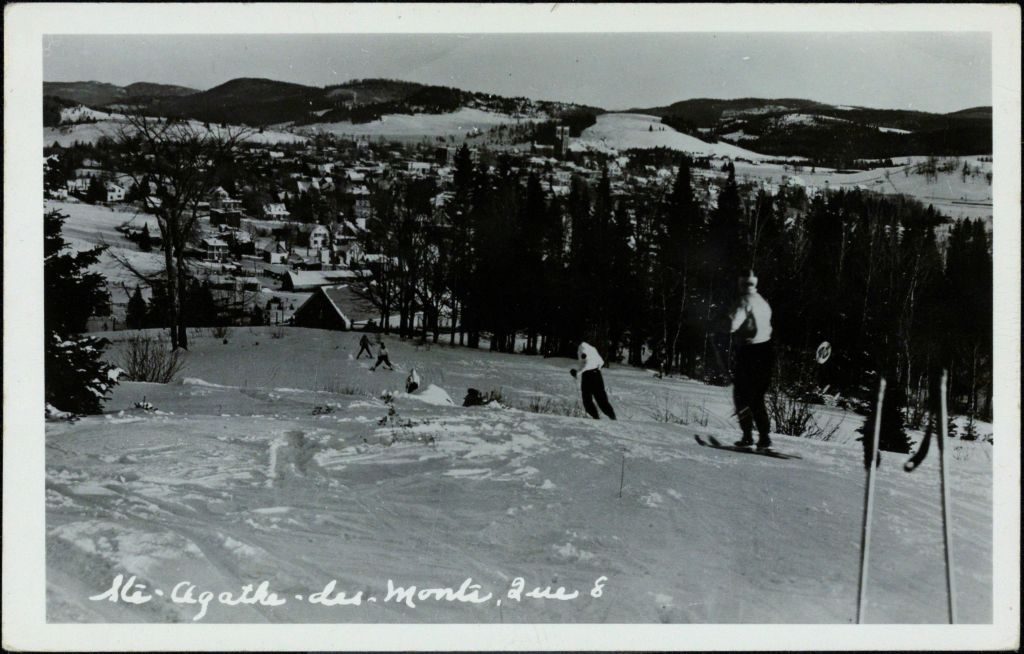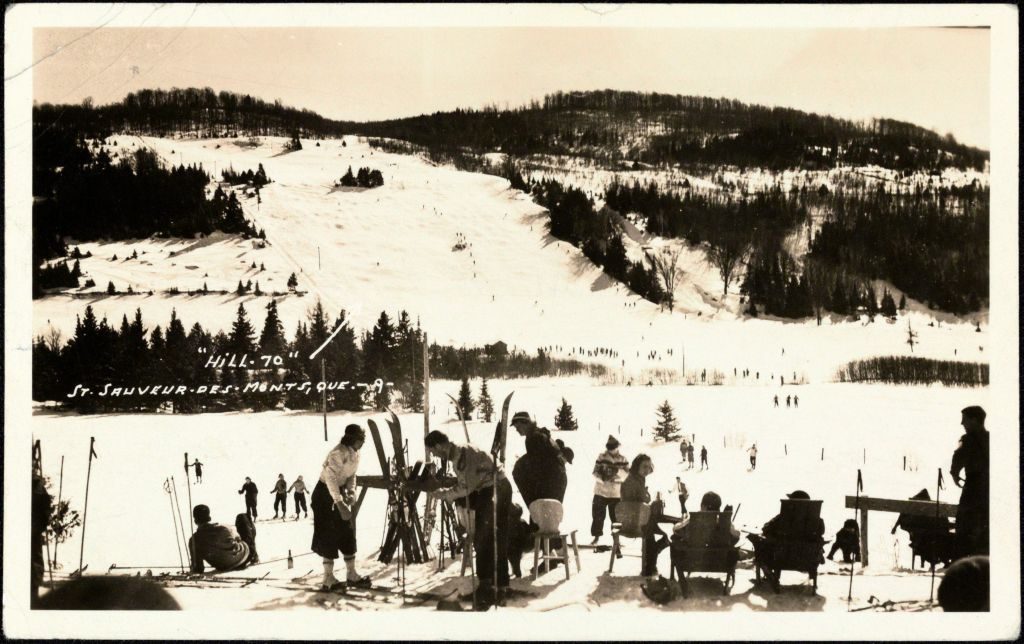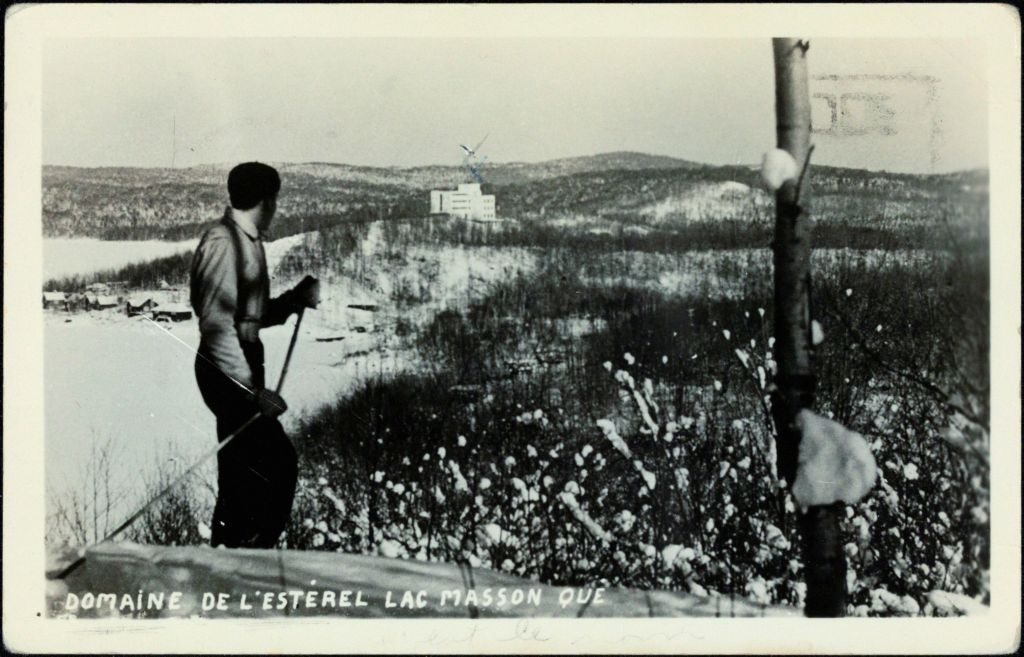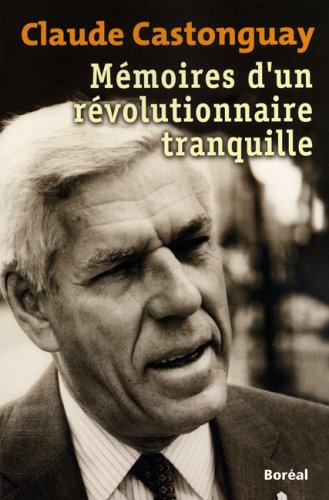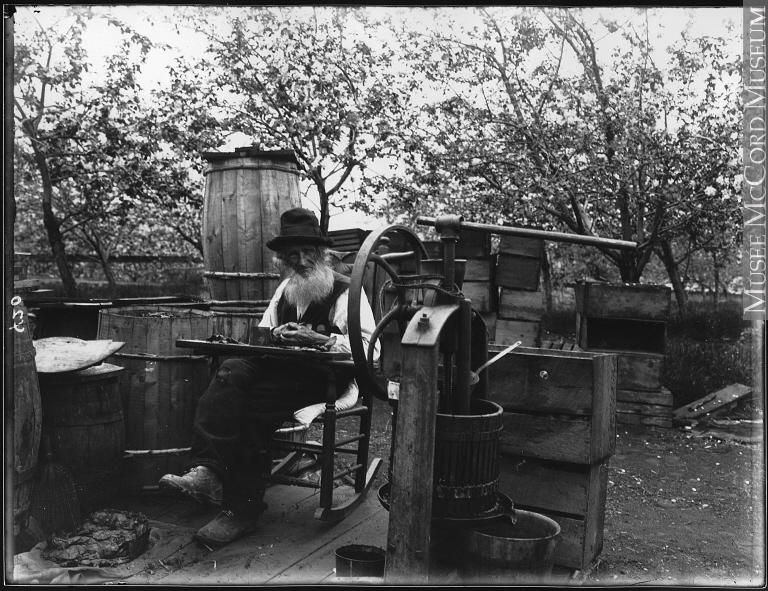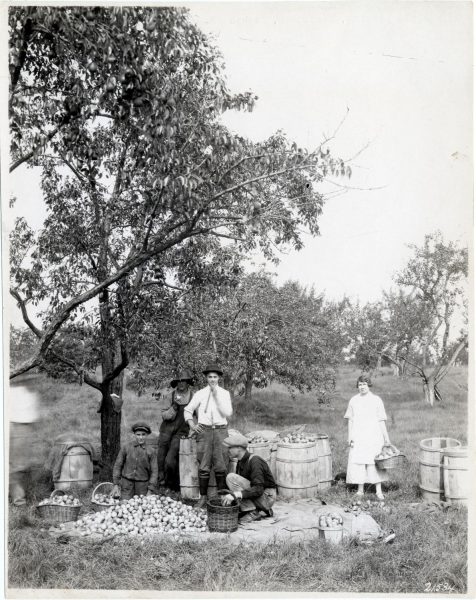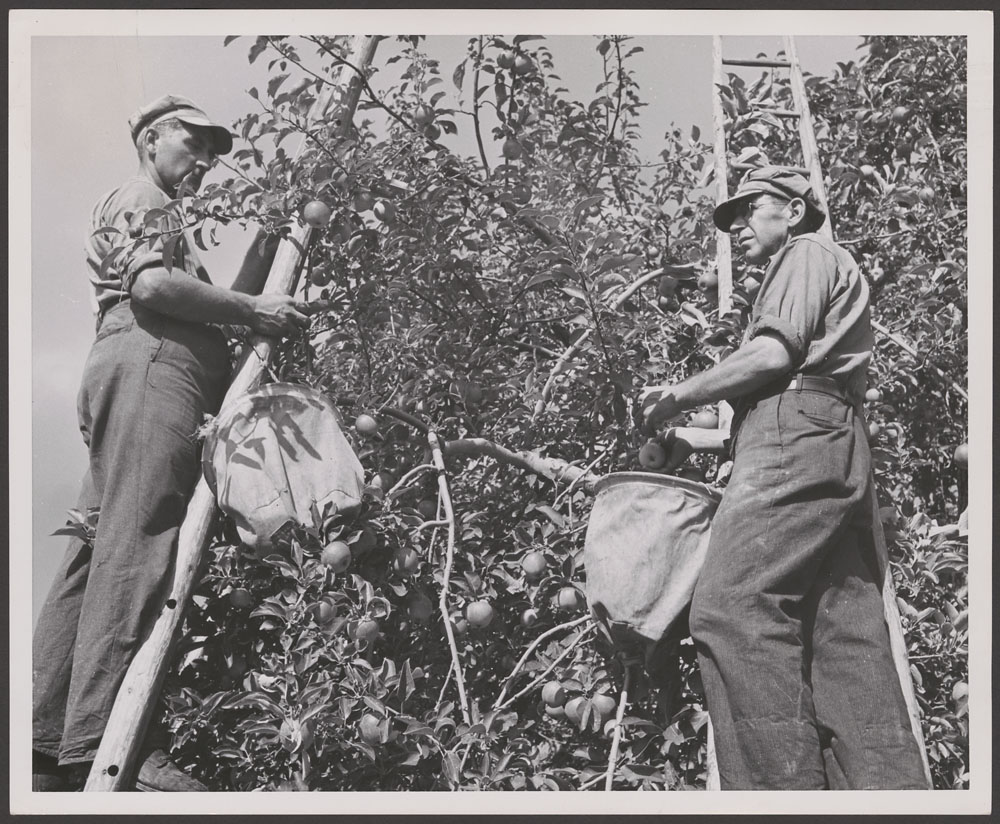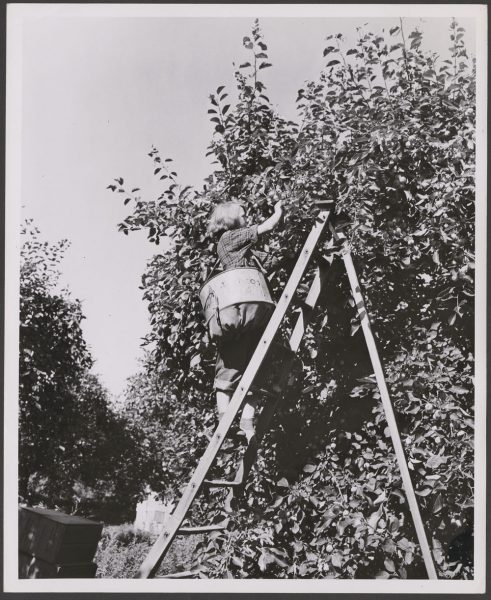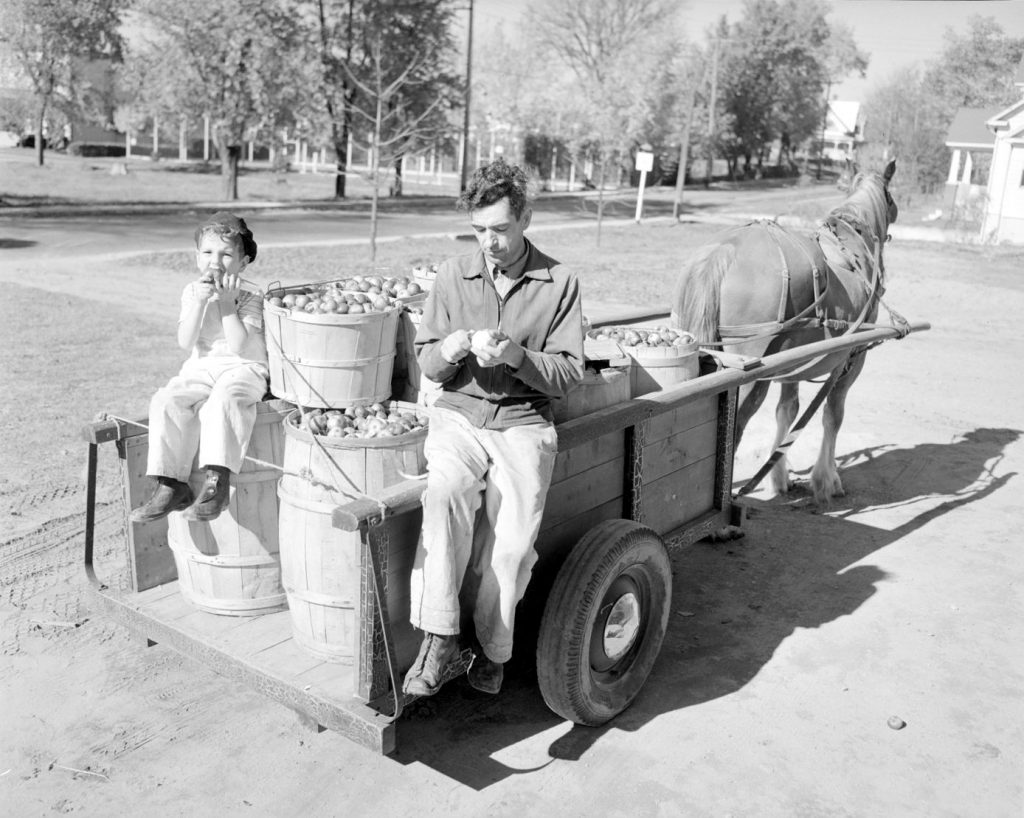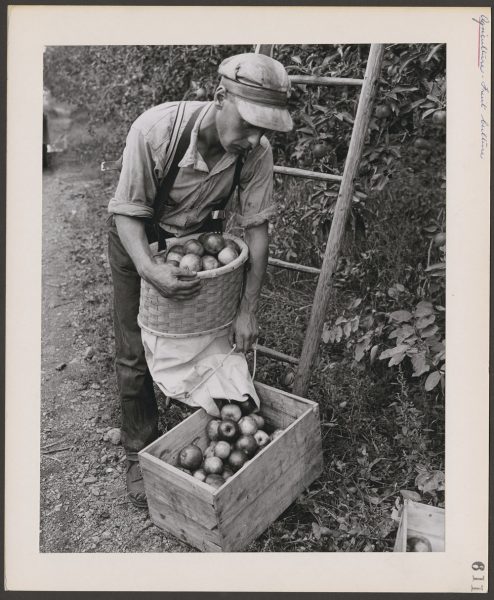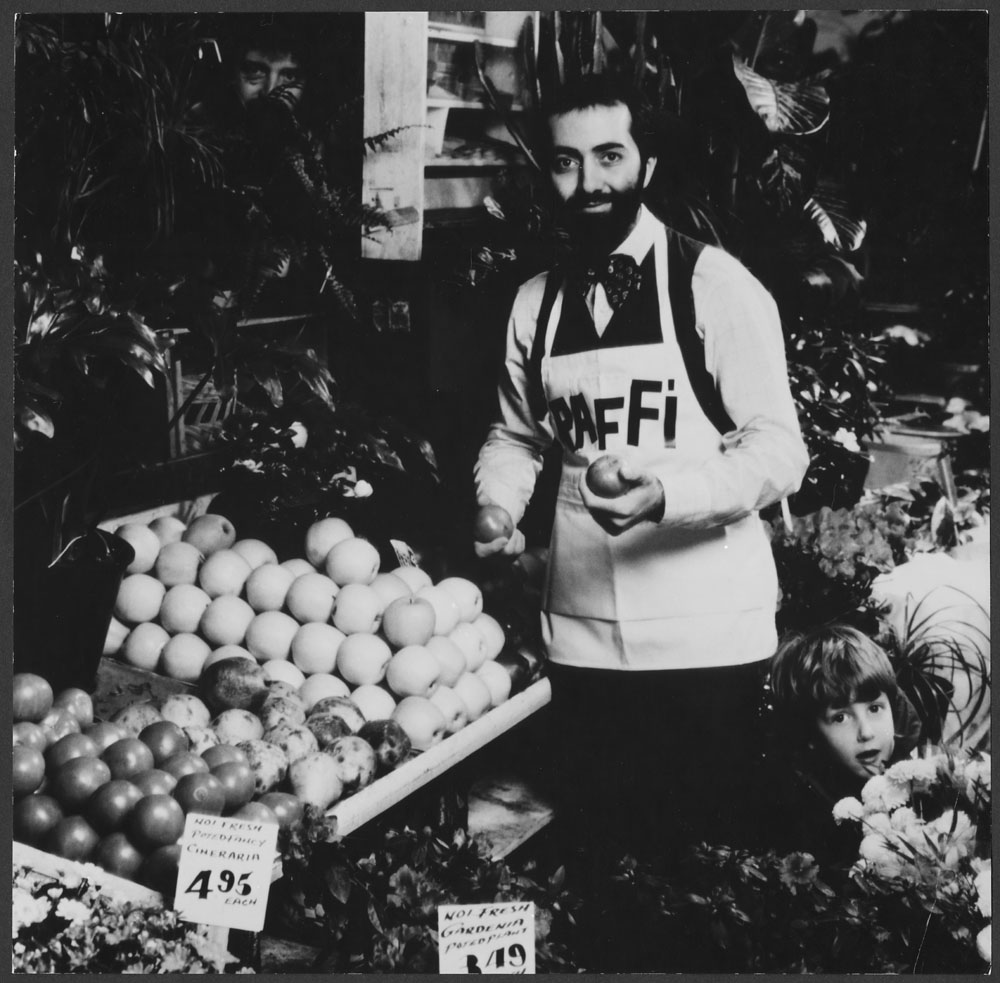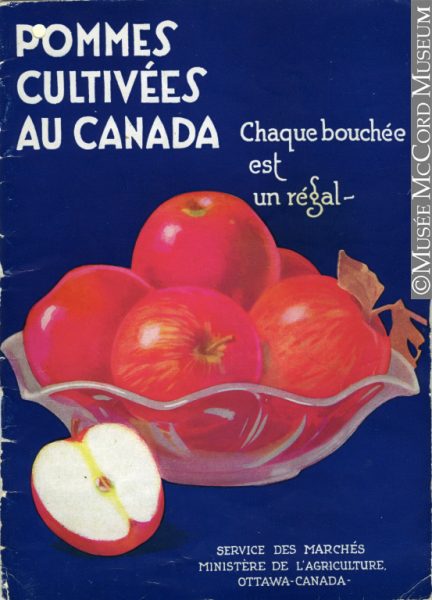Comment se porte l’industrie touristique au Québec, alors que les frontières sont toujours fermées? Quelles régions et quelles entreprises s’en tirent le mieux? Si la «réinvention» a ses limites, la créativité constitue sans contredit une formidable alliée dans le contexte actuel, mais aussi pour l’avenir. Deuxième texte pour faire le point sur la situation du tourisme, cette fois-ci en se concentrant sur la Belle Province. (Pour lire le premier texte, par ici.)
Le tourisme au Québec, c’est beaucoup plus que les parcs nationaux et des icônes comme le rocher Percé. Selon des données du ministère du Tourisme relayées par l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, en 2018, 402 000 personnes gravitaient dans cet univers, ce qui représente 9% des emplois générés par l’économie québécoise. Plus des deux tiers des quelque 30 000 entreprises liées à l’activité touristique se trouvent à l’extérieur des régions de Montréal et Québec et la majorité comptent moins de 20 employés.
Depuis mars 2020, toutes ont vécu les montagnes russes causées par la COVID-19, mais certaines ont ressenti plus violemment les descentes. Les mesures sanitaires rigoureuses étant plus difficiles à appliquer dans certains milieux, des entreprises n’ont eu d’autre choix que de suspendre leurs opérations, temporairement ou non, car parfois, le jeu n’en valait tout simplement pas la chandelle: le nombre de visiteurs permis et les frais encourus annihilaient toute tentative de sauvetage.
«C’est la pire crise, mondialement, que l’industrie a connue, résume Martin Soucy, président-directeur général de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec. La baisse des vols internationaux est de 70% au niveau canadien et nous avons connu une baisse du chiffre d’affaires de plus de 60%. Le tourisme est l’une des premières industries frappées et ce sera l’une des dernières qui va se relever parce que nous sommes tributaires des rassemblements et des déplacements, qui sont deux des éléments sur lesquels la pandémie a le plus d’impact.»
Comment avancer quand son élan est constamment freiné par des éléments hors de son contrôle? Comment garder la foi quand chaque éclaircie est brouillée par une nouvelle averse? «C’est comme un marathon, mais avec une ligne d’arrivée qui se repousse constamment», illustre M. Soucy.

Des chiffres qui frappent
L’absence de touristes internationaux fait mal. Entre juin et août 2020, les attraits phares de la métropole ont connu une baisse de fréquentation de 75% selon Tourisme Montréal. Un communiqué de presse émis en octobre dernier faisait état d’une diminution de 95% du nombre de passagers à l’aéroport Montréal-Trudeau. De mai à juillet, moins de 25 000 voyageurs ont traversé les frontières canadiennes, ce qui représente une baisse de 97,8% par rapport à la même période en 2019. Dans l’est du Québec, le bilan de 2020 n’est guère plus reluisant, malgré un rebond pendant l’été.
Avant la pandémie, les voyageurs internationaux constituaient la principale clientèle de la métropole et de la capitale nationale. «Tout le trafic hors Québec est à 70% localisé à Québec et Montréal et à 30% dans les régions, alors que pour les Québécois, c’est 70% dans les régions et 30% à Québec et Montréal», explique Martin Soucy. À la lumière de ces chiffres, on s’étonne moins de la désertion des rues habituellement achalandées du Vieux-Montréal et du Vieux-Québec en haute saison.
Les liaisons aériennes régionales se font aussi de plus en plus rares. Air Canada a suspendu indéfiniment la plupart de ses vols régionaux au Québec, dont ceux à destination des îles de la Madeleine. Le transport interurbain par autobus traverse aussi une période sombre. Le plus grand transporteur de la province, Orléans Express, vient d’annoncer la suppression de plusieurs services en région.
Au cours de l’été 2020, certains coins de pays ont tout de même réussi à bien tirer leur épingle du jeu. Si l’on se fie au taux d’occupation des hébergements, quatre régions ont même connu une hausse de fréquentation, selon Martin Soucy: la Gaspésie, les Laurentides, les Cantons-de-l’Est et Duplessis, sur la Côte-Nord.
D’avril à septembre 2020, une enquête en trois volets sur les impacts de la COVID-19 sur l’industrie touristique québécoise menée par la Chaire de tourisme Transat, en partenariat avec le ministère du Tourisme, l’Alliance de l’industrie touristique du Québec et les associations touristiques régionales et sectorielles, a révélé que 47% des organisations sondées ont vu leur situation financière se détériorer au printemps 2020. À la fin du mois d’août, «45% des entreprises interrogées jugeaient que leur sort s’était amélioré durant l’été». Sans grand étonnement, ce n’est pas le cas des grands centres, où environ 57% des répondants ont plutôt constaté que leur situation financière avait piqué du nez malgré le déconfinement et les vacances estivales.
Afin d’agir de manière plus proactive, des acteurs de l’industrie se sont mobilisés et ont formé la Conférence économique de l’industrie touristique québécoise l’automne dernier. Six femmes et six hommes propriétaires d’entreprises touristiques, dont Christiane Germain, coprésidente des Hôtels Germain, et Alain April, directeur général et copropriétaire de l’hôtel Le Bonne Entente et d’Entourage-sur-le-Lac, y siègent. Leur objectif: proposer des solutions concrètes aux instances politiques afin d’éviter la déstructuration de l’industrie touristique.
Les chiffres qui défilent sur la page d’accueil du site Web sont éloquents. On mentionne notamment que le taux d’occupation des hôtels est de 5 à 15% en zone urbaine. «Le tourisme est un des secteurs économiques le plus durement touché par la pandémie mondiale», peut-on lire. Après cinq années consécutives de croissance, plusieurs experts s’attendent à ce qu’il ne retrouve pas avant 2024 sa vigueur de 2019. En octobre 2020, le président du regroupement, l’ancien ministre libéral et avocat Raymond Bachand, n’avait pas hésité à parler de «désastre» pour qualifier la situation.

Se «revirer sur un dix cents»
Depuis le printemps dernier, de nombreuses mesures ont dû être mises en place en coulisses pour permettre une reprise, au moins minimale, des opérations. Événements Attractions Québec a par exemple été mandaté pour concevoir les guides sanitaires et accompagner les entreprises dans leur application.
François-G. Chevrier, directeur général, souligne la rigueur des différents acteurs de l’industrie. «Il n’y a pas eu d’éclosions provenant d’activités touristiques, ce qui est une nouvelle encourageante pour les Québécois qui commencent à penser à l’été prochain», dit-il.
Parmi les initiatives soutenues par le ministère du Tourisme au cours des derniers mois, le Passeport Attraits, destiné aux Québécois, a connu un franc succès. Aussi gérés par Événements Attractions Québec, les passeports de l’été 2020, qui offraient des rabais de 20, 30 ou 40% selon le nombre d’attractions sélectionnées, se sont tous envolés (à noter qu’il en reste toujours pour la saison hivernale).
Malgré les bonnes nouvelles, François-G. Chevrier apporte quelques bémols. «Nous avons eu une saison estivale au-delà des espérances, mais les données que nous avons sont pour un été plus court qu’à l’habitude. L’absence de clientèle hors Québec a eu un impact. Les attraits sont allés chercher de 25 à 30% des achalandages [habituels]. La capacité d’accueil devait rester limitée pour permettre la distanciation. Par exemple, le Zoo de Saint-Félicien était peut-être sold out, mais cela reste 30% de la capacité normale. C’est une bonne nouvelle que certains aient affiché complet, mais c’était à peine rentable. Nous étions contents que les équipes puissent travailler et accueillir les visiteurs, mais ce fut une année difficile.»

Des régions aux réalités différentes
Par leurs réalités géographiques, leur climat et leur distance avec les grands centres, les régions du Québec ne font pas toutes face aux mêmes défis. Il suffit de se rappeler la complexité des déplacements terrestres vers les îles de la Madeleine l’été dernier, alors que les voyageurs devaient composer avec les règles – changeantes et pas toujours claires – imposées par les provinces maritimes traversées. Des régions comme la Côte-Nord, dont la haute saison touristique est plus courte, ont aussi moins souffert du début tardif des activités de l’été 2020 puisque les visiteurs s’y rendent habituellement surtout après le 24 juin, pandémie ou pas.
Aussi soutenus par le ministère du Tourisme, les forfaits Explore Québec, qui proposent un rabais minimal de 25% sur des séjours sélectionnés, semblent avoir encore du mal à trouver leur cible. Il faut dire que les Québécois élaborent généralement eux-mêmes leurs projets de vacances dans la province. L’idée reste toutefois intéressante pour explorer des coins méconnus, surtout s’ils exigent une logistique plus complexe. C’est l’association des Agences réceptives et forfaitises du Québec (ARF-Québec) qui est mandataire du programme, en collaboration avec Bonjour Québec.

Tous au chalet!
S’il y a une chose positive relevée depuis le début de la pandémie, c’est bien le désir des Québécois de profiter du plein air et des grands espaces. Lors de sa mise en vente en juin dernier, l’édition spéciale de la carte annuelle de la Sépaq, vendue à moitié prix, a connu un succès retentissant. Plus de 60 000 cartes ont trouvé preneur en une seule journée. L’été 2020 a d’ailleurs fracassé tous les records de la Sépaq. Simon Boivin, responsable des relations avec les médias et vice-président commercialisation, rapporte que «malgré le contexte particulier, jamais autant de Québécois n’ont visité leurs parcs nationaux que lors de la dernière période estivale, avec un total de 4,8 millions de jours/visite, une hausse de 14% par rapport à l’an passé».
Fait intéressant, une nouvelle clientèle a pris d’assaut les parcs du réseau. «Nous avons redécouvert nos parcs nationaux et nos attraits», observe Martin Soucy.
Pendant que les hôtels tiraient le diable par la queue, nous avons également assisté à une véritable ruée vers les chalets et autres hébergements pouvant accueillir une bulle composée de deux à six personnes. Les lieux en pleine nature avec WiFi continuent d’avoir la cote depuis que le télétravail est la «nouvelle normalité». Sans encourager les déplacements, le premier ministre François Legault a répété à maintes reprises aux propriétaires et locataires de chalets d’éviter les contacts au maximum et de privilégier l’achat d’emplettes pour toute la durée du séjour, avant le départ.

Des événements adaptés
Sans grande surprise, les organisateurs d’événements ont été particulièrement touchés par la pandémie. Certains ont usé d’imagination pour proposer d’autres options.
Le Festif! de Baie-Saint-Paul est sans doute l’un des meilleurs exemples de résilience. Au début de l’été 2020, l’équipe a notamment mis en place des sessions d’écoute dans des lieux enchanteurs de la ville. Contrainte de devoir annuler «La Petite Affaire», version intimiste de son festival annuel concoctée in extremis à la suite de l’annonce des nouvelles exigences de la Santé publique, elle a aussi élaboré une «Tournée de portes», série de microconcerts donnés dans la cour des résidents de la ville. L’équipe a bon espoir de pouvoir accueillir les festivaliers pour sa 11e édition en juillet 2021.
D’autres événements ont opté pour une version virtuelle ou hybride, comme le Carnaval de Québec, qui a proposé cette année des soirées thématiques sur sa chaîne YouTube, mais aussi des lieux à visiter dans différents secteurs de la ville pour éviter les rassemblements.
«Certains n’ont pas trouvé d’alternatives, mais plusieurs ont développé des angles intéressants pour eux et leurs partenaires», soutient François-G. Chevrier. La Virée nordique de Charlevoix invite par exemple les adeptes de sports d’hiver à relever cinq défis dans leur propre région. «Les gens se filment et partagent leur défi sur les réseaux sociaux, pour inciter à aller jouer dehors», précise M. Chevrier.

L’année de Charlevoix, vue de l’intérieur
L’exemple de Charlevoix permet d’avoir un bon aperçu de la gamme d’émotions traversées un peu partout au Québec au cours des derniers mois.
Directeur général de Tourisme Charlevoix, Mitchell Dion raconte que la région connaissait un excellent début d’année au moment où la pandémie a frappé. «Nous nous apprêtions à battre le record du meilleur hiver de toute l’histoire. Le taux d’hébergement, qui tient compte des lieux de quatre unités et plus – donc, sans les chalets –, laissait présager une année exceptionnelle. En janvier 2020, notre taux d’occupation avait augmenté de 7% par rapport à l’année d’avant et en février, de 2,3%. Nous étions vraiment sur une bonne lancée. Nous avions aussi connu une bonne semaine de relâche. Quand c’est arrivé, ce fut très brusque considérant que nous étions dans un élan.»
L’été a apporté une bouffée d’espoir. «Nous avons été surpris de voir à quel point l’été a été bon dans Charlevoix, dit-il. […] Juillet, août et septembre ont été exceptionnels. Nous avons connu une baisse de 2,4% en juillet. En août, notre taux d’occupation était de 80%, par rapport à 80,7% en 2019.»
Dès l’entrée en vigueur du nouveau système de couleurs et des paliers d’alerte par zone, en octobre, le vent a tourné. «Novembre et décembre ont été très difficiles», admet-il.
Il relève tout de même certains points positifs dans l’océan de mauvaises nouvelles. «Le premier est que de plus en plus de familles viennent dans la région. Traditionnellement, Charlevoix était une destination prisée des plus jeunes, qui veulent faire des activités sportives, et des couples de 55 ans et plus en escapade. Le deuxième point est que beaucoup de gens qui prenaient des vacances sur la côte est américaine ou dans le Sud ont profité de l’occasion pour découvrir notre Québec.»
D’un point de vue plus philosophique, il voit également cette période trouble comme un bon moment pour mettre de l’avant certaines pratiques plus écoresponsables. «L’espèce de pause qui s’est imposée sur la planète a entraîné toutes sortes de phénomènes. […] Ce fut l’occasion de voir que notre façon de vivre effrénée n’était pas durable. Pour nous, chez Tourisme Charlevoix, c’est l’occasion de peser un peu plus sur la pédale pour aller vers une pratique plus écoresponsable. C’est un virage que nous souhaitons prendre au cours des prochaines années.»

La techno à la rescousse
Un autre virage accéléré par la pandémie a été celui des technologies. Des hôtels, dont Le Germain Montréal et le Boxotel, dans le Quartier des spectacles, ont installé des bornes permettant les arrivées sans contact.
Du côté des attraits, l’achat des billets par Internet est devenu la norme. Plusieurs institutions muséales ont également instauré la réservation de plages horaires pour éviter les files d’attente. C’est le cas du Biodôme de Montréal, qui a rouvert ses portes le 31 août dernier après plus de deux ans de travaux… avant de refermer à la fin de septembre 2020 jusqu’au 8 février 2021.
Pour son directeur, Yves Paris, il ne fait aucun doute que les achats en ligne et la réservation de plages horaires perdureront. «Nous avions déjà décidé d’avoir une billetterie en ligne. Nous ne voulions pas, à la réouverture, avoir des files d’attente comme par le passé. Nous nous étions mis comme objectif que 85% des gens devraient acheter leurs billets par Internet. […] Dans les faits, c’est presque 100% qui ont acheté leurs billets en ligne.»
La réservation d’une heure de visite permet de mieux répartir le nombre de visiteurs au cours de la journée. «Auparavant, les gens venaient entre 10h et 14h et c’était la cohue alors qu’il n’y avait personne à 17h. Je pense que cela améliore beaucoup la qualité de l’expérience.» Actuellement, 400 personnes peuvent explorer les salles rénovées du Biodôme. Lors des journées les plus achalandées de l’été, avant la fermeture, on en comptait parfois jusqu’à 4000… «Les gens ont une visite V.I.P!» lance le directeur.
Lors du Gueuleton Tourisme 2021: entre défis et occasions d’affaires, organisé par le Réseau de veille en tourisme en janvier, le directeur du MT Lab, Martin Lessard, a fait mention de l’accélération des compétences en ligne. «Il n’y aura pas de retour en arrière. Je ne crois pas que les transactions en ligne vont disparaître, tout comme la réservation du créneau horaire. On peut dire qu’on a enfin eu le rattrapage de la culture numérique.»

À quoi s’attendre pour les vacances d’été?
Lors du même événement, entièrement virtuel, Marc-Antoine Vachon, titulaire de la Chaire de tourisme Transat, a souligné l’intérêt marqué des Québécois à explorer la Belle Province. «Selon une enquête menée par la Chaire à l’automne dernier, 76% des voyageurs québécois ayant visité la province durant l’été 2020 ont dit désirer en découvrir plus.»
Si, à l’heure actuelle, le gouvernement demande toujours aux Québécois d’éviter les déplacements interrégionaux non essentiels, on peut espérer que la situation permettra un assouplissement des mesures d’ici l’été. Plusieurs observateurs ont par ailleurs noté qu’un nombre grandissant de voyageurs opte pour des séjours plus longs à l’intérieur de la province, ce qui leur permet de parcourir de plus longues distances.
Chose certaine, la tendance des séjours de dernière minute, qui semblait bien ancrée dans les habitudes des Québécois accros aux bulletins météo, semble se renverser. Malgré l’incertitude ambiante, les réservations vont bon train dans les destinations les plus populaires, comme en a fait état Le Soleil le 12 février. «Tourisme Gaspésie: l’été 2021 presque déjà complet», titrait le quotidien de la Vieille Capitale. Le défi, cette année, sera de gérer adéquatement le flux de touristes afin d’éviter les écueils de l’été 2020.
À la Sépaq, où 20% des disponibilités de camping pour l’été 2021 se sont envolées lors de la première journée de réservations, le 14 novembre 2020, on s’attend aussi à un été similaire à 2020. Simon Boivin suggère de planifier ses vacances dès maintenant. Selon lui, mieux vaut se fier aux règles en vigueur actuellement plutôt qu’anticiper celles de l’été prochain. «Penser davantage en fonction des consignes en vigueur présentement réduit le risque de devoir changer les plans si elles le sont toujours cet été, croit-il. Regarder dans sa région en premier évite de risquer de devoir annuler au cas où les déplacements seraient déconseillés.» Il ajoute toutefois que les politiques flexibles permettront d’annuler un séjour si les conditions ne permettent pas d’en profiter le moment venu.

Une bouffée d’espoir
Malgré les secousses de la dernière année, la plupart des experts consultés au cours des dernières semaines entrevoient tout de même l’avenir avec optimisme. Martin Soucy souligne l’esprit de solidarité qui règne dans l’industrie touristique et l’innovation dont elle fait preuve. «Certaines choses mises en place pendant la pandémie vont rester, dit-il. […] Nous sommes une industrie qui sait saisir les opportunités.»
Afin de mieux évaluer où en sont les hôteliers de Montréal et Québec, les associations hôtelières des deux villes ont fait équipe pour réaliser un sondage trimestriel auprès de leurs membres. La seconde édition, effectuée entre les 25 et 28 janvier 2021 auprès de 79 répondants de l’AHRQ et de 72 de l’AHGM, a démontré que l’aide accordée par les différents paliers de gouvernement, qu’il s’agisse de la subvention salariale, des différents programmes de prêts, des reports de taxes foncières et des autres mesures annoncées au cours des derniers mois, a apporté un peu d’oxygène à l’industrie.
Bien qu’en tenant compte uniquement des revenus d’hébergement, le manque à gagner de ces deux villes dépasse le milliard de dollars, l’espérance de survie s’est améliorée par rapport au trimestre précédent. «Sans ces programmes, un grand nombre d’établissements n’auraient simplement pas été en mesure de survivre, observe TourismExpress. Toutefois, la partie n’est pas gagnée et il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour nos entrepreneurs.»
Parmi les projets à surveiller au cours des prochains mois, mentionnons la Coopérative de transport régional du Québec TREQ, qui souhaite assurer des vols à prix compétitifs entre plusieurs villes de la province. «Notre mission est de doter le Québec d’un réel transporteur aérien régional au service des régions et de leur développement tout en assurant l’offre de billets d’avion à bas prix», peut-on lire sur le site.
La campagne de vaccination jouera assurément un rôle déterminant dans les choix à venir, mais aussi la mise en valeur de notre territoire et de ses richesses. Mitchell Dion déplore que certains perçoivent encore le Québec comme un «prix de consolation» et espère que les Québécois profiteront l’été prochain des «expériences de calibre international».
Confiant face à l’avenir, Martin Soucy dit quant à lui prôner un «pragmatisme éclairé». «Il faut réfléchir à comment nous allons développer nos destinations de manière durable, conclut-il. […] Le Québec sera très bien positionné dans ce que sera le tourisme pour la suite.»