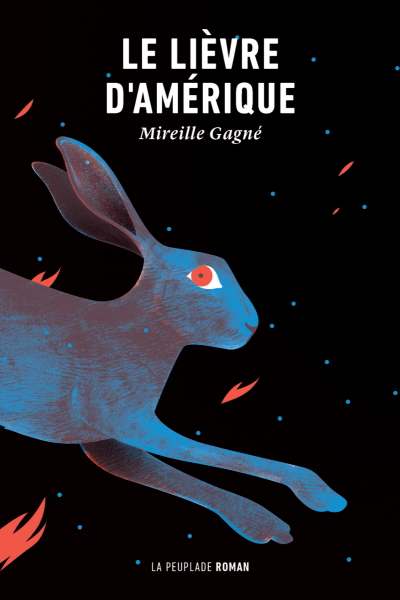Le mois de septembre est arrivé et avec lui vient le temps des pommes. Connaissons-nous vraiment ce fruit qu’on associe ici à l’automne? Voici cinq faits sur la pomme du Québec.
1. Une pomme venue de loin
Bien que venus initialement d’Asie, les premiers pommiers à avoir été plantés en Amérique étaient toutefois originaires de la Normandie, en France.
Au début du XVIIe siècle, ils auraient été mis en terre du côté de Québec et de Port-Royal, en Acadie. Puis, à Montréal, les Sulpiciens auraient été parmi les premiers à en planter dans leurs jardins, suivis des Jésuites, qui en auraient fait pousser sur le mont Royal autour de 1670.
2. Une production impressionnante
Au Québec, on compte plus de 400 producteurs de pommes officiellement répertoriés, situés surtout en Montérégie et dans les Laurentides, et qui récoltent ensemble plus de 100 millions de kilos de pommes chaque année.
3. Une province dans le peloton de tête
Le Québec est la troisième province productrice de pommes au Canada après l’Ontario et la Colombie-Britannique.

4. Une pomme populaire
La pomme McIntosh, qui représente un peu plus de la moitié de la production totale, est la plus prisée des consommateurs québécois. Viennent ensuite la Spartan, la Cortland et l’Empire.
5. Une pomme qui se cuisine
Au Québec, l’industrie de la transformation de la pomme permet d’écouler la moitié des pommes récoltées dans la province. Jus, compotes et tartes sont du lot, mais il y a aussi bien sûr… le cidre, dont le cidre de glace, une innovation typiquement québécoise apparue en 1990. La boisson alcoolisée, obtenue par la fermentation du jus de pommes de variétés tardives dont les sucres sont concentrés par le froid, est un produit phare du Québec.