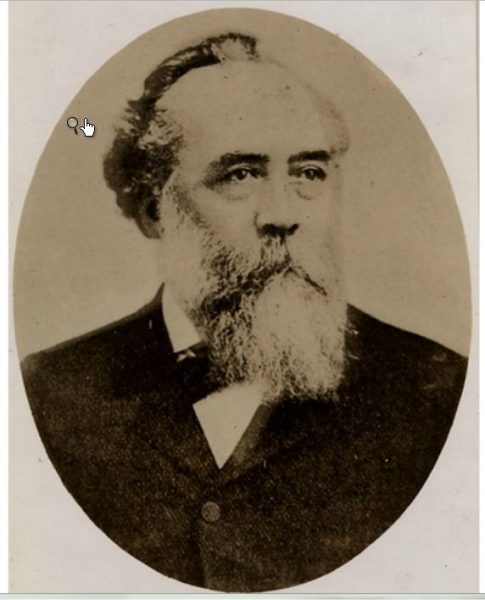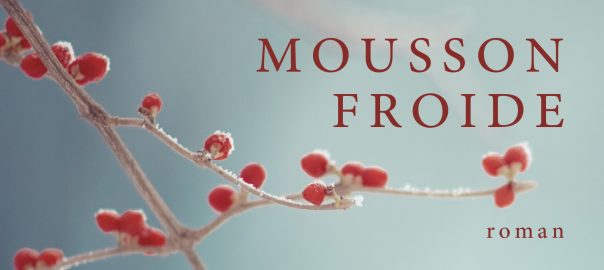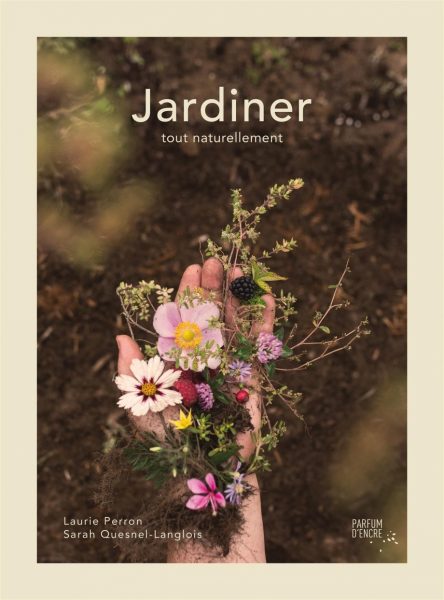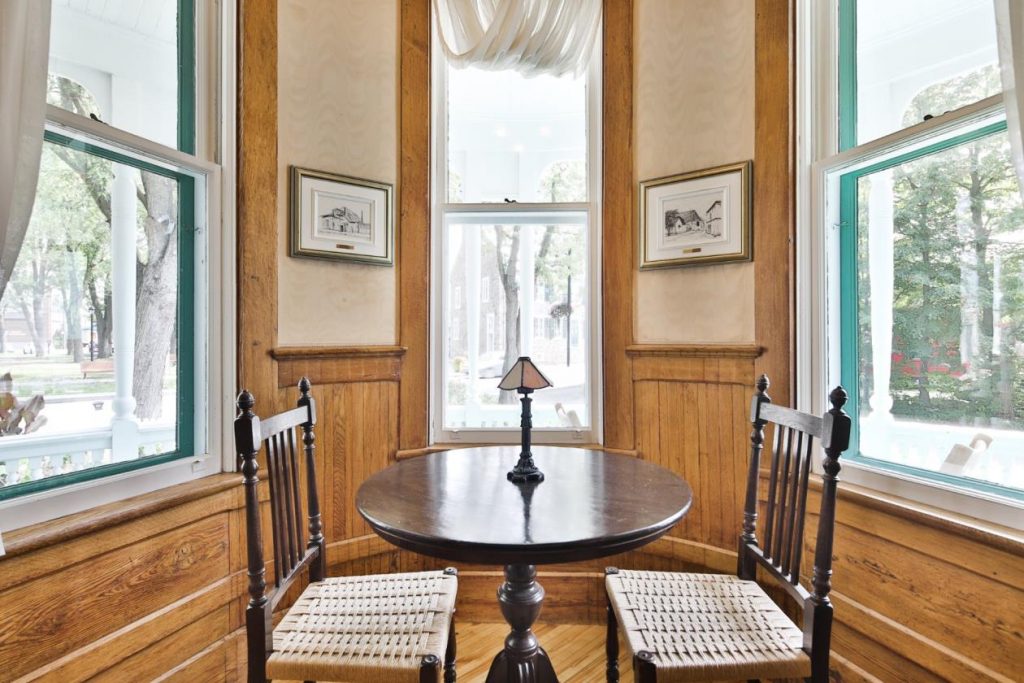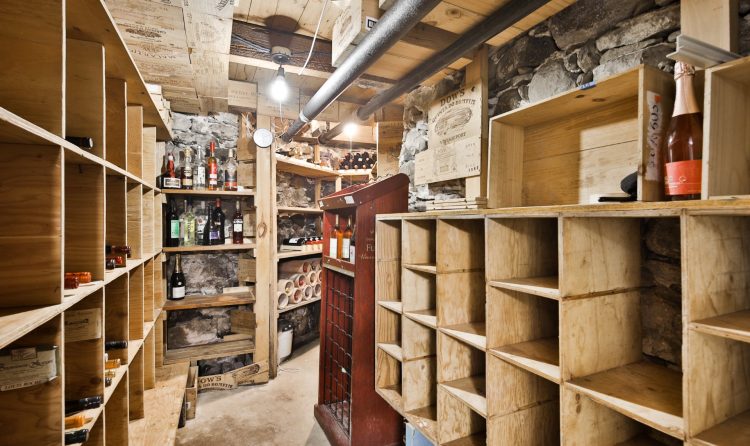Un roman policier écrit par une auteure française et dont l’action se passe au Québec.
Comment ne pas oublier le désormais célèbre roman de Fred Vargas, Sous le vent de Neptune, décrié par une grande majorité de lecteurs et de lectrices du Québec pour le nombre impressionnant de clichés «à la québécoise» et un langage truffé d’expressions dépassées, et parsemé de sacres bien sentis! Couleur locale exotique pour la France, caricature grossière pour le Québec. Un véritable désastre!
Eh bien, ici, dans le tout récent ouvrage de Dominique Sylvain, Mousson froide, vous ne retrouverez aucun de ces irritants qui donnent des boutons aux amateurs de polars de ce côté-ci de l’Atlantique. On s’y reconnait et on se promène dans les rues de notre métropole sans s’y perdre: Montréal, personnage de ce roman avec son hiver, est parfaitement reconnaissable. Et ses habitants aussi!
Une histoire passionnante
L’histoire commence à Séoul en 1997. Sous l’emprise de la rage et des effets d’une cuite carabinée, Yong-hwan, criminel sans envergure, batteur de femme et d’enfants, tue sa fille de six ans à grands coups de couteau devant son fils de huit ans, paralysé par l’horreur.
Près de vingt-cinq ans plus tard, à Montréal, nous rencontrons Jade et son chien Jindo, de la brigade canine de la police de Montréal. Le labrador est spécialisé dans la recherche de mémoires informatiques. Jade habite le duplex de Min-youg, une Coréenne avec laquelle elle entretient des liens étroits. Le fils de la propriétaire, Mark Song, travaille également comme enquêteur. Mark et Jade collaborent à une enquête sur un réseau de pornographie juvénile. L’aide de Jindo est précieuse dans ce trafic de photos pornographiques impliquant de jeunes enfants. Son odorat exceptionnel découvre l’horreur cachée dans les puces électroniques appartenant à un réseau de pédophiles.
Pendant ce temps, en Corée, grâce à sa «bonne conduite», on libère Yong-hwan. Celui qui se surnomme Yogwe, «le vieux démon», n’a qu’une idée en tête: se venger de son ex-femme. Très rapidement et de la pire des façons, il trouve l’argent nécessaire pour financer son voyage et sa vengeance. Évidemment, on comprend très vite le lien entre la dame coréenne, son fils et ce misérable criminel. Ce n’est pas pour rien qu’en prison, il a suivi des cours de français et qu’il peut maintenant converser dans cette langue qu’il maitrise. Depuis le début de son incarcération, il mijote son horrible plat de vengeance … qui se mangera froide, bien sûr, dans la neige du Québec.
Rendu à Montréal, le père traque son ex-femme, son fils, la jeune policière et même son chien. Tout est permis pour arriver à ses fins: se venger et repartir vivre une nouvelle vie aux États-Unis.
L’histoire est passionnante et l’amateur de polars en aura pour son argent. La structure classique du roman rend bien l’intensité et la montée du drame. Comme un chat surveillant la souris, ce diable fou se rapproche sans faire de bruit, toujours plus près de cette famille. Son plan de vengeance est machiavélique. Les personnes traquées ne le voient pas, mais nous, les lecteurs, nous ressentons son souffle dans le cou des victimes de sa vindicte. Dominique Sylvain maitrise les codes du polar et les fils de son intrigue sont parfaitement tissés. Tout se tient et la tension monte en crescendo.
Particularité très intéressante, l’auteure a fait le pari assez risqué de donner la parole à Jindo, le chien renifleur qui, avec son odorat développé et sa logique animale proche de l’humain, jette un regard bien particulier sur ce qui se passe, sur l’action et sur les personnes. Le défi est réussi, le sympathique personnage canin procure au récit une profondeur et une couleur vraiment étonnantes. Si on accepte de jouer le jeu d’un chien qui parle des humains avec tendresse et affection, ce n’est pas long qu’on se laisse prendre au jeu. Et on y croit.
Des personnages attachants
Nous nous attachons très rapidement aux personnages de ce roman. Tout d’abord, Jade Assiniwi, une jeune policière d’origine amérindienne, petite-fille de chef atikamekw, un peu désorganisée dans sa vie personnelle, mais très appréciée par ses collègues et ses patrons.
Ensuite, Mark Song, le fils, le personnage le plus noir du roman. Marqué par l’assassinat sauvage de sa petite sœur, rongé par la culpabilité, excellent guitariste, il aurait pu en faire carrière. Il travaille comme enquêteur à la section criminelle depuis neuf ans. Il est le meilleur ami de Jade et vient tout juste de sortir d’une relation difficile. Puis sa mère, une femme courage, qui pour survivre dans son nouveau pays fait la cuisine dans un minuscule restaurant coréen.
Et voilà ce qui complète le portrait familial, en n’oubliant pas les deux personnages tellement éloignés sur le spectre de la violence, Jindo, le chien pacifiste, aimant, et l’infâme meurtrier en veine de vengeance sanglante, le père venu exiger la vie de sa famille pour lui faire payer ses vingt-cinq années de prison.
Une auteure aux multiples talents
Je vous conseille grandement ce roman de Dominique Sylvain. Premièrement, pour découvrir une auteure aux multiples talents qui, par la qualité de son écriture et la richesse de son histoire, va vous tenir sur le bout de votre chaise pendant toute votre lecture. Et aussi, pour savourer un roman très réussi d’une auteure française qui jette un regard sur notre métropole enneigée avec des yeux intelligents. Et pourquoi pas, pour écouter les impressions d’un chien exerçant un métier que seul son nez peut réussir à faire, tout en jetant un regard pas si animal que ça sur les humains qui l’entourent.
Et si votre premier contact avec cette auteure vous incite à lire d’autres récits, j’ose vous proposer la série Lola Jost et Ingrid Diesel, deux femmes atypiques, une inspectrice de police bourrue à la retraite et une jeune stripteaseuse américaine dans un quartier où le monde se transforme en famille. Attention, les dialogues sont savoureux et créent une dépendance! Moi, je les adorais!
Bonne lecture!
P.S. Par souci de transparence, j’aimerais ajouter que j’ai participé à la révision du manuscrit de ce roman (de façon bénévole). Comme le dit l’auteure à la fin du roman, je devais veiller à ce qu’elle «ne raconte pas trop de bêtises sur Montréal».

Mousson froide,Dominique Sylvain. Les Éditions Robert Laffont. 2021. 374 pages