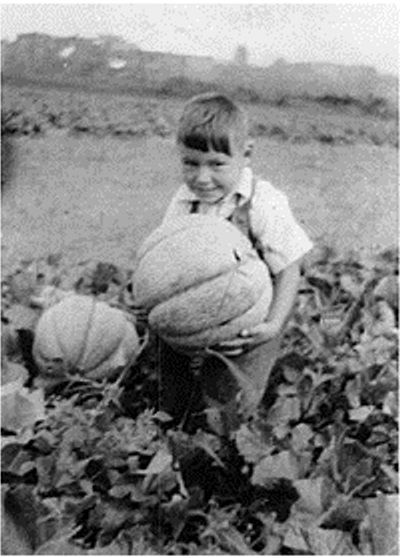Murs de bambou qui «respirent», lumière naturelle abondante et étang rempli de poissons: bienvenue dans les nouveaux bureaux d’Andyrahman Architect, qui misent sur la biophilie.
L’architecture biophilique, qui consiste à créer des lieux synonymes de bien-être en intégrant la nature dans le design, n’a jamais été aussi populaire. La pandémie a apparemment donné à plusieurs l’envie de s’entourer de plantes.
Andyrahman l’a bien compris. Son studio tout neuf à Sidoarjo, en Indonésie, embrasse le concept. L’architecte principal croit que ça pourra «améliorer la qualité de vie et la qualité du travail des employés, qui travaillent fort dans ce bureau, afin qu’ils se sentent plus à l’aise». Leurs résultats et leur productivité devraient s’améliorer du même coup.

L’espace de travail au rez-de-chaussée est ouvert et donne sur un jardin luxuriant. Celui-ci compte aussi un bassin d’eau où nagent des carpes japonaises. Les travailleurs sont ainsi bercés par le gargouillement de la pompe tandis que les nombreuses plantes aident à garder l’endroit frais.

Au deuxième étage, traditions locales et éléments naturels se mêlent. Une technique de tissage indonésienne a ainsi trouvé sa place dans l’aménagement puisque les murs sont en bambou tressé selon cette méthode.

Fermées, les cloisons filtrent la lumière et laissent passer l’air. Et une fois ouvertes, elles semblent effacer la frontière entre l’intérieur et l’extérieur.
Une terrasse à ciel ouvert occupe le dernier étage. Les collègues peuvent s’y retrouver pour se détendre et échanger à la fin de la journée.

Qui sait? Alors que le retour au bureau en présentiel cause des maux de tête à certains employeurs, le contact avec la nature pourrait peut-être réussir à convaincre les plus récalcitrants…