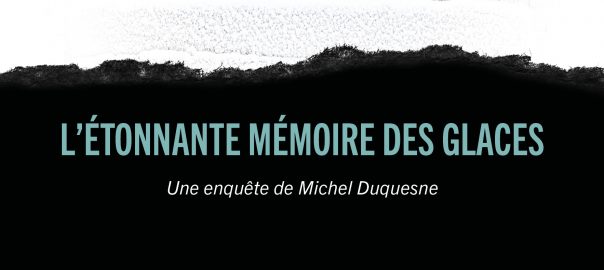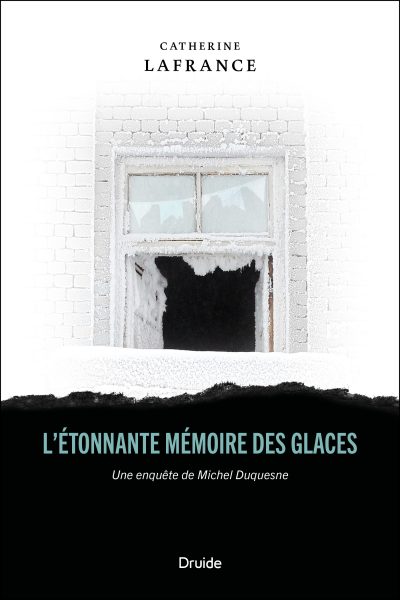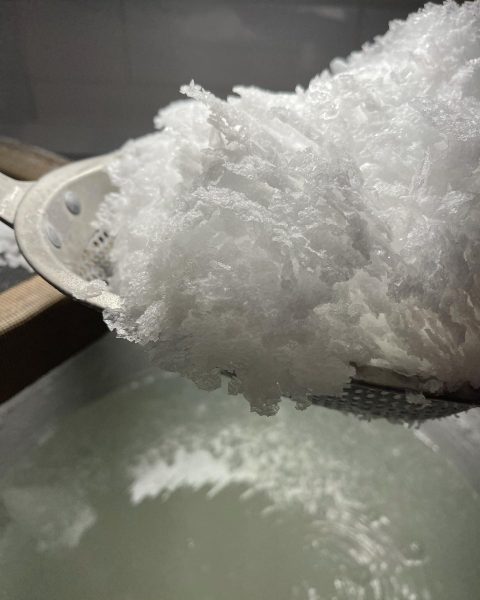Il y a quelques années, en lisant Jusqu’à la chute de Catherine Lafrance, je me disais que cette auteure serait sûrement capable d’écrire des polars. Sept ans plus tard, L’étonnante mémoire des glaces vient me donner raison. Ce quatrième roman est une réussite sur toute la ligne.
Catherine Lafrance a mené sa carrière de journaliste comme reporter, chef d’antenne, animatrice et scénariste. Elle a arpenté les salles de rédaction et les studios de différents médias. L’auteure a même dirigé pendant trois ans la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. On ne se surprend donc pas que son personnage principal, Michel Duquesne, soit un journaliste d’enquête.
Communicateur passionné, intègre et prêt à tout pour informer ses lecteurs, Michel Duquesne, journaliste vedette, affiche une caractéristique bien particulière: il est atteint de troubles obsessifs compulsifs (TOC). Cette situation ne l’empêche cependant pas de bien faire son travail d’enquête.
Que se passe-t-il à Saint-Albert-sur-le-Lac?
Au retour du congé des Fêtes, en pleine tempête de verglas, son rédacteur en chef l’envoie à Saint-Albert-sur-le-Lac pour couvrir un incendie. Au même moment, son amoureuse doit se rendre aux États-Unis afin de convaincre un homme de témoigner au procès d’un caïd de la mafia.
Arrivé sur les lieux de l’incendie qui a fait quatre victimes, dont deux jeunes garçons de moins de 10 ans, Michel rencontre le directeur des communications avec les médias, William Latendresse. Le journaliste a l’impression qu’il lui cache des informations cruciales.
Michel a vu juste: une enquête était déjà en cours, avant même l’incendie. Il n’en faut pas plus au journaliste pour mettre son nez un peu partout, découvrir ce qui se tramait dans le village et ce que certaines personnalités prennent tant de soin à ne pas révéler.
«La honte, c’est un vêtement fait sur mesure: vous l’enfilez et il vous va comme un gant.» Page 131
À force de travail, de questionnements, d’investigations dangereuses et avec l’aide d’une journaliste locale, le reporter finira-t-il par découvrir ce qui se cache dans ce village qui était tout sauf tranquille?
Au péril de sa sécurité, en voulant suivre une piste qui semble prometteuse et en écoutant les doléances d’une plaideuse quérulente certaine de connaitre la vérité, Michel Duquesne sera confronté à ses propres démons et à son passé d’enfant adopté.
Ah oui! Vous vous demandez ce qui se passe avec l’amoureuse aux États-Unis. Eh bien, fiez-vous à Catherine Lafrance pour relier des événements qui semblent parfois bien éloignés.
Un polar qui vous tient en haleine
L’étonnante mémoire des glaces est un polar très bien construit, avec une trame narrative qui vous accroche et vous tient en haleine jusqu’à la fin. Morceau par morceau, le journaliste essaie de soulever les coins de couverture que les «méchants» s’efforcent de rabattre sur leurs répugnants commerces.
Catherine Lafrance a réussi à donner du rythme à son récit, à développer graduellement l’enquête et à amener son lecteur vers une finale qui s’élabore à coups de bribes d’informations et de révélations.
Derrière le talent de l’auteure, on retrouve également toute son expérience de journaliste. Conférences de presse, relations avec la police, collaboration et compétition entre les pairs, tension et pression de l’heure de tombée et recherche de la primeur qui donne l’avance au journal, Catherine Lafrance donne à Michel Duquesne toute la crédibilité et la vraisemblance pour que le lecteur y croie et apprécie le personnage.
La présence de la jeune journaliste Anne-Marie Bérubé ajoute à la diversité de l’enquête, en mettant en perspective deux façons de faire et de penser, en complémentarité. Le grand reporter d’un journal national et la jeune journaliste d’un hebdomadaire local, un duo qui fonctionne bien et auquel on s’attache.
Dans ce roman de plus de 400 pages, l’auteure a réussi à écrire une histoire sans temps mort. On passe d’un élément de l’enquête à l’autre, sans jamais perdre le fil principal. Il y a équilibre entre les différentes parties de l’enquête et la trame du récit est très bien planifiée et dosée.
Un premier polar prometteur
L’étonnante mémoire des glaces est un roman qui présente un côté très noir que le silence d’une communauté peut cacher. Les méchants ne font pas dans la dentelle, les forces du mal sont coriaces et on se demande si les gens de bien pourront ressortir de cet enfer. L’auteure saura vous présenter cette noirceur avec une écriture empreinte de réalisme. Et ce, sans tomber dans le «gore» ou l’horreur.
Il faut faire la découverte de ce premier polar très prometteur de Catherine Lafrance. Il mérite grandement que les lecteurs et lectrices de polars s’y penchent. Elle possède du métier en écriture, ce roman vient confirmer son talent comme auteure de polar.
Une nouvelle voie, un style d’écriture dense et fluide, un rythme qui donne du punch à une histoire bien construite, voici les ingrédients essentiels pour une excellente lecture de vacances. Michel Duquesne est un personnage qu’on aimerait revoir ainsi que sa jeune collègue Anne-Marie Bérubé. Le milieu journalistique offre bien des occasions d’enquête pour ces deux héros. Surtout sous la plume bien aiguisée d’une journaliste qui en a sûrement vu beaucoup.
Bonne lecture!
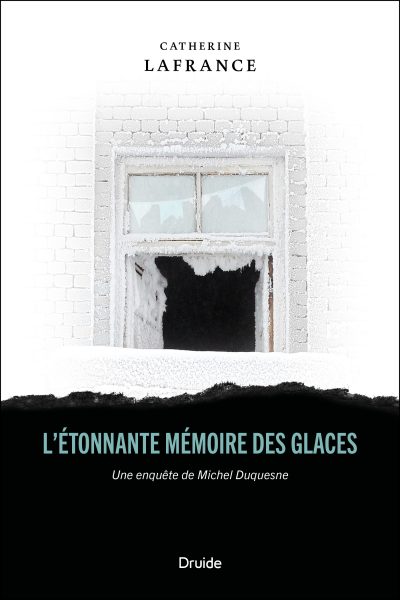
L’étonnante mémoire des glaces, Catherine Lafrance. Éditions Druide. 2022. 416 pages