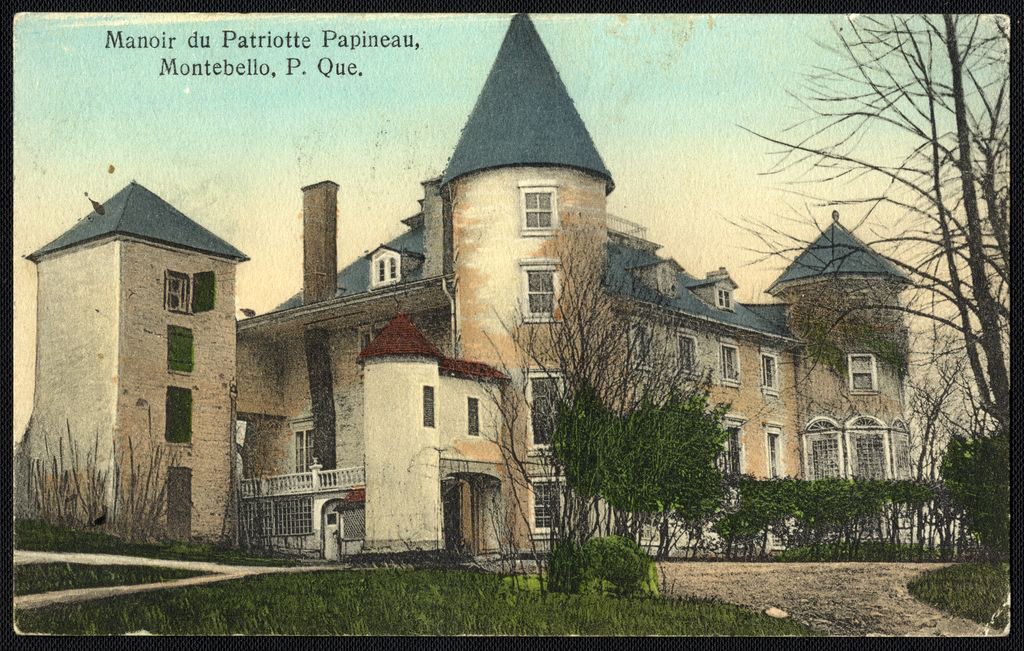Certains produits alimentaires sont parfois victimes de leur succès. C’est le cas de l’ail des bois, qu’il est interdit de commercialiser, et dont la cueillette est réglementée depuis 1995.
L’ail des bois est devenu tellement populaire dans les années 1970 et 1980, et sa cueillette, si intensive, qu’en 1994, on estimait qu’environ le quart des populations connues avaient disparu ou étaient menacées de disparaître. À l’époque, on commercialisait cet ail au goût parfumé et délicat et il était même possible de s’en procurer en épicerie.
Depuis, à titre d’espèce vulnérable, l’ail des bois bénéficie d’une protection juridique au Québec et, désormais, ceux qui font partie des chanceux qui connaissent l’emplacement d’une talle doivent se restreindre à la cueillette de 50 bulbes par année. Pour assurer sa sauvegarde, il faut aussi ne cueillir qu’une feuille sur trois et ne récolter que 5% de la talle.

Et gare à ceux et celles qui ne respectent pas la règle des 50 bulbes : la contrebande d’ail des bois est surveillée de près et les cueilleurs abusifs devront payer une amende.
Mais si cela est bien fait, c’est un plaisir de récolter et d’apprêter l’ail des bois en pesto, en beurre, sur des pâtes…
Si vous avez la chance d’avoir trouvé un endroit béni où cueillir l’ail des bois, pourquoi ne pas transplanter quelques bulbes au jardin? D’ailleurs, les bulbes saisis par les agents de conservation sont souvent remis, le plus rapidement possible, à des gens qui souhaitent les replanter afin de participer au renouvellement de la ressource, qui a besoin d’environ huit ans pour fleurir. Encore mieux: il est possible de trouver des semences sur Internet pour tenter sa chance au jardin.
L’ail des bois est assurément un vrai trésor de la nature…