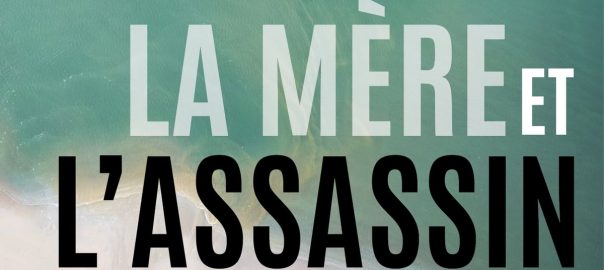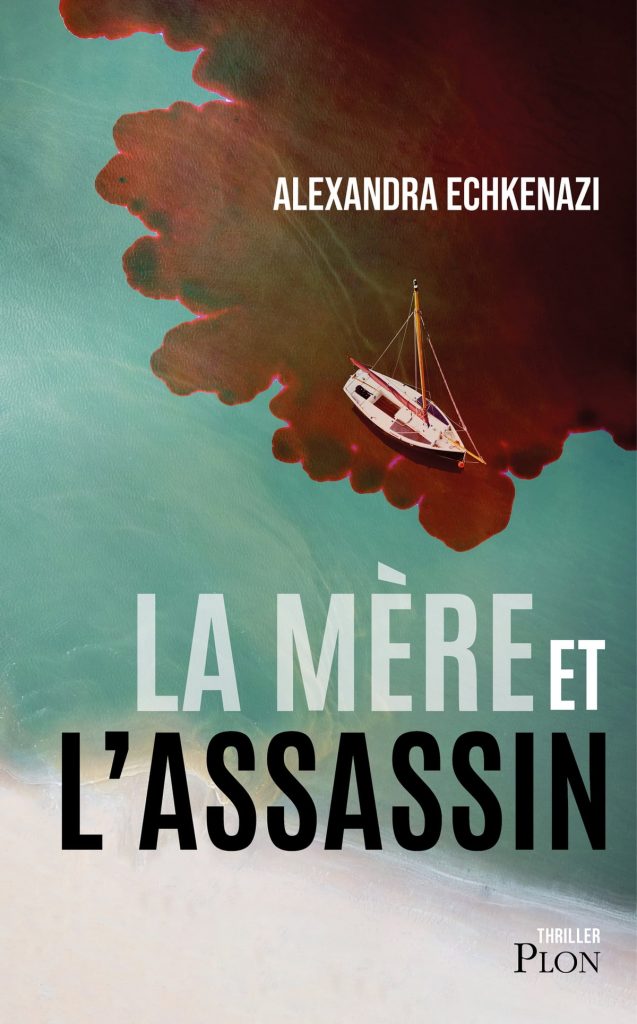Pendant 15 ans, Alexandra Echkenazi a été journaliste aux faits divers au journal Le Parisien. Depuis quelques années, elle exerce le métier de scénariste et de romancière. C’est en lisant Le joueur de Baccara – une histoire romancée sur la naissance de James Bond sortie en 2017 – que j’ai connu Alexandra Echkenazi. Il a donc fallu attendre six ans pour que je retrouve sa plume dans son tout nouvel opus, La mère et l’assassin.
Quel joli titre de polar! Mais également quelle intrigue habilement ficelée! Le roman débute sur une scène révélatrice: Morgane Le Dantec, la mère, se tient à côté du corps de Glenn Bennec, l’assassin. Elle tient dans ses mains une arme à feu, ses mains sont tachées de sang, elle a tenté de le réanimer. En vain!
Une évidence? Sommes-nous en présence de la mère et de l’assassin? Peut-être!
Trois mois plus tôt, Glenn Bennec, professeur d’éducation physique dans un collège malouin, est arrêté pour le meurtre d’Océane, la fille de 17 ans de Morgane Le Dantec. Toutes les preuves mènent au verdict de culpabilité du prévenu. On l’accuse du meurtre de la jeune fille, et aussi d’avoir caché le corps de sa victime. Mais un vice de procédure force la justice à libérer le suspect et à suspendre l’accusation. Voilà qui vient nourrir chez la mère de la victime un besoin de vengeance inéluctable.
La policière chargée du convoi qui transportera le prévenu à sa sortie de prison, Nina Kaminski, ne peut s’empêcher d’émettre des doutes sur toute cette affaire. Malgré le fait qu’elle est enceinte et que sa hiérarchie a peu de confiance en elle, la jeune policière tentera de découvrir ce qui s’est passé lors du meurtre de la jeune Océane. Et celui du prévenu.
Il y a tellement de questions sans réponse, mais aussi beaucoup d’éléments à éclaircir. Où est le corps d’Océane? Pourquoi l’a-t-on tuée? Serait-il possible que la fille et la mère aient eu le même intérêt pour le jeune professeur de sport? Que s’est-il réellement passé le soir de la disparition d’Océane? Voilà autant d’énigmes qui parsèment l’enquête de la policière et qui la poussent à remettre en question certaines incohérences dans l’instruction de départ.
Ce qui est remarquable dans ce roman, c’est la capacité de la romancière à amorcer son histoire par une scène tout ce qu’il y a de plus explicite : une victime et une personne qui tient une arme. Puis, nous démontrer dans le développement de son intrigue que cette évidence cache un arsenal de doutes, de scénarios possibles et d’incertitudes factuelles. Voilà tous les ingrédients d’un thriller psychologique regroupant tout ce qu’il faut pour vous tenir en haleine jusqu’à la dernière page.
Bien sûr, le lecteur de polars en nous se laissera prendre au jeu, formulera ses propres hypothèses et tentera de résoudre les deux meurtres. En contrepartie, l’auteure dissémine sur notre route des indices dont on doit tenir compte, et quand nous pensons détenir la clé de l’intrigue, un revirement vient tout remettre en cause. Quel plaisir de lecture!
En plus de ce jeu entre l’auteure et le lecteur, Alexandra Echkenazi a utilisé une structure romanesque qui sert bien la construction de l’intrigue. Tout au long du roman, elle exploite une temporalité à trois niveaux: ce qui s’est passé avant la disparition d’Océane; la journée où le suspect a été relâché; les jours suivant son assassinat.
De chapitre en chapitre, l’auteure ajoute un peu plus de certitudes à l’incertitude du départ. Graduellement, chacune des pierres que retourne la policière nous rapproche d’une finale surprenante. Même si, à un certain moment, nous avons le sentiment de l’avoir trouvée.
Alexandra Echkenazi nous offre un roman possédant les éléments que l’on recherche dans un thriller psychologique: un début déstabilisant, des personnages qui se retrouvent au bord d’un précipice vertigineux, une intrigue haletante ne nous laissant aucun «répit» et une finale à la hauteur de nos attentes, surprenante et crédible.
Enfin, La mère et l’assassin est un roman terriblement efficace, tant par sa structure narrative que par la qualité de l’écriture. Ces deux éléments font en sorte que ce récit saura satisfaire les lecteurs les plus exigeants. L’écriture est ciselée, cinématographique, le rythme est rapide, les chapitres sont courts, tout est au service du développement de l’histoire. Dès les premières pages, l’action est présente, soutenue et vraisemblable. Un plaisir de lecture à recommander.
Je fais le souhait que l’auteure ne prenne pas six autres années avant de nous offrir un nouveau roman. Et peut-être pourrait-elle nous revenir avec une histoire où nous retrouverons sa policière Nina Kaminski, une femme intrépide, un peu casse-cou, rebelle, avec un côté un peu iconoclaste. De quoi plaire aux amateurs et amatrices de polars!
Bonne lecture!
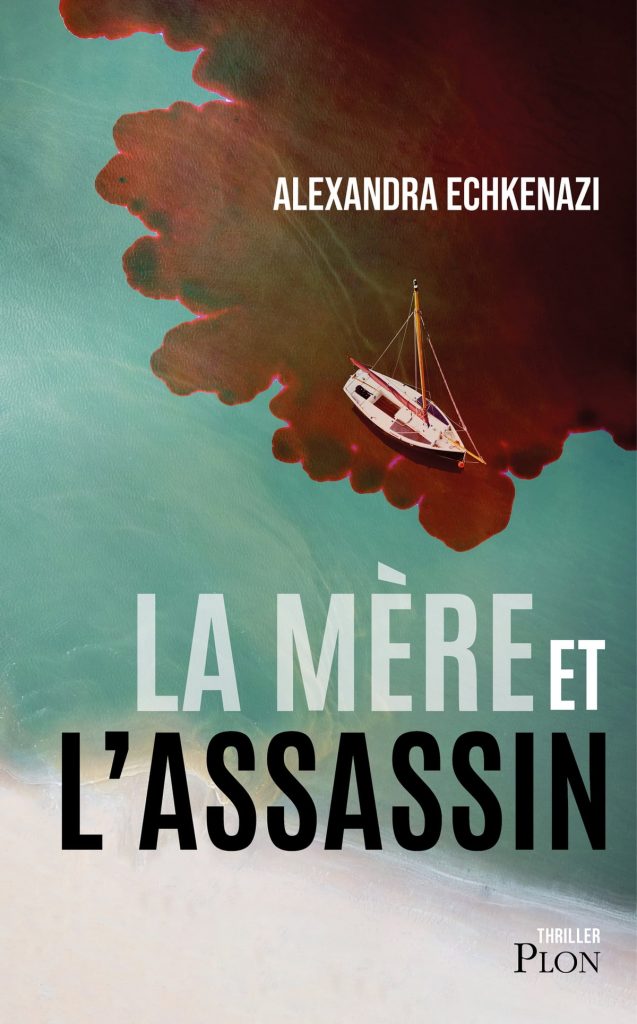
La mère et l’assassin, Alexandra Echkenazi. Éditions Plon. 2023. 260 pages