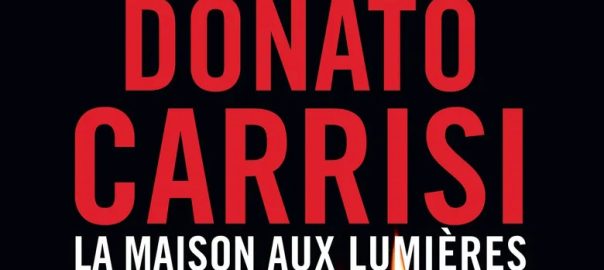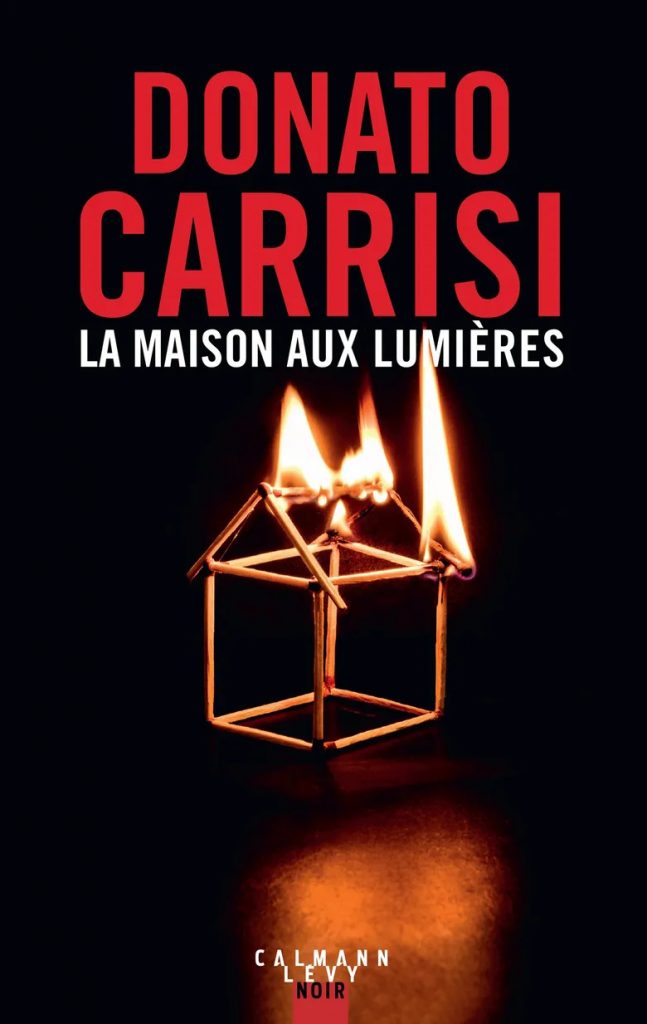Avec ses murs de pierres qui ont dépassé le cap des 230 ans, son puits, ses foyers et ses jardins à l’ancienne, la maison LePailleur, à Châteauguay, propose un plongeon dans le quotidien du Bas-Canada. Visite des lieux.
La demeure construite au 54, boulevard de Salaberry Sud, en bordure de la rivière Châteauguay, traverse l’épreuve du temps sans cicatrices apparentes. Érigée en 1792 par Pierre Bouthillier pour François Rolland, la résidence est imposante pour l’époque.
Cette grande dame d’autrefois représente bien la maison québécoise traditionnelle. Son toit à deux versants couvert de bardeaux de cèdre, ses lucarnes, ses cheminées aux extrémités et ses ouvertures symétriques font partie des éléments caractéristiques de ce style architectural.

Les lieux témoignent du savoir-faire des artisans du 18e siècle. La charpente, dont les madriers sont assemblés à la main, sans clous et, évidemment, sans technologie, est particulièrement impressionnante. En 1896, des travaux permettent d’ajouter des larmiers et un nouvel escalier menant au grenier.
La maison LePailleur change plusieurs fois de vocation et de propriétaire au fil des ans. En plus d’abriter des familles anglophones et francophones, elle sert notamment d’entrepôt de fourrures et de magasin général.
François-George LePailleur, qui y déménage avec son clan en 1826, y établit pour sa part son étude de notaire. Son fils, Alfred-Narcisse, reprend le bureau. À la mort du patriarche en 1834, sa femme Josephte hérite de tout le domaine. Elle en cède huit ans plus tard une partie à sa fille Catherine, qui y fait construire une maison. Les LePailleur gardent la propriété jusqu’en 1875.

On raconte que les troupes britanniques occupent la demeure en 1839 au lendemain de la rébellion des patriotes. Elle est alors saccagée, en raison de l’allégeance soupçonnée du notaire à la cause.

Entre 1958 et 1997, la résidence passe aux mains de la fondation Héritage canadien du Québec. La Ville de Châteauguay l’achète ensuite. Ouverte au public depuis les années 2000, on y présente depuis des expositions en lien avec l’art et l’histoire.