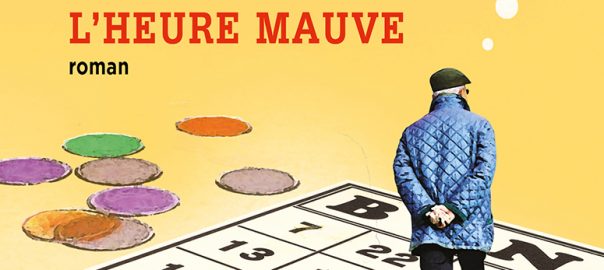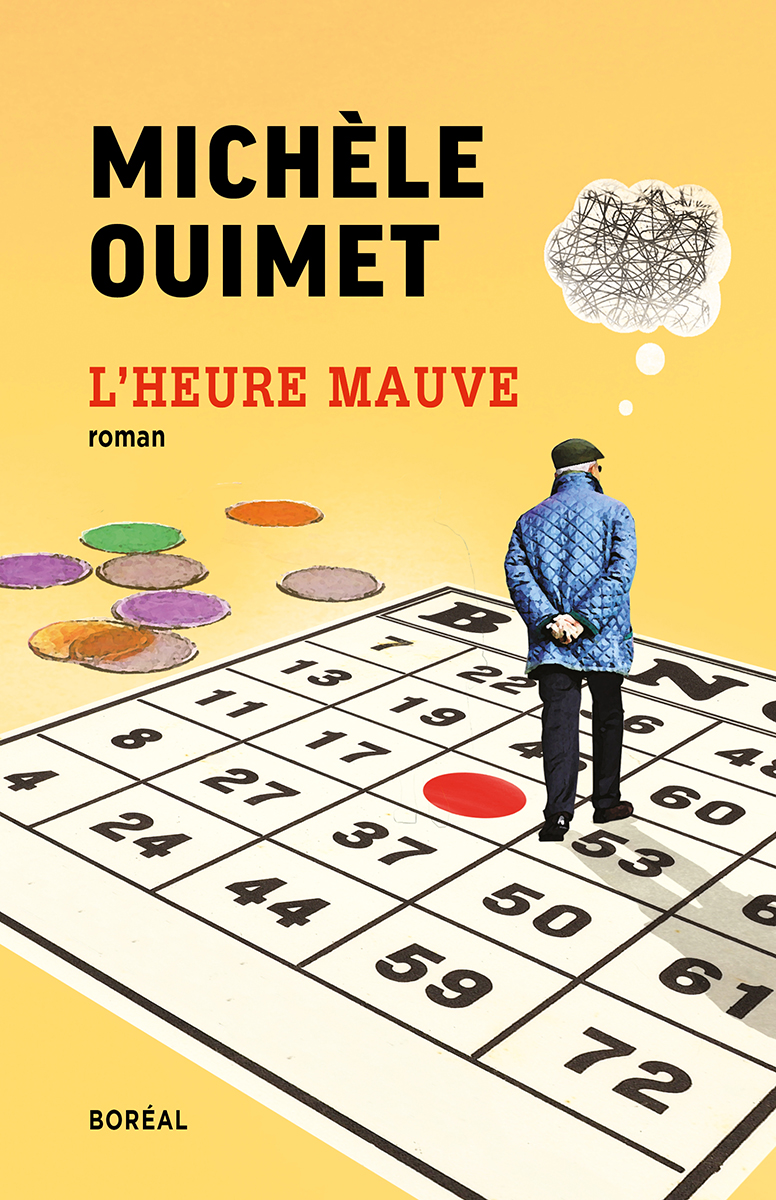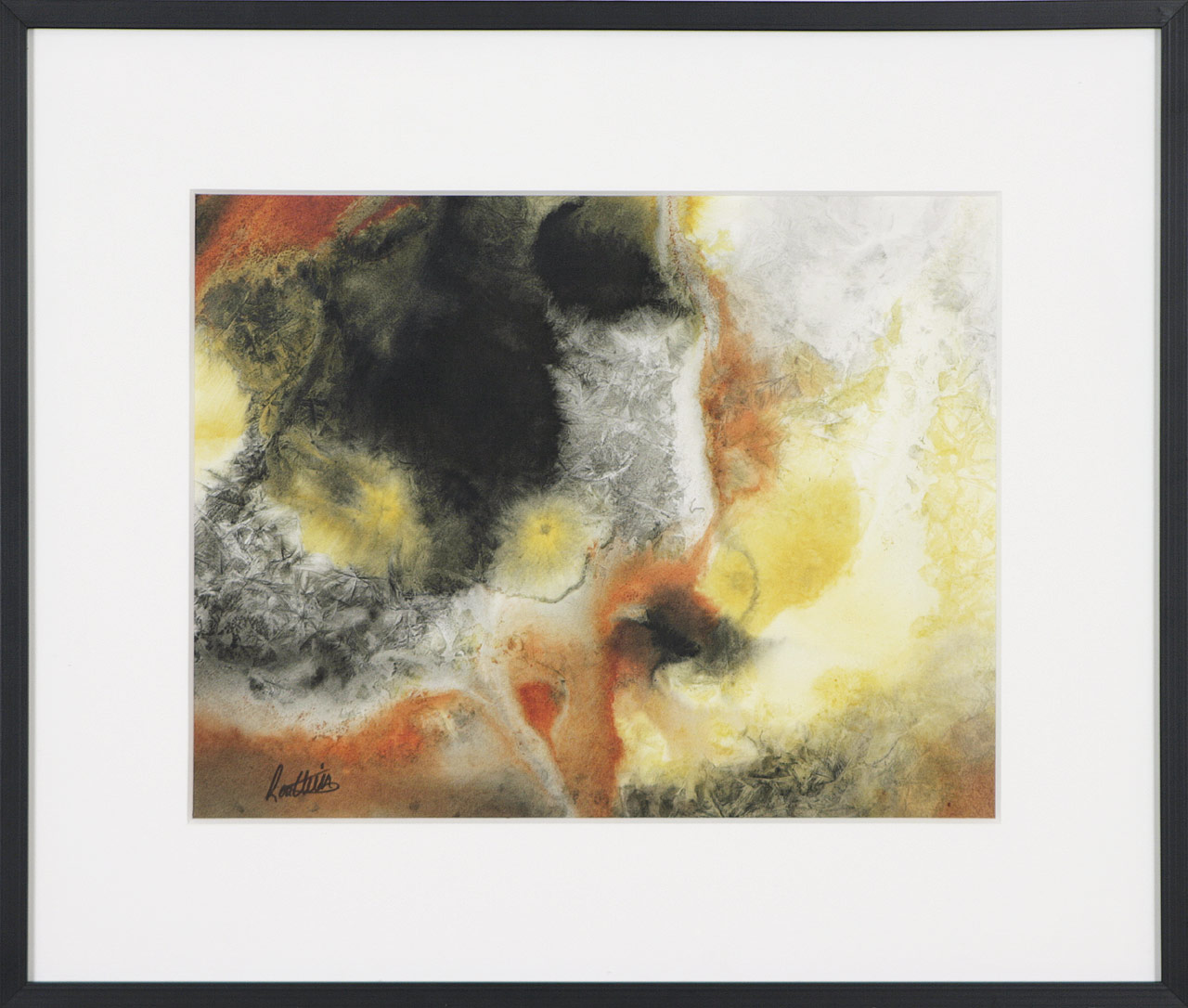À Memphis, aux États-Unis, un magasin Sears abandonné depuis de nombreuses décennies a été transformé en village vertical. Sur ses 1,1 million de pieds carrés, on retrouve dorénavant appartements, espaces de travail, restaurants et encore plus!
Baptisé Crosstown Concourse, cet immeuble érigé en 1927 abritait un des premiers magasins Sears. Tous les jours, 1500 personnes venaient travailler dans cet immense édifice art déco qui servait également de centre de distribution. Laissé à l’abandon depuis sa fermeture, l’édifice a été complètement revampé par la firme canadienne d’architecture DIALOG. Sa résurrection est vraiment inspirante.

Il y avait 20 ans que les habitants de Memphis espéraient revoir de la vie dans l’immense édifice historique. Au fil des ans, de nombreux projets ont été élaborés. Cependant, aucun n’a vu le jour. Plutôt que de baisser les bras, les citoyens de Memphis ont décidé de prendre les choses en main. Ainsi, au terme de nombreuses discussions entre citoyens, fonctionnaires de la ville et designers, il a été décidé que l’ancien magasin Sears serait transformé en village vertical.

Qu’est-ce qu’un village vertical?
Un village vertical est un complexe immobilier où l’on retrouve sous un même toit plusieurs services, allant des espaces de bureau aux condos. «Au-delà du concept d’utilisation mixte, où divers locataires se partagent simplement l’espace, Crosstown Concourse est un endroit où les lieux et les utilisations uniques sont intimement liés, interconnectés et interdépendants et, par conséquent, mieux parce qu’ils sont ensemble», peut-on lire sur le site Internet de Crosstown Concourse.

Un design adapté aux idées
Ainsi, le design des nouveaux espaces de cet édifice historique de Memphis a été conçu en fonction de cet aspect de communauté. Tout a été pensé pour encourager les échanges, autant économiques que sociaux. «Crosstown est le produit d’un nouveau rêve américain: pas pour "moi", mais pour "nous"», mentionnent les architectes derrière le projet.

L’espace abrite notamment un centre de traitement pour le cancer, des jardins communautaires, une salle de spectacle de 500 places, l’école secondaire du quartier et des espaces de bureaux. On compte également 270 résidences privées, où les murs de briques et les planchers de béton sont à l’honneur. Selon les prévisions, 3000 personnes – professeurs, étudiants, médecins, patients, artistes, entrepreneurs – devraient passer par Crosstown Concourse tous les jours.

Voilà un exemple inspirant qui pourra peut-être donner des idées à des entrepreneurs qui cherchent encore quoi faire avec l’ancien aéroport de Mirabel.