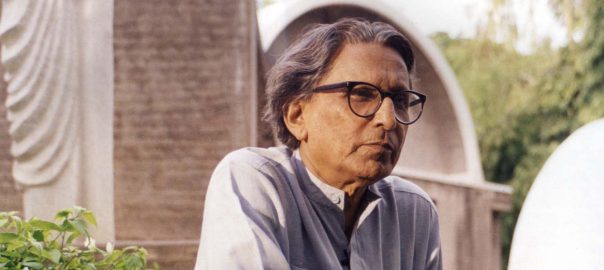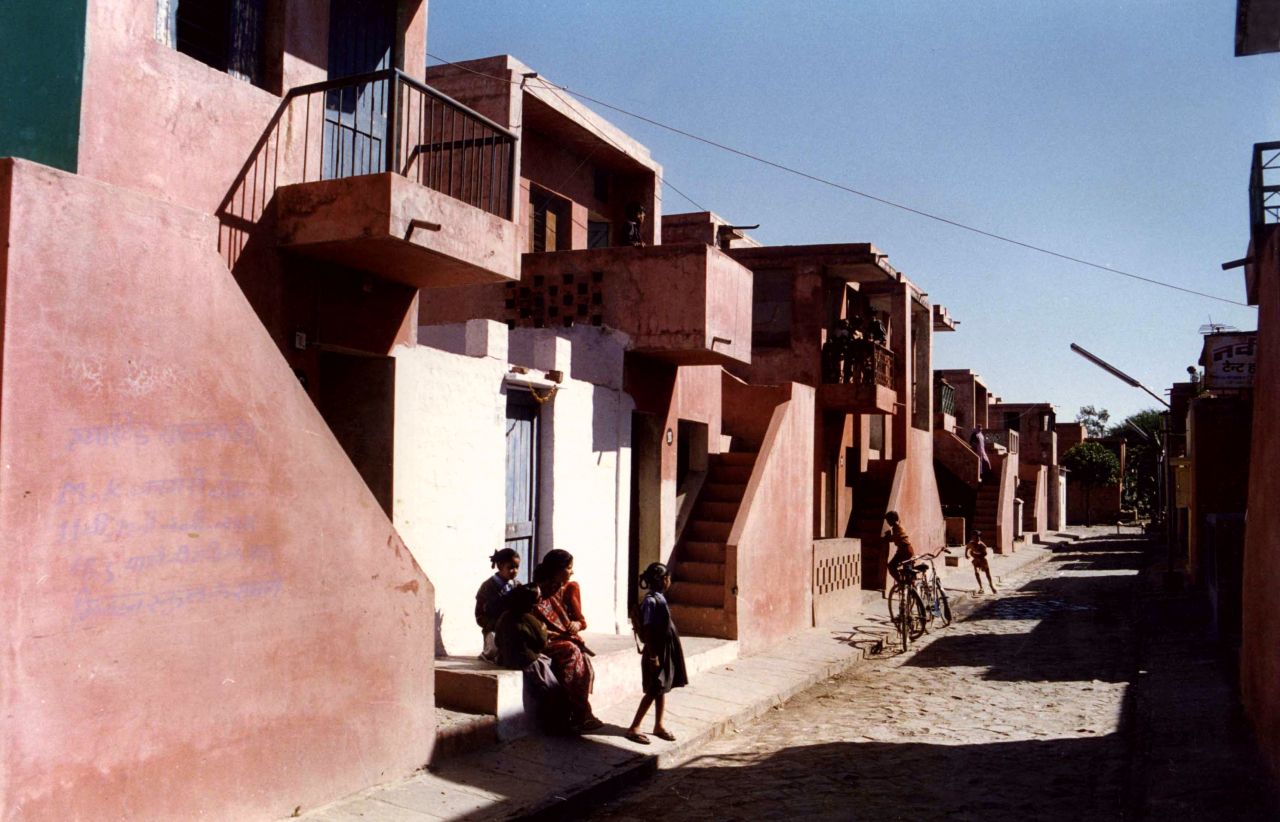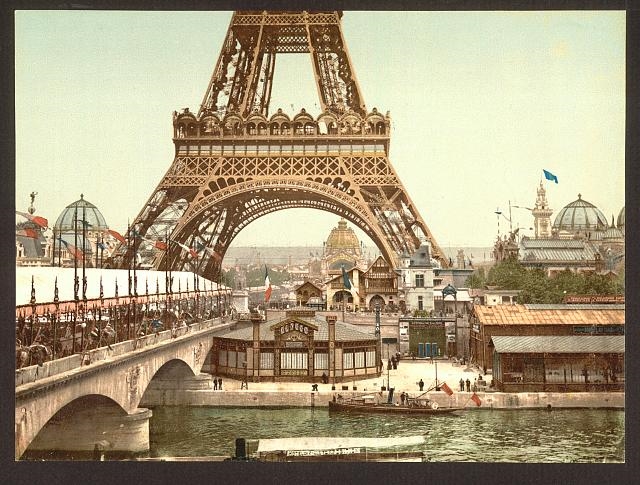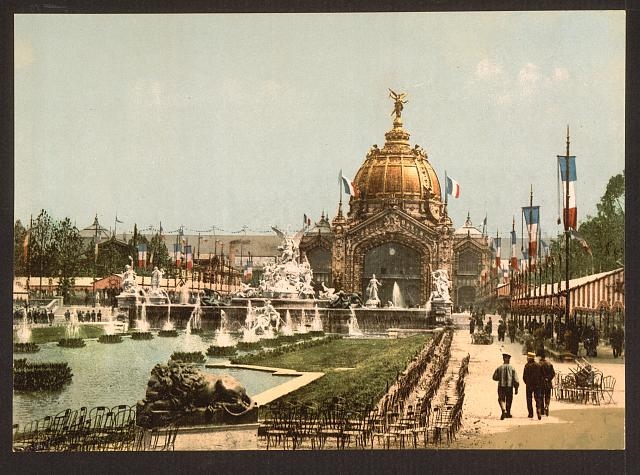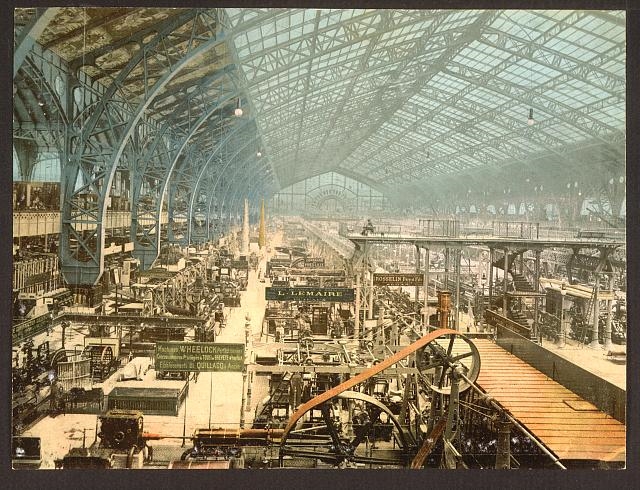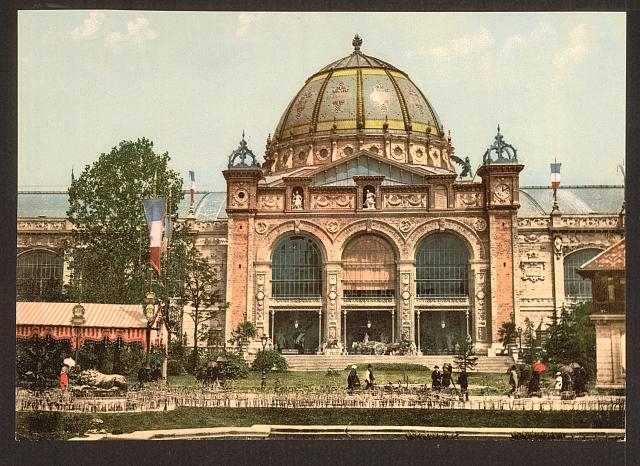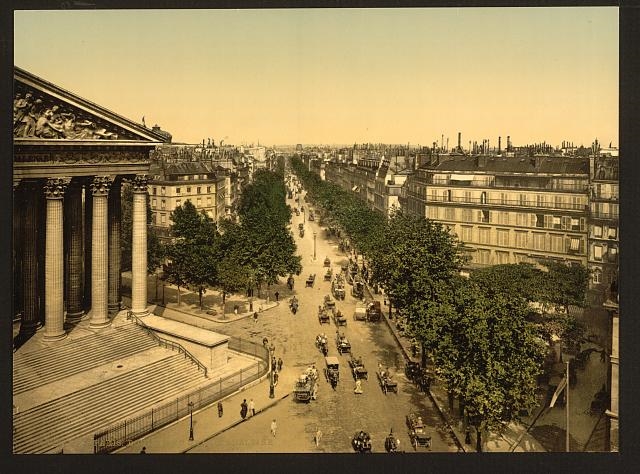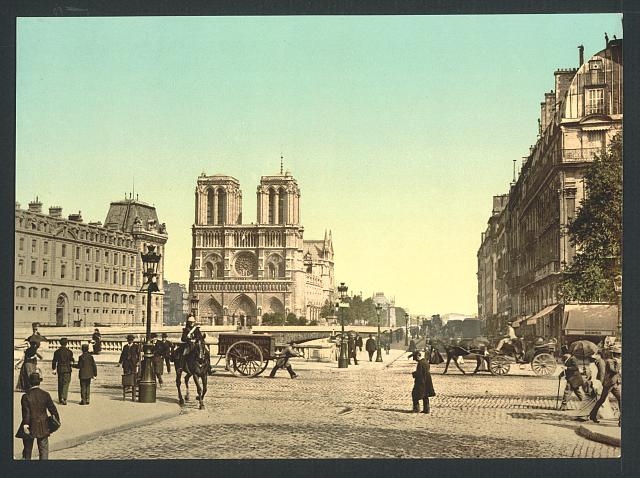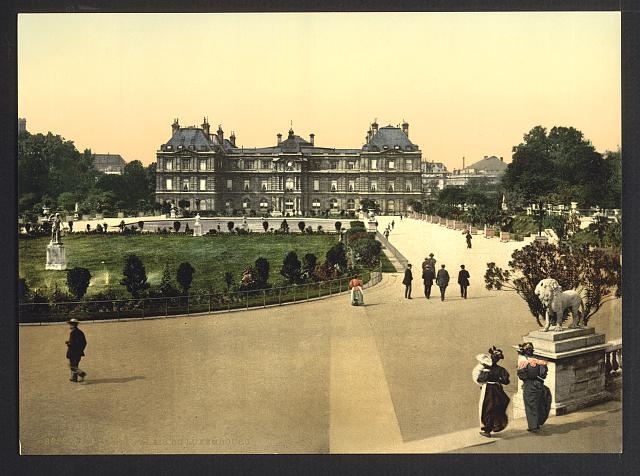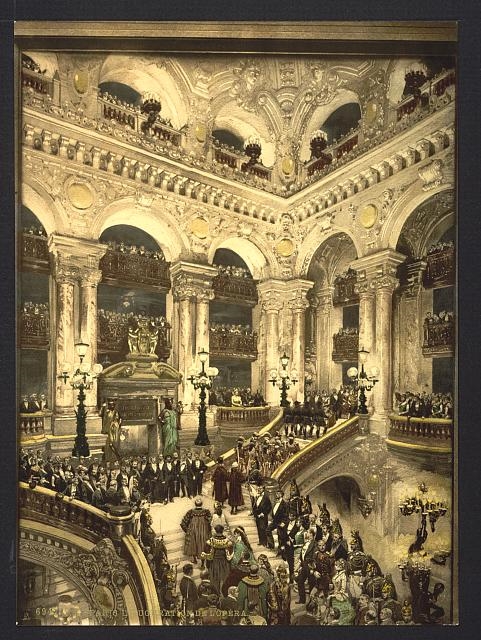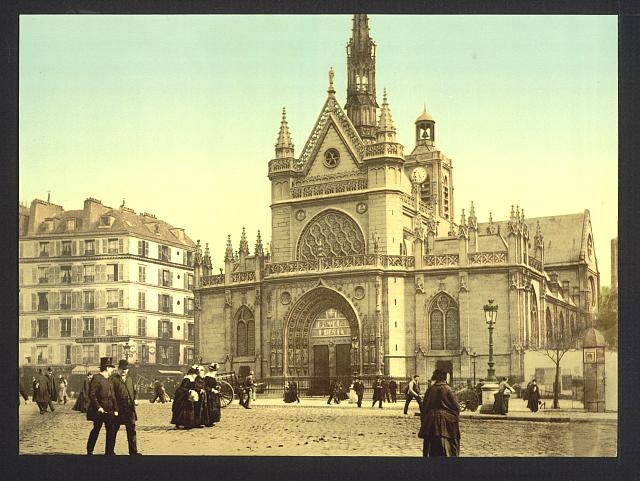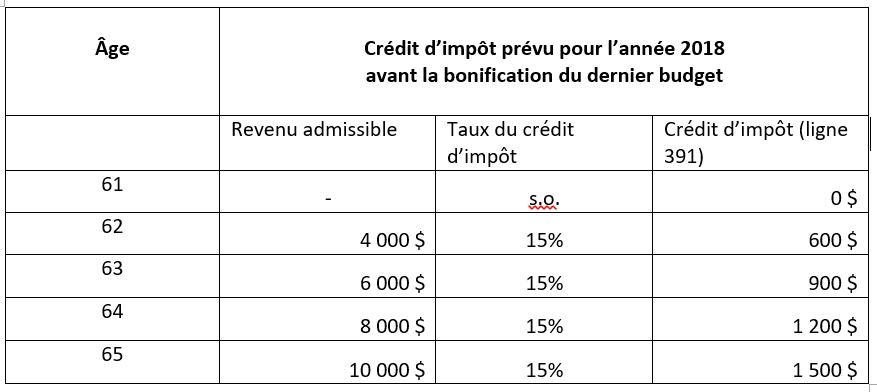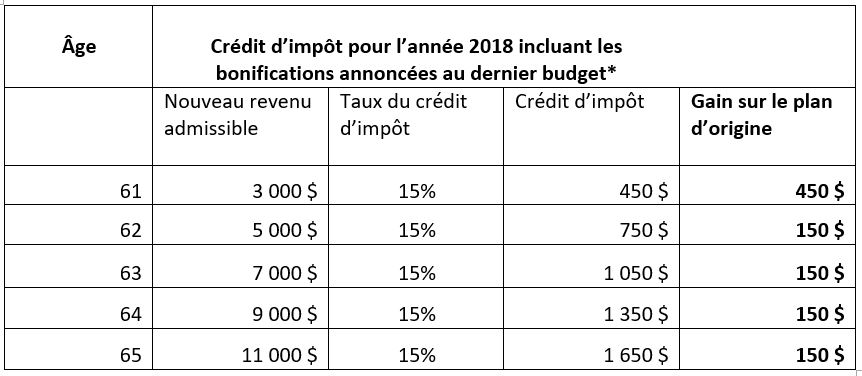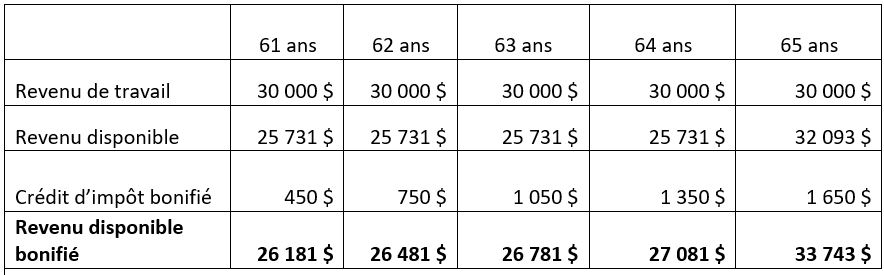Il s’est dit bien des choses ces derniers jours sur la nouvelle et première politique bioalimentaire québécoise. Mais concrètement, que changera-t-elle pour vous?
C’est le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) de l'époque, Pierre Paradis, qui a lancé en 2015 le projet de cette première politique bioalimentaire qui couvre la période 2018-2025.
Depuis, des rencontres sectorielles et un sommet de l’alimentation (qui a eu lieu en novembre dernier) ont donné la parole aux consommateurs, aux agriculteurs et aux représentants de l’industrie de la pêche, de la transformation alimentaire, de la distribution et de la restauration.
Par ces rassemblements, on cherchait à connaître l’avis des Québécois pour une amélioration du secteur bioalimentaire. Cette industrie, qui représente 7,5% du PIB du Québec, est décrite comme l’ensemble des activités économiques reliées à la production agricole, aux pêches et à l’aquaculture, à la transformation des aliments et des boissons, au commerce de ces produits ainsi qu’à la restauration. Bref, elle rassemble pas mal tous les secteurs reliés à l’alimentation.
Le 6 avril, donc, après près de deux ans de consultations, la politique bioalimentaire québécoise, nommée Alimenter notre monde, a été dévoilée au public sur une ferme de l’île Perrot. C’est Laurent Lessard, ministre actuel de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, ainsi que le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, qui en ont fait l’annonce. Aussi, pour s’assurer que la politique sera à l’abri de toute partisanerie, le MAPAQ entend déposer rapidement un projet de loi qui permettra de conserver le plan même en cas de changement de gouvernement.
Accompagnée d’investissements de 5 milliards $ sur cinq ans, la politique, qui contient quatre grandes orientations et sept cibles, a pour objectif principal de mieux répondre aux attentes des consommateurs tout en soutenant mieux les entrepreneurs et les organismes du secteur alimentaire afin de favoriser les produits québécois.
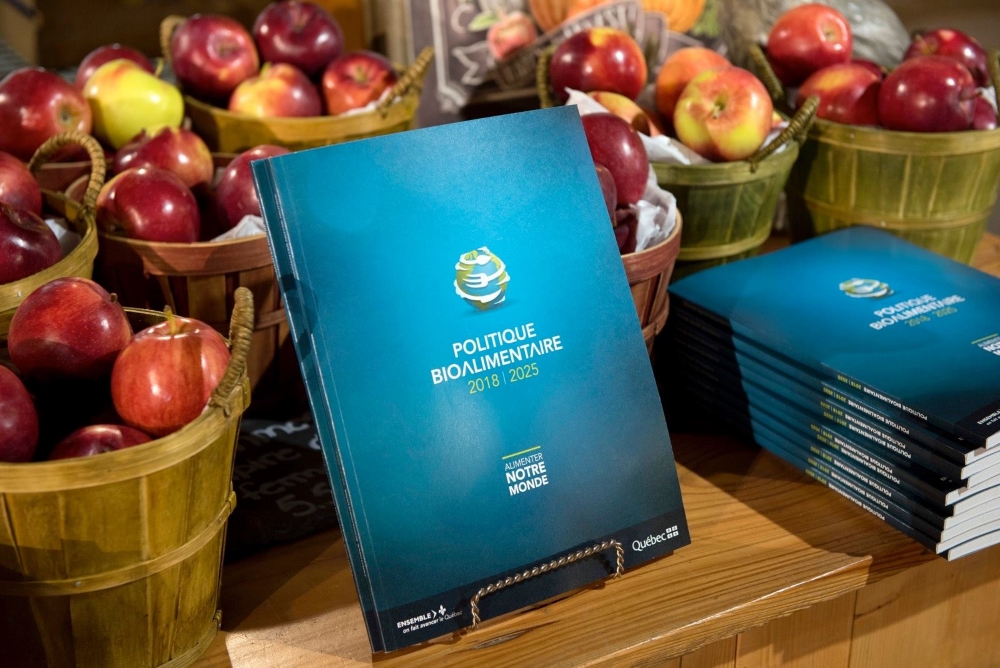
Ce que veulent les Québécois
Mais quelles sont donc ces attentes des consommateurs qui ont guidé l’élaboration de la politique et auxquelles souhaite répondre le gouvernement?
Selon les consultations, les Québécois demandaient entre autres choses davantage d’aliments sains et biologiques, plus d’aliments québécois dans les épiceries, un plus grand respect des normes en ce qui a trait au bien-être animal et à l’environnement ainsi qu’un meilleur soutien à la relève.
Ainsi, parmi les sept cibles à atteindre d’ici cinq ans, on retrouve entre autres celle d’ajouter 10 milliards $ de contenu québécois dans les produits bioalimentaires achetés au Québec en soutenant une plus grande offre de produits locaux dans les épiceries et les institutions publiques.
On veut aussi augmenter la part des entreprises agricoles et de transformation alimentaire québécoises implantant des pratiques d’affaires responsables.
La politique entend aussi doubler la superficie du territoire québécois dédiée à la production biologique afin de la mener à 4,8%. De ce côté, on entend aussi assurer une vérification serrée des certifications.
Toujours en réponse aux demandes des Québécois, la politique entend encourager l’amélioration de la valeur nutritive des aliments transformés au Québec, dans lesquels on devrait désormais trouver moins de sel, de sucre et de gras saturé.
Puis, en matière d’exportation, le gouvernement souhaite soutenir davantage les grandes entreprises qui vendent à l’étranger des aliments québécois comme le sirop d’érable, la canneberge, le bleuet, le homard ou le cidre.

Réactions partagées
Concrètement, le premier ministre Philippe Couillard a parlé de la nouvelle politique en ces termes: «On va encore plus manger des produits de chez nous. On va encore plus savoir d’où ils viennent. On va mieux connaître nos producteurs et nos enfants vont avoir contact avec des produits québécois dès la petite enfance».
Plus de produits québécois dans nos assiettes, une meilleure mise en valeur des aliments locaux chez les épiciers, plus de territoire dédié à la production biologique et un meilleur financement pour l’industrie alimentaire d’ici entre autres promesses: voilà qui semble positif. Pourtant, quelques jours après son dévoilement, la politique bioalimentaire suscite des réactions mitigées.
Si presque tout le monde salue les intentions louables du gouvernement avec cette première politique du genre, certains, comme Roméo Bouchard, cofondateur de l’Union paysanne, croient que la politique bioalimentaire aurait dû aller plus loin. Ce dernier pointe surtout du doigt le statu quo des lois faites pour les gros producteurs au détriment des petits, croit que l’objectif relié à l’agriculture biologique aurait pu être plus ambitieux et dénonce l’absence d’intentions reliées au zonage agricole, qui empêche les agriculteurs artisans d’avoir un atelier de transformation sur leur ferme ou une table champêtre, par exemple, ce qui nuit d’après lui au «développement d’une agriculture de proximité, locale, autosuffisante».
D’autres, comme le président de l’Union des producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent, Gilbert Marquis, auraient souhaité que le gouvernement aille plus loin en imposant des mesures concrètes pour faciliter le transfert des entreprises.
De son côté, dans sa revue de la politique bioalimentaire, le journaliste Errol Duchaine dénonce l’absence d’intentions reliées à la surveillance des OGM ainsi qu’à la modification des quotas pour les petits agriculteurs. Il doute aussi des résultats de la politique puisque, selon lui, il y a beaucoup d’intentions intéressantes, mais peu d’engagements clairs.
C’est d’ailleurs ce qui ressort chez plusieurs intervenants qui ont donné leur avis au cours des derniers jours. On s’attendait à beaucoup de cette nouvelle politique, accueillie finalement avec prudence. Parce que si les intentions sont bonnes, selon plusieurs, vaut mieux attendre de voir si les moyens suivront avant de se réjouir.