Ma langue française
Il y a de ces jours où j’ai l’impression de me l’être collée sur un poteau extérieur par moins vingt tant ma langue française me saisit et m’obsède. La vôtre, celle des journalistes, des auteurs, des chanteurs, de mes proches, des vendeurs, des serveurs, des éducatrices à la garderie de ma fille, la sienne qu’elle apprend à tâtons, bien sûr la mienne, mon outil de travail et ma source d’angoisse infinie; la pire étant celle d’échapper un malencontreux «si j’aurais» en ondes et de voir ma page Facebook inondée d’insultes. Si ça m’arriverait (!!!), je n’en dormirais plus.
 Je fais partie de celles et ceux qui appellent les patrons des boutiques de l’avenue du Mont-Royal après avoir été servie «in English only», ou qui changent de restaurant dans le Mile-End, à Sherbrooke ou à Kirkland si le serveur ne se force pas pour me parler dans ma langue de naissance. Quand je sors de ma province, c’est une autre affaire, mais au Québec, ça doit se passer en français. D’abord. Ce qui ne signifie pas exclusivement, pour faire écho aux propos du journaliste Marc Cassivi dans Mauvaise langue, un essai qui paraît ces jours-ci aux éditions Somme toute et dans lequel il défend entre autres l’idée qu’une langue n’est pas une prison, qu’il faut la protéger, certes, sans refuser obstinément l’anglais.
Je fais partie de celles et ceux qui appellent les patrons des boutiques de l’avenue du Mont-Royal après avoir été servie «in English only», ou qui changent de restaurant dans le Mile-End, à Sherbrooke ou à Kirkland si le serveur ne se force pas pour me parler dans ma langue de naissance. Quand je sors de ma province, c’est une autre affaire, mais au Québec, ça doit se passer en français. D’abord. Ce qui ne signifie pas exclusivement, pour faire écho aux propos du journaliste Marc Cassivi dans Mauvaise langue, un essai qui paraît ces jours-ci aux éditions Somme toute et dans lequel il défend entre autres l’idée qu’une langue n’est pas une prison, qu’il faut la protéger, certes, sans refuser obstinément l’anglais.
Cette «prison» dont parle Cassivi, je l’ai côtoyée de près en grandissant à Sainte-Julie, ville dortoir jadis proclamée «du bonheur», située sur la Rive-Sud de Montréal et où, dans les années 80 jusqu’au début des années 90, quand un jeune parlait anglais sur la rue, on le regardait les yeux grands ouverts comme s’il débarquait de Mars. Les plus curieux voulaient se coller à lui parce qu’il était singulier, original et fascinant. Les obtus élevés par des obtus aux œillères bétonnées les fuyaient, apeurés, comme ils le faisaient d’ailleurs avec le seul Haïtien du coin ou cet enfant originaire de la Chine, adopté par la voisine du bout de la rue. Ceux qui n’étaient pas des Caucasiens francophones passaient pour des «étranges», au même titre que ceux qui parlaient un français international passaient pour des snobs… Je m’en souviens, je me forçais pour sacrer un peu par-ci par-là parce que, déjà que je lisais beaucoup, ça paraissait mal auprès des petits Tremblay-Côté-Dalpé-Dumais, entre deux parties de billes dans la cour de récré.
L’enfer c’est l’autre langue
«Je n’apprendrai rien à personne: ce n’est pas en s’empêchant d’apprendre correctement une autre langue, et en se refusant précisément l’apprentissage de l’anglais, que l’on assurera collectivement, d’une quelconque façon, la survie du français. […] Les linguistes s’entendent d’ailleurs pour dire que l’on défend mieux sa langue lorsqu’on en parle une autre. La preuve étant, selon le linguiste Alain Rey, père du Petit Robert et auteur du Dictionnaire historique de la langue française, que ce sont les traducteurs qui utilisent le moins d’anglicismes…», exprime Cassivi dans Mauvaise langue.
Chez nous, l’anglais, on l’apprenait dans les cours obligatoires à l’école et c’était à peu près tout. Les plus chanceux regardaient Sesame Street ou Degrassi en anglais, et les plus «en moyens» fréquentaient des camps anglophones dans l’espoir de devenir bilingues un jour parce que ça allait être très «pratique», voire essentiel une fois sur le marché du travail dans les années 2000. Si j’avais été moins paresseuse, aujourd’hui, je serais aussi bonne que mes collègues journalistes et auteurs qui peuvent accepter des contrats dans les deux langues. Certains font même de la traduction. Je les envie, parce que mon anglais est boiteux pas à peu près et j’en ai honte. Honte comme ça ne se peut pas. Je suis honteuse plus que hargneuse envers les anglophones de Montréal, que j’adore côtoyer, surtout quand nous sommes chacun de notre côté à chercher à parler la langue de l’autre, à se faire comprendre, à s’aider au détour d’une phrase. En parlant anglais avec des amis anglophones qui font partie de ceux qui s'efforcent de parler français, je n’ai jamais l’impression de tromper ma langue maternelle. Je n’ai pas l’impression de la tromper quand j’écoute Arcade Fire ou quand je lis The Gazette ou quand je laisse mon enfant écouter Peppa Pig en anglais.
Là où ça dérape…
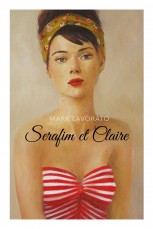 Or, là où j’ai l’impression de la tromper, cette langue française héritée de mes ancêtres, c’est quand, à table par exemple, tous les convives se mettent à parler exclusivement anglais parce qu’il y a un invité, souvent un seul, qui parle la langue de Shakespeare. Aussi, il m’est arrivé de sentir le mépris d’anglo-montréalais à mon endroit en m’entendant parler français à Westmount. J’en ai entendu me désigner comme «The French Girl» et le prononcer avec dédain. J’ai alors repensé au clivage important au Québec d’avant la Révolution tranquille, et même un peu après, entre les anglos et les francos à Montréal. Les grands patrons anglos et les «petits» employés d’usine, des francos, qui se faisaient souvent traiter comme du bétail. C’est arrivé à mon grand-père maternel, un travailleur autodidacte sans instruction né d’une mère célibataire italienne qui l’a donné en adoption en immigrant au Québec en 1929… Ces éléments méprisants pas glorieux de notre Histoire me touchent et me font mal. Je pense qu’il ne faut pas les perdre de vue non plus en refusant cette «prison» langagière dont parle Cassivi. Ce fossé important, qui a existé et qu’on ne peut oublier, est d’ailleurs admirablement mis de l’avant dans le nouveau roman Serafim et Claire de Mark Lavorato, un écrivain albertain installé depuis quelques années avec amour et fierté sur le Plateau Mont-Royal de Michel Tremblay.
Or, là où j’ai l’impression de la tromper, cette langue française héritée de mes ancêtres, c’est quand, à table par exemple, tous les convives se mettent à parler exclusivement anglais parce qu’il y a un invité, souvent un seul, qui parle la langue de Shakespeare. Aussi, il m’est arrivé de sentir le mépris d’anglo-montréalais à mon endroit en m’entendant parler français à Westmount. J’en ai entendu me désigner comme «The French Girl» et le prononcer avec dédain. J’ai alors repensé au clivage important au Québec d’avant la Révolution tranquille, et même un peu après, entre les anglos et les francos à Montréal. Les grands patrons anglos et les «petits» employés d’usine, des francos, qui se faisaient souvent traiter comme du bétail. C’est arrivé à mon grand-père maternel, un travailleur autodidacte sans instruction né d’une mère célibataire italienne qui l’a donné en adoption en immigrant au Québec en 1929… Ces éléments méprisants pas glorieux de notre Histoire me touchent et me font mal. Je pense qu’il ne faut pas les perdre de vue non plus en refusant cette «prison» langagière dont parle Cassivi. Ce fossé important, qui a existé et qu’on ne peut oublier, est d’ailleurs admirablement mis de l’avant dans le nouveau roman Serafim et Claire de Mark Lavorato, un écrivain albertain installé depuis quelques années avec amour et fierté sur le Plateau Mont-Royal de Michel Tremblay.
J’ai honte aussi de la manière dont on malmène ma langue quand je suis complice d’une amie qui parle à la française pour ne pas faire rire d’elle avec son accent québécois en France, ou quand j’entends des personnalités publiques forcer un accent français prétentieux dans les médias pour faire leurs grands brillants. Je n’ai jamais eu honte de mon accent, encore moins de mes expressions tirées de la langue vernaculaire. Chaque fois que je les emploie, elles sont spontanées, senties, précises, et expriment une pensée. Elles ne sont pas bâclées ou irrespectueuses, ou signe d’inculture. Je rejoins d’ailleurs Cassivi quand il écrit: «Ce qui me choque bien davantage qu’un Français qui ridiculise l’accent québécois, c’est un Québécois qui rougit de l’accent québécois en France.» Ainsi, qu’un Français rie de mon accent, pfffff, selon moi, c’est rétrograde et sans originalité. Que ces moqueurs qui parlent si bien le vrai français (…) se mettent donc à nous lire plus en ouvrant les romans de nos auteurs d’ici, notamment cette Erika Soucy dont je parle beaucoup ces jours-ci parce qu’elle ose, dans Les Murailles, un premier roman, cette oralité que «les curés aux oreilles écorchées» dont parle Cassivi n’apprécieraient pas. Ceux-là mêmes qui critiquent le joual des personnages des films de Xavier Dolan, le chiac de Lisa LeBlanc ou les expressions du terroir des contes de Fred Pellerin. Ce n’est pas parce qu’on ne parle pas tous un français «international» que nous ne protégeons pas notre langue de Molière, bien au contraire! Et ce n’est certainement pas dans ce français normatif que ces artistes, mais aussi d’autres comme Marie-Jo Thério, Véronic Dicaire, Ariane Moffat ou Julie Snyder se sont un jour fait remarquer en France…
À grands coups de «buck» dans le «pick-up»
 Pour en revenir à Erika Soucy, poète et fondatrice du Off Festival de poésie de Trois-Rivières, je n’ai pas l’impression que son premier roman, dans lequel elle décrit notamment le quotidien d’hommes de bras sur le chantier de La Romaine, sur la Côte-Nord, à grands coups de «frette», «amanché», «icitte», «break», «buck», «hood» ou «pick-up», insulte ma langue maternelle ou lui nuit, bien au contraire. J’ai plutôt l’impression qu’en jouant avec cette langue, qu’en la triturant, qu’en lui donnant cette couleur typique et sincère des conversations des terres du Québec, qu’en le faisant d’ailleurs avec style, poésie et acuité, elle lui fait une fleur, à cette langue, et c’est toute une fleur de lys bleue, sans chercher à tout prix à singer une langue qui ne serait aucunement fidèle au réel discours culturel entendu.
Pour en revenir à Erika Soucy, poète et fondatrice du Off Festival de poésie de Trois-Rivières, je n’ai pas l’impression que son premier roman, dans lequel elle décrit notamment le quotidien d’hommes de bras sur le chantier de La Romaine, sur la Côte-Nord, à grands coups de «frette», «amanché», «icitte», «break», «buck», «hood» ou «pick-up», insulte ma langue maternelle ou lui nuit, bien au contraire. J’ai plutôt l’impression qu’en jouant avec cette langue, qu’en la triturant, qu’en lui donnant cette couleur typique et sincère des conversations des terres du Québec, qu’en le faisant d’ailleurs avec style, poésie et acuité, elle lui fait une fleur, à cette langue, et c’est toute une fleur de lys bleue, sans chercher à tout prix à singer une langue qui ne serait aucunement fidèle au réel discours culturel entendu.
La langue se doit d’être libre d’emprunter à d’autres en devenant parfois ce «franglais» dont parle Cassivi, d’être texturée, ouverte et unique, ce qui ne veut pas dire d’employer «si j’aurais», d’écrire au son des textes bourrés de fautes d’orthographe. Entre les deux, il y a des nuances à faire. C’est en restant libre que notre langue sera la plus forte, qu’elle se démarquera, c’est si elle reste libre que jamais nous n’aurons envie de l’ensevelir sous d’autres plus puissantes. Les créateurs d’ici qui se servent de cette langue comme terrain de jeux, sans l’emprisonner dans un carcan de rectitude langagière, doivent être encouragés et non pas vilipendés. Voyons-les comme des veilleurs ou des gardiens de notre culture et non comme des traîtres à la nation. Alors, oui, protégeons notre français d’ici, parlons-le, écrivons-le, défendons-le, et faisons-le dans le respect de ce qu’elle est à Montréal, La Romaine, Saint-Lin ou Chibougamau, sans chercher à le faire entrer dans un moule si étouffant qu’on risque d’imploser.
JE CRAQUE POUR…
WDIT (We Do It Together), la nouvelle société de production fondée par les actrices Jessica Chastain, Juliette Binoche, Queen Latifah et Freida Pinto visant le financement et la production de films changeant l’image des femmes à l’écran. Exit ces rôles féminins qui sont sexistes, clichés, méprisants, dans la nudité gratuite, alléluia… L’organisation à but non lucratif est en processus de financement. Ira-t-elle demander des sous à notre ministre Thériault? C’est au Festival de Cannes que seront annoncés des détails sur leur premier film. À suivre!


