Il faudrait ralentir
Il faudrait ralentir au boulot. Je me répète ces mots chaque jour de ma vie. Depuis peu d’ailleurs, sorte de nouveau leitmotiv; faute de tenir la cadence comme à 30 ans, en en voyant s’éteindre autour aussi, certains dans la fleur de l’âge auxquels je m’identifiais...
On est plusieurs à prendre le rythme accéléré sans trop se demander pourquoi; sans doute parce qu’après tout, il faut redoubler d’ardeur pour payer le fameux panier à la consommation et le toit qu’on a sur la tête, toujours plus cher lui aussi.
Travailler aussi parce que refuser, dire non, c’est souvent ardu, c’est piler sur des convictions profondément ancrées. Puis, comme souvent, des livres tombent à point, véritable oracles, faute de croire en autre chose. Depuis toujours nous aimons les dimanches (Seuil), nouveauté de la grande Lydie Salvayre en fait partie et c’est aussi devenu cette «Bible» de complicité rassurante sur mes envies polissonnes de farniente.
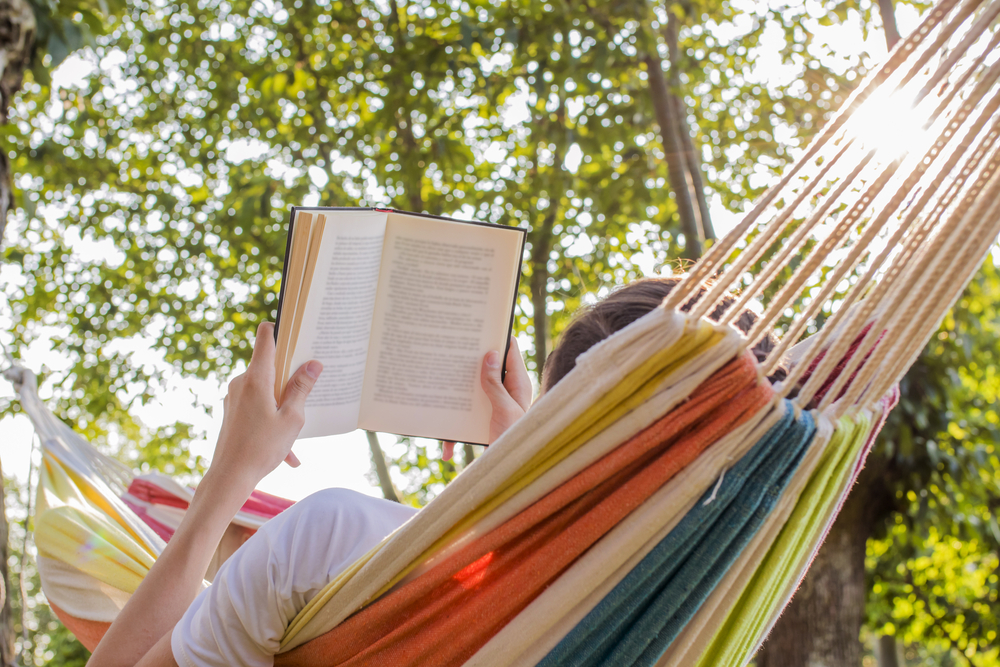
D’abord, cette épigraphe choisie par l’écrivaine: «Le travail est un trésor. Le travail des autres, cela va de soi.» Cette citation d’Henri Jeanson donne le ton en faisant sourire, il va sans dire, à cette sorte d’éloge de la paresse sur laquelle philosophe Salvayre, 78 ans, qui a été psychiatre avant de se consacrer à l’écriture, notamment du très beau Pas pleurer qui a remporté le Goncourt en 2014.
Bien sûr que j’ai la fâcheuse tendance à juger ceux qui choisissent l’arrêt, la lenteur et qui osent dire NON, que ça a assez duré pour la besogne acharnée. Au fond, je dois les envier parce que je n’y arrive pas tant. Quand j’arrête, je culpabilise et j’ai honte, si bien que je me dis que je suis plus malheureuse en refusant qu’en acceptant de suivre le troupeau crasse des workaholiques.
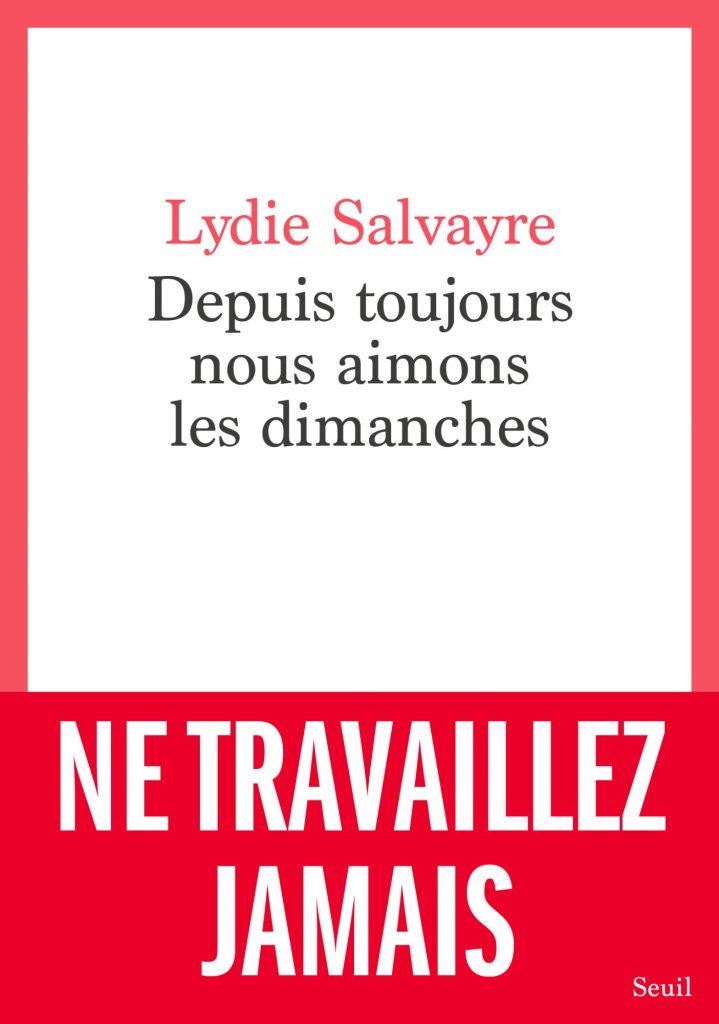
A contrario, je m’entends dire aux proches surmenés de prendre du temps pour eux. «Car vous l’aurez compris, dans la situation actuelle, paresser c’est désobéir, c’est ne plus s’évertuer à donner adroitement le change, c’est trahir le modèle conforme auquel on se croit tenu […] c’est rompre l’enchaînement implacable des jours qui situe le dimanche tout au bout du tunnel de la semaine […]», écrit Salvayre.
Selon une Enquête québécoise de 2022 sur la parentalité recensée dans Naître et grandir, 48% des parents ont fréquemment l’impression de courir toute la journée pour accomplir tout ce qu’ils ont à faire, et 36% disent n’avoir jamais ou rarement de temps libre pour eux. Il faudrait donc attendre que les enfants vieillissent tout en rêvant à la retraite, si elle s’avère un jour possible? C’est quand même absurde.
Quant à ce fameux équilibre auquel on devrait accéder, sorte de Saint-Graal du mieux-vivre, je serais curieuse de savoir où il se situe dans la vie réelle, parce que le maintenir est bien illusoire. Lui et ses injonctions sociales: faire de l’exercice physique, manger mieux, moins boire d’alcool, voire pas pantoute, couper le sucre, les écrans, tralalalalère. Et le plaisir dans tout ça? Il paraît qu’il est aussi préférable d’être heureux.
Puis dans sa suite d’odes aux vertus du «glandage», Salvayre le claironne admirablement; ne rien faire, ce n’est pas rien faire! Ne serait-ce que parce que la pensée, elle, continue à se mouvoir, à créer, à donner du sens à ce qui nous entoure, à faire de l’espace pour des idées, certaines qui pourraient être fort profitables pour le travail même! Voilà un raisonnement abstrait qui risque d’en faire tiquer plus d’un et dont Salvayre se moque joyeusement.
Alors, à qui la faute? C’est ici que je trouve l’auteure la plus juste et forte, quand elle affirme que cette «paresse», terme plein de connotations perverses d’après plusieurs, représente surtout «une abominable menace pour les biens amassés par les apologistes-du-travail-des-autres, biens essentiellement destinés à instruire le monde de la hauteur où ils perchent.»
Un propos qui rejoint l’épatant essai de Dahlia Namian intitulé La société de provocation – Essai sur l’obscénité des riches (Lux). À son tour, Namian pointe du doigt ces beaux «perchés» dans leurs yachts, leur provision d’amis célèbres, leur troupeau de domestiques, leurs multinationales géantes, leurs avions privés… Des «dépouilleurs de pauvres», «cleptocrates» qui se dispensent eux-mêmes du travail pour s’adonner à leurs bons plaisirs, scande-t-elle, en rajoutant en citant la thèse de 1932, Éloge de l’oisiveté, de Bertrand Russel qui soutien que «la somme de travail requise pour procurer les choses indispensables à la vie pourrait très bien se limiter à quatre heures par jour.» Quatre heures. Pas plus.
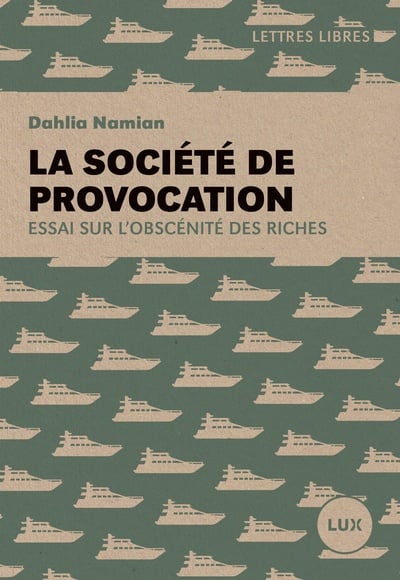
Bien sûr que ce projet-là qu’elle décrit comme «économiquement viable» nuirait aux intérêts des très riches. Comme ils ont la puissance, ce plan risque de demeurer utopique de notre vivant. À moins d’une révolte collective initiée notamment par des livres comme ceux cités ci-haut, ne serait-ce qu’en servant à allumer l’étincelle qui pourrait faire tout sauter.
Je ne voudrais pas inciter à la haine. Il fait beau et chaud. C’est du moins ce qu’on attend normalement de l’été à nos portes. Sous peu, on pourra faire de nos vacances méritées des dimanches qui ne finissent pas. Or, on le sait bien, un jour, reviendra le lundi... Et ça recommencera. Ainsi soit-il. À moins peut-être de se rebeller chacun à sa manière, à l’initiative de cet essai comique sur fond de sérieux, et d’autres aussi que je vois de plus en plus apparaître en librairie et qui prônent le ralentissement, le refus d’en prendre plus, la dénonciation de ceux qui se prélassent au profit des travailleurs.
J’aime donc ces «délinquances» et les autres qui marquent une opposition à ce qu’on attend de nous; bonnes petites bêtes de somme. J’en fais l’apologie depuis peu. J’espère tenir mes résolutions, délinquer, en convaincre d’autres. Soyons fous, ne serait-ce que pour voir tous ensemble ce que ça donnerait.


