Vu: le filmSolo. Lu: Roger Frappier, Oser le cinéma québécois
Cette semaine, notre chroniqueur Claude Deschênes a vu le film de Sophie Dupuis, Solo, et lu le livre Roger Frappier, Oser le cinéma québécois de Denis Monière. Voici ce qu'il en a pensé.
Solo: j’ai deux amours
Cinquante ans après la création de la pièce Hosanna de Michel Tremblay au Théâtre de Quat’sous, un film québécois qui se passe dans le même univers des cabarets de drag queens débarque sur nos écrans cette semaine. Là où Tremblay nous servait une œuvre coup de poing révélant un monde qui nous était alors inconnu, Solo de Sophie Dupuis nous arrive à une époque où les «personnificateurs de femmes» sont les queens of the day, pour reprendre une chanson entendue dans le film.
Solo, c’est l’histoire de Simon. On comprend qu’il gagne sa vie comme maquilleur le jour et on constate qu’il consacre ses nuits à jouer les femmes fatales dans un cabaret de drag queens. Il est très proche de sa sœur couturière et idéalise sa mère chanteuse d’opéra qu’il ne voit guère depuis 15 ans puisqu’elle mène une carrière retentissante en France.

Arrive Olivier dans la vie de Simon. Coup de foudre pour ce Français qui a tout plaqué pour recommencer à zéro à Montréal.
Comme la Hosanna de Tremblay, Simon trippe fort dans sa tête. Il monte des duos drags avec son nouveau chum, avec des costumes, des maquillages, des chansons toujours plus flamboyants. Il rêve au moment où sa mère viendra le surprendre dans toute sa splendeur «cléopatrienne».

Mais un jour, la réalité le rattrape. Il a deux amours, mais ils sont sans retour. La compétition et la jalousie s’installent entre lui et Oli. Sa mère, dont il peine à se rapprocher, consent à venir le voir, mais assiste à sa déconfiture un soir de honte digne du drame d’Hosanna. Même sa sœur lui échappe.
Tout ce récit est défendu par d’excellents comédiens. Dans le rôle principal, Théodore Pellerin est tout simplement fabuleux. Cet acteur a une capacité rare à se transformer. Son Simon est aussi exalté et grande folle, par moments, que son Julien était handicapé et sombre dans le film Souterrain. Pellerin parvient de manière stupéfiante à traduire le très douloureux mal de l’âme de son personnage. Je retiens au passage une scène déchirante dans la loge de sa mère après un récital où Simon est complètement éclipsé par la présence de son chum. Comme s’il n’existait pas. Vraiment, on va voir le film pour lui.

Le casting des premiers rôles est aussi excellent. Anne-Marie Cadieux, qu’on voit peu dans le film, est parfaite dans le rôle de la chanteuse d’opéra toute à sa carrière et si faussement intéressée par son fils. (Merci à la réalisatrice d’avoir évité de nous faire croire que son actrice est cantatrice. Ce n’était effectivement pas nécessaire au récit de la voir chanter.)

L’acteur français Félix Maritaud réussit, avec sa tronche antipathique, à être détestable et odieux avec ce Simon tellement perdu dans sa tête.

Quant à Alice Moreault, elle donne beaucoup d’humanité à son personnage de sœur protectrice, mais flouée.

Évidemment, la distribution compte un grand nombre de vraies drag queens qui ont l’occasion de faire leurs numéros devant la caméra inquisitrice du directeur photo Mathieu Laverdière.
Personnellement, j’ai trouvé que Sophie Dupuis accore trop d’importance aux numéros de cabaret au détriment du développement des personnages. Pour faire image: trop de chandails bedaine à bretelles spaghetti, pas assez d’étoffe.
Je n’arrive toujours pas à comprendre ce qui motive une personne à chanter en lyp-sync des chansons empruntées, vêtue de costumes invraisemblables, empâtée par des couches et des couches de maquillage et affublée de perruques surréalistes. Pourquoi cette envie de pasticher à outrance l’image des femmes? Ce n’est pas Solo qui éclaire ce mystère.

Solo dure pourtant 102 minutes. On commence à tourner en rond au dernier tiers en se demandant comment la réalisatrice va conclure son histoire. Eh bien, il y a une fausse fin, dramatique à souhait, suivie d’une vraie fin en forme de happy ending.
Ceci étant dit, il y a fort à parier que cette production québécoise, surfant sur la vague drag, connaîtra un bon succès ici, comme à l’étranger.

Lu: Roger Frappier, Oser le cinéma québécois, Éditions Mains Libres
J’aime les biographies, un genre ancré dans le réel. Il y a tant de gens qui ont des vies dignes d’un roman, surtout lorsque leur existence change la nôtre. C’est pourquoi j’étais très curieux du livre de Denis Monière sur le producteur québécois Roger Frappier, même si ce n’est pas une biographie à proprement parler.
Dans Roger Frappier, Oser le cinéma québécois, le politicologue de 76 ans s’intéresse à cet homme de cinéma qui a transformé le cinéma québécois, en plaçant son sujet dans son contexte historique, social et politique.
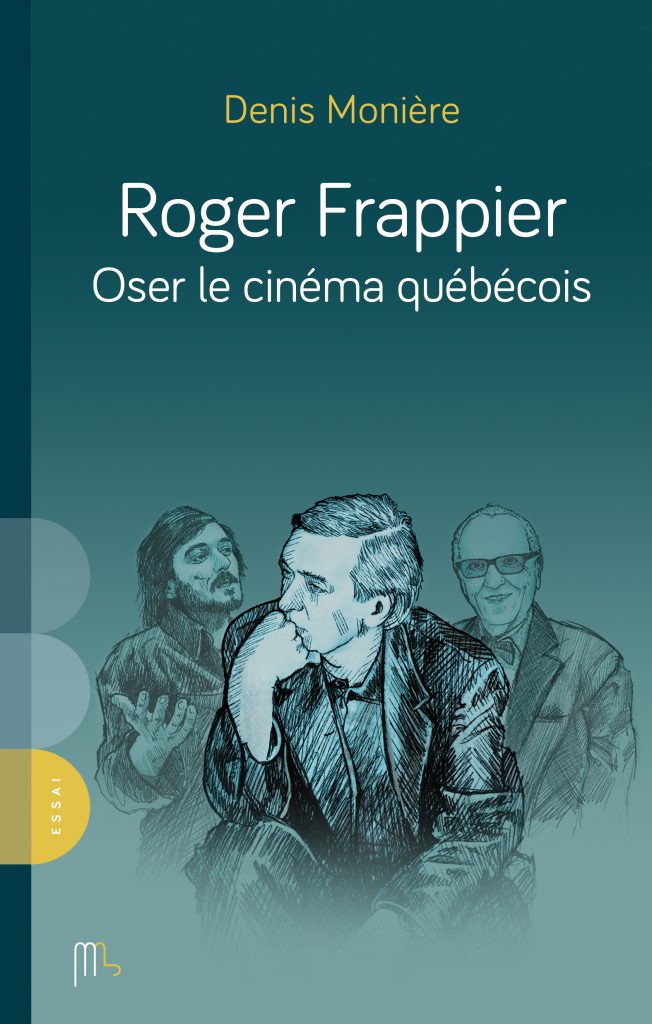
Pas de confessions de la part de Frappier, pas d’entrevues avec l’entourage, pas de photos, ce livre adopte une approche didactique et universitaire, basée sur une recherche rigoureuse. Monière fait parler les archives.
Dès les premières pages, j’ai retrouvé le style et la dialectique du livre Le développement des idéologies au Québec: des origines à nos jours, grand succès de Denis Monière en 1977, l’ouvrage que j’ai le plus aimé durant mes études en sciences politiques à l’Université Laval.
L’auteur nous fait traverser 50 ans d’histoire aussi hésitante que tumultueuse du cinéma d’ici en braquant le projecteur sur un de ses artisans les plus engagés, qui plus est, qui n’a jamais baissé les armes.
Inoculé très jeune au 7e art, Frappier, un petit gars de Sorel, ne mettra pas beaucoup de temps à vouloir changer le destin du cinéma québécois. Dès ses études au Collège Sainte-Marie à Montréal (en même temps que Denis Monière, en passant), ses convictions nationalistes l’orientent vers l’idée qu’il faut que les Québécois se voient sur grand écran, de toutes les manières, pour aspirer à devenir maîtres chez eux.
Comme réalisateur, il fera notamment des documentaires sur Raoul Duguay et l’Infonie et le Grand Cirque ordinaire, sur le mode du cinéma direct. Il fera aussi un film de cul, c’est la mode à l’époque.
Mais c’est bien beau de faire des films, encore faut-il qu’ils soient vus. Cela conduit Roger Frappier à un autre cheval de bataille: forcer l’État québécois à dompter les géants américains qui gèrent les salles de cinéma pour qu’ils laissent une plus grande place à la production locale sur leurs écrans.
Il bataillera aussi pour amener les gouvernements du Québec et du Canada à subventionner plus généreusement la production nationale. Cet idéaliste éclairé n’hésite jamais à démonter les pièces des grandes machines de l’État (SDICC, SOGIC, ONF, Téléfilm, SODEC, programme de crédits d’impôt) pour démontrer comment elles pourraient mieux desservir ceux qui font des films.
En tournant les pages, on est sidéré du temps qu’il faut, même au gouvernement Lévesque, pour changer les choses.
Denis Monière illustre combien l’échec du référendum a changé la trajectoire de Roger Frappier, ce dernier n’ayant d’autre choix que de prendre acte de la volonté des Québécois de poursuivre dans la voie du statu quo.
Frappier met alors ses convictions nationalistes sous le boisseau et poursuit son combat pour le cinéma québécois sur de nouvelles bases. Il défendra, comme producteur, des films plus personnels, coproduits, même en anglais, prendra souvent des risques, en donnant leur chance à de nouveaux venus.
Durant cette période, le cinéma québécois explose. Son nom est associé à une suite de succès populaires: Le déclin de l’empire américain, Un zoo la nuit, Anne Trister, Pouvoir intime, Ding et Dong, Jésus de Montréal. Apparaîtront aussi, grâce à lui, une flopée de vedettes montantes de la réalisation et de la scénarisation: Denis Villeneuve, Manon Briand, Denis Chouinard, Sébastien Rose, Ken Scott, etc.
Denis Monière ne manque pas d’illustrer à quel point la trajectoire de Roger Frappier évolue au fil des ans, toujours pour oser un cinéma québécois de son temps. Frappier ira jusqu’à sacrifier un jour le français dans certains projets pour que le Québec arrive à se mériter une place sur la planète cinéma, devenue une affaire de coproduction, selon le principe if you can beat them, join them!
La preuve, son dernier grand projet, celui qui lui a valu de se rendre de nouveau aux Oscars et d’y mériter les plus grands honneurs, sera une coproduction réalisée par une Néo-Zélandaise, The Power of the dog.
Le parcours de Roger Frappier est fascinant et rien de moins que déterminant dans l’histoire du cinéma québécois. Voilà qui est dit et bien dit dans ce livre de 250 pages paru chez Mains Libres. À lire!



