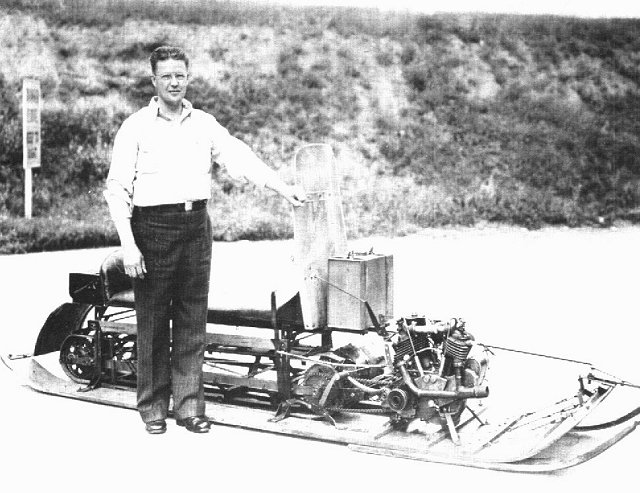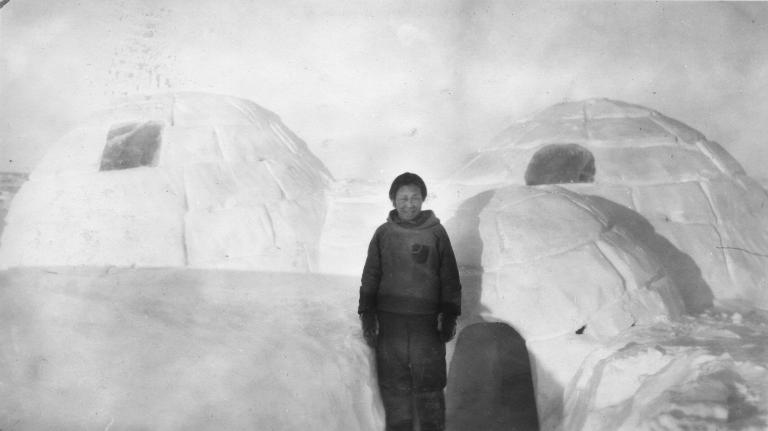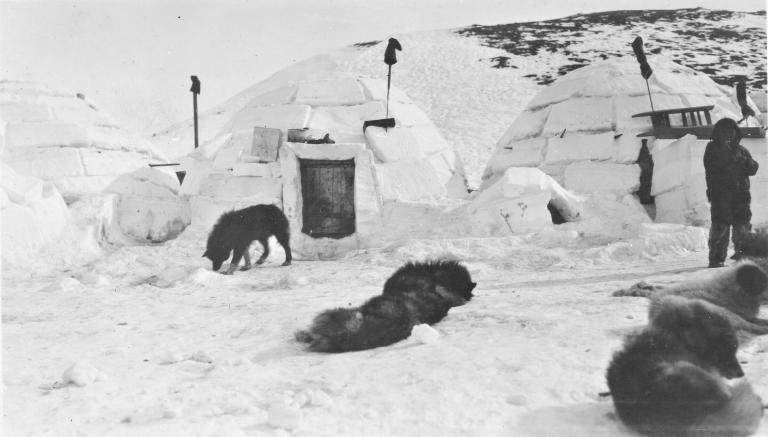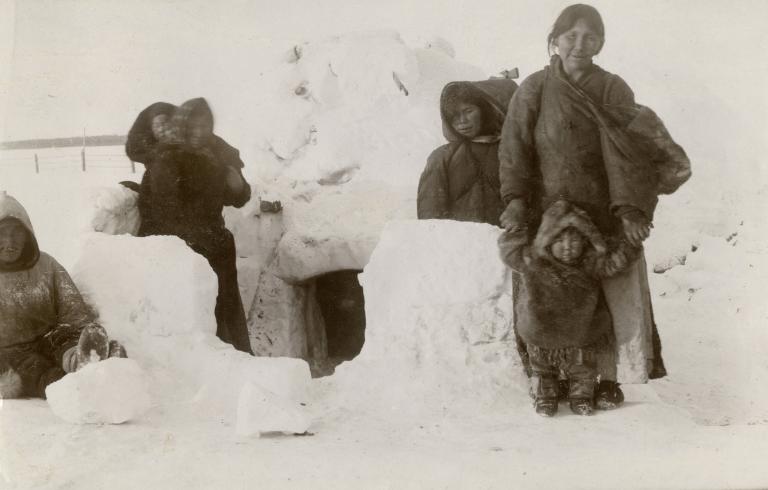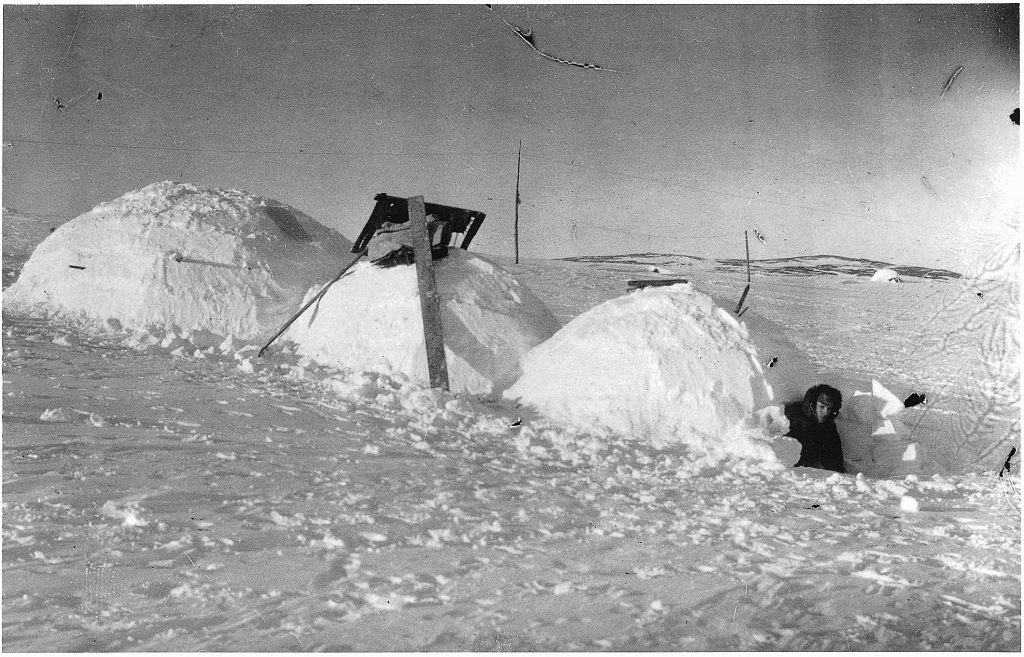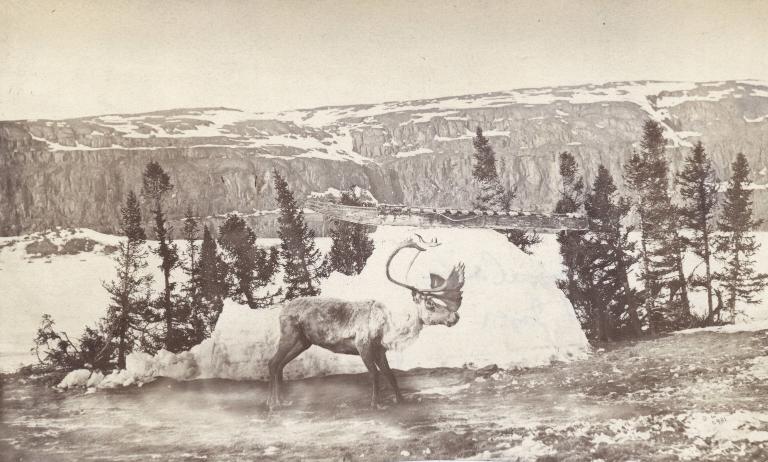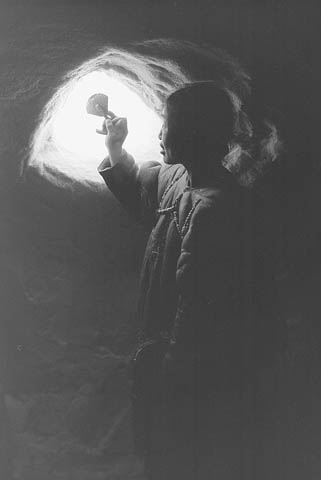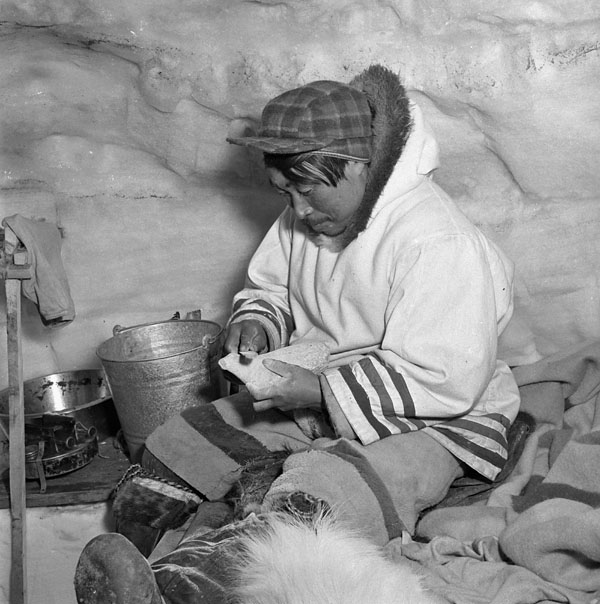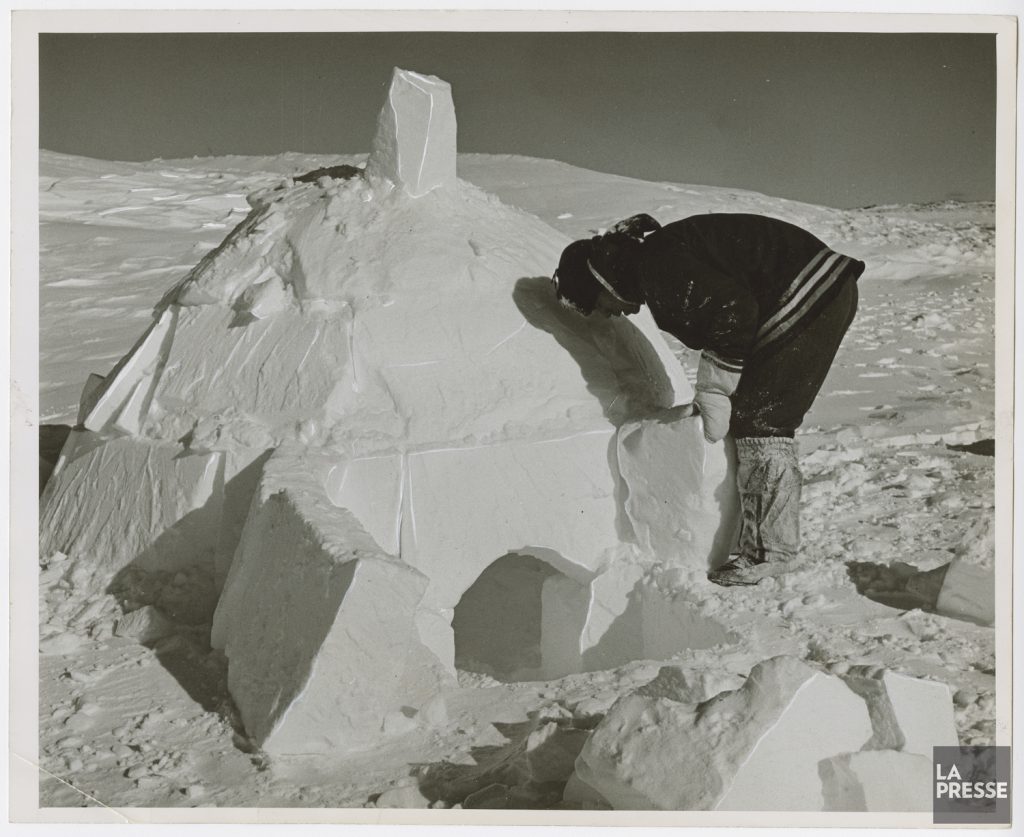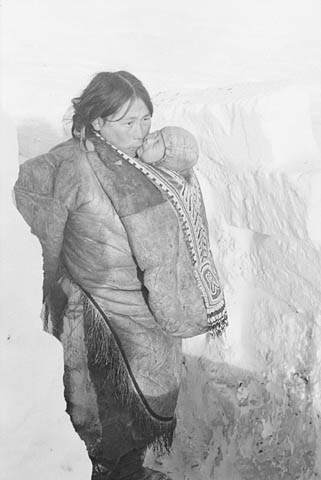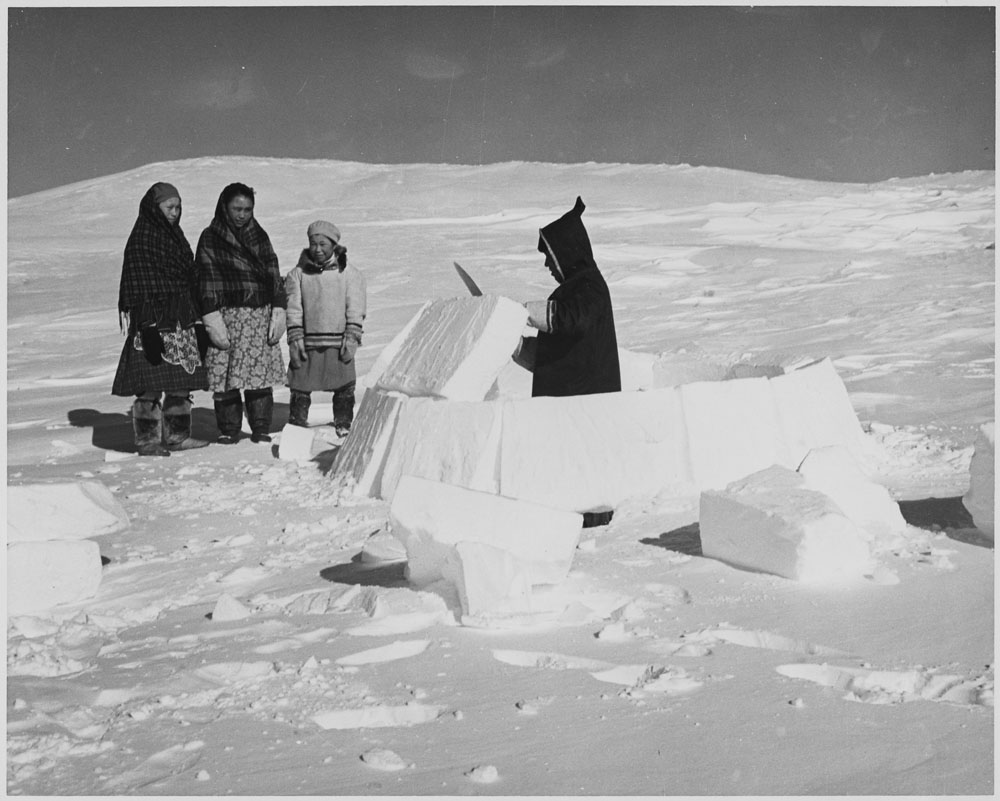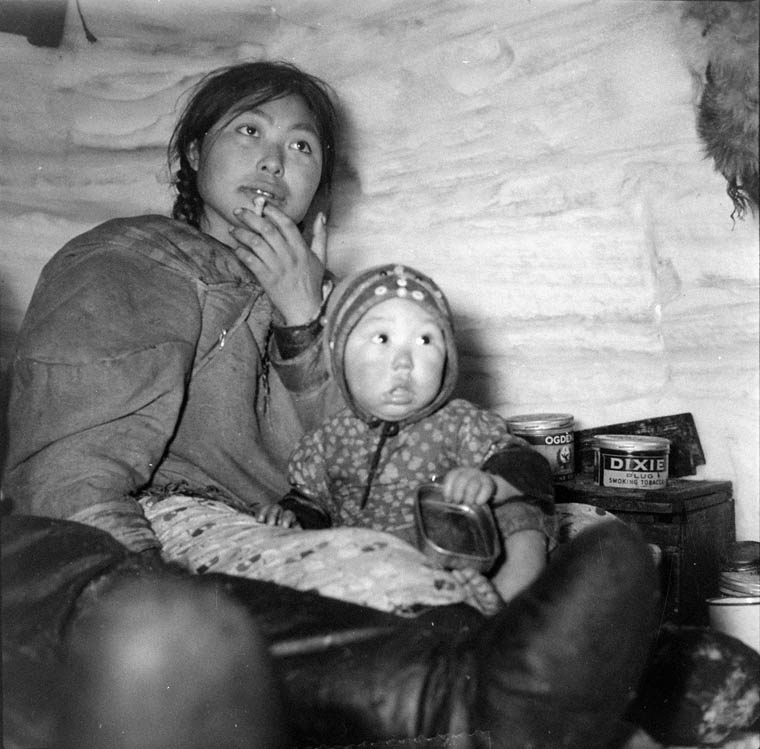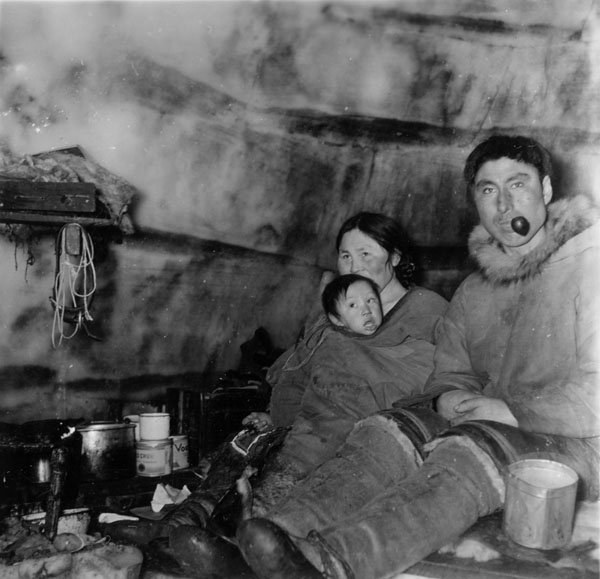Vous n’avez pas l’espace, l’argent ou le besoin d’avoir une souffleuse à neige, mais le pelletage à la main semble de plus en plus difficile? Les pelles à neige électriques pourraient être la réponse à vos problèmes. À condition de connaître leurs limites.
Les pelles à neige électriques sont des appareils qui permettent de souffler la neige un peu comme une souffleuse, mais dans un format qui rappelle celui d’une pelle.
Ces appareils datent d’il y a quelques années déjà, mais les améliorations récentes par rapport aux batteries d’outils électriques font que les modèles sans fil sont plus légers, moins chers et qu’ils offrent une meilleure autonomie qu’à leurs premières années.
Ceci explique probablement cela, mais il y a d’ailleurs de plus en plus de marques et de modèles sur le marché. Celui essayé ici en est une du fabricant Snow Joe, mais Ryobi, Toro et Greenworks proposent aussi des appareils du genre.

Comment ça fonctionne?
Les pelles électriques diffèrent des souffleuses à neige de différentes manières. Elles n’ont tout d’abord aucune roue et aucun mécanisme pour avancer automatiquement. Vous devez pousser la pelle électrique dans la neige, comme vous le feriez avec une pelle traditionnelle.
Ensuite, contrairement à une souffleuse, vous ne pouvez généralement pas diriger la neige vers un endroit précis. Celle-ci est plutôt soufflée droit devant vous.
Par rapport à une souffleuse, déneiger une entrée devrait être un peu plus long, mais vous pourrez transporter la pelle électrique à plus d’endroits (sur un balcon ou dans des marches, par exemple). Par rapport à une pelle, déneiger sera un peu plus rapide, mais vous forcerez aussi beaucoup moins physiquement.

Est-ce que ça fonctionne bien?
J’ai été agréablement surpris par la Snow Joe 24V-SS13. La pelle permet de ramasser la neige sur 13 pouces de large et sur 6 pouces de haut. J’ai essayé avec de la neige légère et avec de la neige mouillée et lourde et, dans les deux cas, ça a bien fonctionné.
Ce n’est pas parfait, cela dit. La neige lourde peut parfois faire arrêter le moteur, par exemple, mais il suffit alors d’attendre deux ou trois secondes et de la faire repartir en appuyant sur la gâchette pour continuer. Quand la neige est plus haute que 6 pouces, il suffit de passer une première fois sur une couche supérieure, puis de repasser sur la couche inférieure, ce qui augmente aussi un peu la charge de travail.
Malgré ces défauts, j’ai été en mesure de balayer un stationnement, des marches, un balcon et un patio, le tout sans aucun problème, plus rapidement et en étant beaucoup moins à bout de souffle qu’à l’habitude (surtout quand la neige était lourde).
Le fait qu’il ne soit pas possible de diriger la neige peut toutefois être embêtant. Si vous ne faites pas attention, vous risquez en effet de souffler chez vos voisins et sur vos fenêtres (ce qu’on veut éviter, surtout s’il y a des morceaux de glace dans la neige). On finit par s’y habituer en déblayant différemment qu’à l’habitude (de gauche à droite du stationnement plutôt que de haut en bas, par exemple), mais il est évident qu’un petit mécanisme simple qui offrirait un peu plus de contrôle pour diriger la neige serait apprécié.
Côté autonomie, le modèle que j’ai essayé est livré avec une batterie de 4 Ah permettant de souffler 1620 livres sur une seule charge. Snow Joe annonce une autonomie de 22 minutes, mais celle-ci varie grandement en fonction de la neige soufflée. À la maison, il me reste encore environ 75% de charge après avoir tout pelleté après une petite tempête.

Qu’est-ce que ça remplace?
Les critiques des pelles électriques sont généralement assez négatives. C’est en partie, je crois, parce que ceux qui les testent sont habitués aux souffleuses, qui sont plus puissantes et qui se contrôlent mieux.
C’est toutefois un peu une erreur de penser de cette façon, puisqu’une pelle électrique ne remplace pas une souffleuse, mais plutôt une pelle qui fonctionne à l’huile de bras. Après tout, ce n’est pas tout le monde qui a l’espace ou un terrain assez grand pour justifier une souffleuse, ni l’argent pour en acheter une.

Est-ce que ça vaut la peine?
Le modèle de pelle électrique testé ici coûte environ 260$, selon l’endroit où vous l’achetez et selon l’ensemble sélectionné. Est-ce essentiel? Probablement pas. Mais je serai tout de même un peu moins marabout lors de la prochaine grosse tempête de neige. Personnellement, je ne reviendrai plus en arrière.