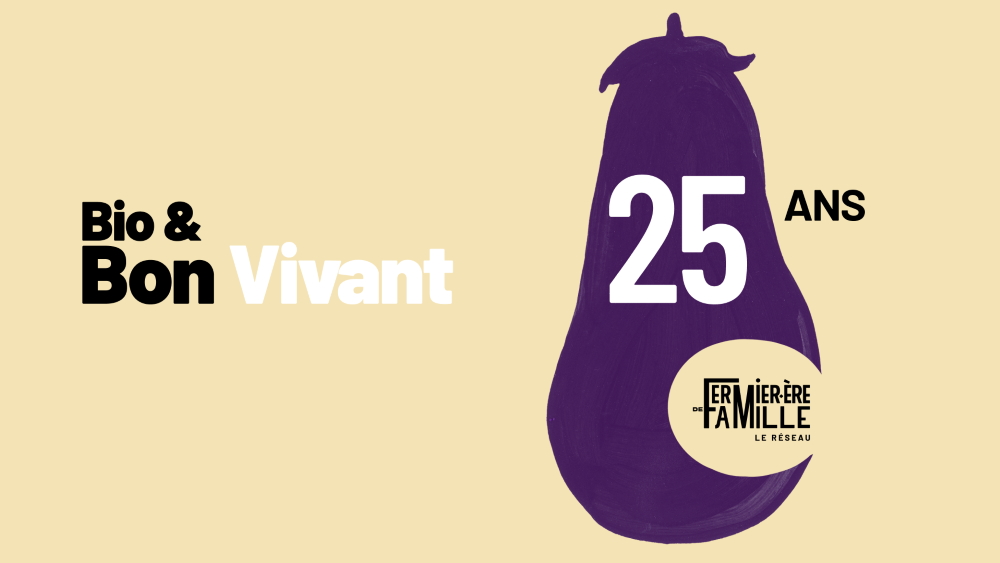Quand vient le temps d’aller dans les champs pour cueillir nous-mêmes nos aliments, il y a certains incontournables. Les fraises, les framboises et les pommes en font partie. L’autocueillette de ces fruits est bien ancrée dans les traditions de nombreux Québécois. Cependant, de plus en plus d’endroits proposent l’autocueillette d’autres fruits et légumes à rapporter à la maison. Voici 10 idées pour sortir des sentiers battus en août, septembre et octobre.
Tomates
De la fin du mois d’août au mois d’octobre, on peut aller cueillir ses tomates dans les champs. Rondes, italiennes, cerises: on fera provision de différentes variétés pour les futures sauces et soupes qui réchaufferont les soirées d’automne et d’hiver.
Poivrons
À partir du milieu du mois d’août et jusqu’au mois d’octobre, certains producteurs proposent l’autocueillette de poivrons doux et de piments forts. Si la récolte est belle, on pourra les griller, les mariner, les sécher ou les congeler pour les conserver pour la saison froide.

Bleuets
Souvent oublié au profit de la fraise, le bleuet peut aussi être cueilli à plusieurs endroits au Québec en août et parfois jusqu’en septembre. En prime, l’arbre dans lequel pousse ce petit fruit est à hauteur d’homme et permet une cueillette debout. C’est en Montérégie, dans Chaudière-Appalaches et en Estrie que se concentre le bleuet en corymbe, qui offre de belles grappes colorées aux cueilleurs, semblables à des grappes de raisins.

Argouses
Les petits fruits de l’argousier, les argouses, sont encore peu connus au Québec, et pourtant, le climat est idéal pour leur culture. À travers la province, certains producteurs en proposent l’autocueillette pendant les mois d’août et septembre. Le petit fruit orangé qu’on dit bourré de vitamines a un goût qui peut se rapprocher de celui des agrumes. Pour profiter de la récolte toute l’année, on peut facilement le congeler.
Aubergines
De la mi-août à la mi-octobre, l’aubergine est abondante chez certains producteurs. On pourra ainsi faire des provisions et découvrir d’autres variétés que l’aubergine noire plus connue; la blanche ou l’italienne, par exemple.

Oignons
Ils se conservent longtemps et ils sont souvent utilisés dans les recettes d’automne et d’hiver, alors pourquoi ne pas aller directement dans les champs faire des provisions d’oignons? De la mi-août à la mi-octobre, des producteurs offrent la cueillette de différentes variétés.
Artichauts
Encore marginale, l’autocueillette d’artichauts est offerte de la fin août jusqu’aux premiers gels à la ferme de La Fille du Roy à Sainte-Madeleine, en Montérégie. Ce légume délicat peut se conserver jusqu’à un mois au réfrigérateur. Il peut aussi être congelé ou mis en conserve.

Maïs
Quelques producteurs proposent l’autocueillette de maïs sucré en saison, soit en août et septembre. On peut souvent observer les champs d’épis en bordure de route, mais c’est une autre expérience de mettre la main à la pâte pour faire ses provisions. Une bonne raison d’organiser ensuite une épluchette en famille ou entre amis!
Raisins
Dans différentes régions du Québec, on peut partir avec son sécateur et son panier pour rapporter à la maison différentes variétés savoureuses de raisins de table rouges, bleus ou verts: Somerset, Brianna, Canadice ou Radisson, par exemple. Les Québécois sont friands de raisins, et pourtant, ceux cultivés au Québec sont encore peu connus. La récolte se fait en septembre et octobre.
Poires
On pense souvent plus naturellement aux pommes, mais en septembre et octobre, il est aussi possible de remplir son panier… de poires! Au Québec, on en cultive une quinzaine de variétés et certains vergers en proposent l’autocueillette. Pour les conserver, on en fait de la confiture, des compotes ou des conserves.

Plusieurs types d’autocueillette sont moins connus, mais dans les faits, il est possible au Québec de faire provision de fruits et légumes frais de juin à novembre en allant «se servir» directement aux champs. Il y a les suggestions données plus haut, mais on peut aussi aller récolter soi-même ses patates, haricots, choux, cerises, citrouilles, courges, concombres, amélanches, airelles, prunes, et même fleurs (comestibles ou non)… Les possibilités sont nombreuses!
Pour vous inspirer, pour savoir comment vous équiper pour cueillir, et trouver les producteurs qui offrent l’autocueillette, l’Union des producteurs agricoles propose l’application Mangeons local plus que jamais!, qui regroupe plus de 1000 producteurs partout au Québec, dont plusieurs rendent leurs champs accessibles aux visiteurs. Du côté de la région de la Capitale-Nationale, le site autocueillette.com regroupe plusieurs producteurs qui offrent l’autocueillette de différents aliments.