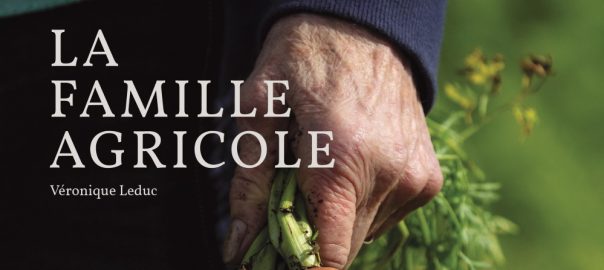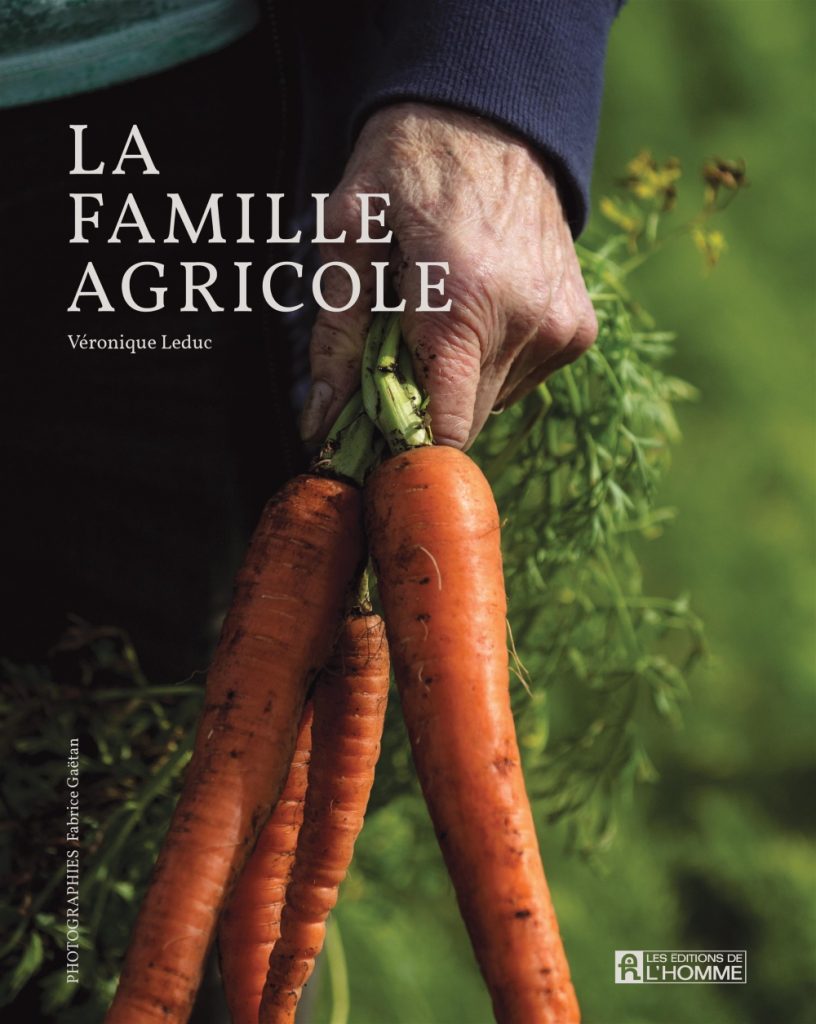On dit souvent que ce sont les régions et leurs vastes champs qui nourrissent les gens des villes. Mais saviez-vous que Montréal a le potentiel pour nourrir de très nombreux citoyens, que la métropole, grâce à ses multiples initiatives, est la capitale mondiale de l’agriculture urbaine et que sa réputation en ce sens dépasse les frontières?
Montréal compte l’un des plus importants programmes d’agriculture urbaine au monde avec plus de 8500 parcelles réparties dans 97 jardins, 75 jardins collectifs et de nombreuses initiatives privées, dont 55 fermes urbaines et 200 hectares de potagers qui nourrissent des dizaines de milliers de citoyens.
D’ailleurs, en 2020, l’agriculture urbaine a généré des revenus de 380 millions $, selon une étude de 2022 du Carrefour de recherche, d’expertise et de transfert en agriculture urbaine.
«Montréal est une ville nourricière qui s’ignore», estime carrément Éric Duchemin, directeur scientifique du Laboratoire sur l’agriculture urbaine et professeur à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). On entend, par ce terme de ville nourricière, un milieu de vie assurant à l’ensemble de ses résidents un accès à des aliments frais et sains. Selon le professeur, peu de gens le savent, mais la ville est même l’une des plus importantes au monde dans le domaine de la production alimentaire.
Lors d’une journée organisée par l’Office montréalais de la gastronomie l’automne dernier, le professeur mettait d’ailleurs en lumière la vitalité de la métropole à ce chapitre: «c’est ici que s’est installée la première champignonnière au monde et, maintenant, Montréal en compte six. Et la production urbaine montréalaise est très diversifiée: ferme de légumes africains, producteurs de pousses, élevage d’ombles chevaliers, chai duquel sortent des vins de qualité… Tout est possible à Montréal!».
Le professeur, en collaboration avec l’UQAM, a d’ailleurs créé une école d’été dont le but est d’enseigner l’art de l’agriculture urbaine. Selon lui, en dehors de la ville, la réputation de Montréal en matière d’agriculture urbaine n’est plus à faire et les gens s’y rendent d’ailleurs quand ils veulent en apprendre plus sur la question.

Ahuntsic, quartier fertile
Le quartier Ahuntsic, dans le nord de Montréal, est un bon exemple de cette réussite montréalaise et s’illustre comme chef de file en agriculture urbaine au pays. Le média imprimé du quartier, Le journal des voisins, consacrait d’ailleurs ce printemps un dossier complet à ce sujet.
Déjà, les serres Lufa, sur le toit d’un immeuble du quartier, y ont fait leur place en 2010 et ne cessent de faire parler depuis, offrant depuis quelques années des paniers de leurs récoltes.
Plus jeune, la Centrale agricole est un ovni dans le quartier industriel situé près du Marché central: elle a ouvert ses portes en 2019, avec 40 000 pieds carrés occupés par une vingtaine d’entreprises pour la plupart mues par la volonté de faire vivre des initiatives inspirées de l’économie circulaire et du surcyclage des aliments. On compte aussi 10 000 pieds carrés d’espaces cultivés sur le toit du bâtiment, une superficie qu’on prévoit augmenter rapidement. Grâce aux espaces, à la formation et à l’accompagnement offerts à ses membres, la coop est la plus importante en matière d’agriculture urbaine au Québec. S’y trouvent entre autres Big Bloc, des producteurs de champignons, Cidre Sauvageon, une entreprise qui offre du cidre, et Coop Boomerang, qui propose une farine alimentaire à base de drêche. Éco-Protéine, quant à elle, fait l’élevage d’insectes, OLAOLA fait des sucettes glacées appétissantes à base de fruits et légumes sauvés du gaspillage, Opercule produit de l’omble chevalier sur place et Lieux Communs produit du vin et des cidres dans son chai urbain. Et ce ne sont que quelques exemples: il y a là de quoi faire de nombreuses découvertes alimentaires dans un seul bâtiment!
C’est sans parler aussi des jardins communautaires et autres initiatives qui verdissent le quartier et permettent de pallier les déserts alimentaires.

Vers plus de vert
Au-delà d’Ahuntsic, chaque quartier a ses initiatives en lien avec l’agriculture et, à Montréal, on cultive partout: sur les toits, sur les balcons, dans les ruelles, dans certains bâtiments industriels et dans les jardins communautaires et collectifs. D’ailleurs, du côté des citoyens, on estime que 60% des habitants jardinent. Ajoutons à cela la soixantaine d’entreprises agricoles installées sur le territoire et nous pouvons parler d’une ville verte qui est nourricière, certes, mais qui se donne aussi des outils pour faire face aux changements climatiques.

Malgré tout, Montréal n’entend pas s’asseoir sur sa réputation: en 2021, la Ville se dotait d’un plan sur cinq ans afin de multiplier les initiatives déjà nombreuses dans le secteur de l’agriculture urbaine. On voulait entre autres prévoir des superficies dédiées à l’agriculture urbaine dans les outils de planification des nouveaux développements, intégrer des arbres fruitiers dans les projets de verdissement en favorisant les projets d’aménagements comestibles, encourager les projets de jardinage dans les cours d’écoles montréalaises…
D’ailleurs, pour que les Québécois autant que les gens de l’extérieur aient cette vision de chef de file de Montréal quand il est question d’agriculture urbaine, Éric Duchemin disait cet automne que la Ville devrait bâtir une offre agrotouristique autour de ses fermes, afin de mieux faire connaître son expertise et de créer une fierté chez les Montréalais qui peuvent se nourrir à même leur ville.