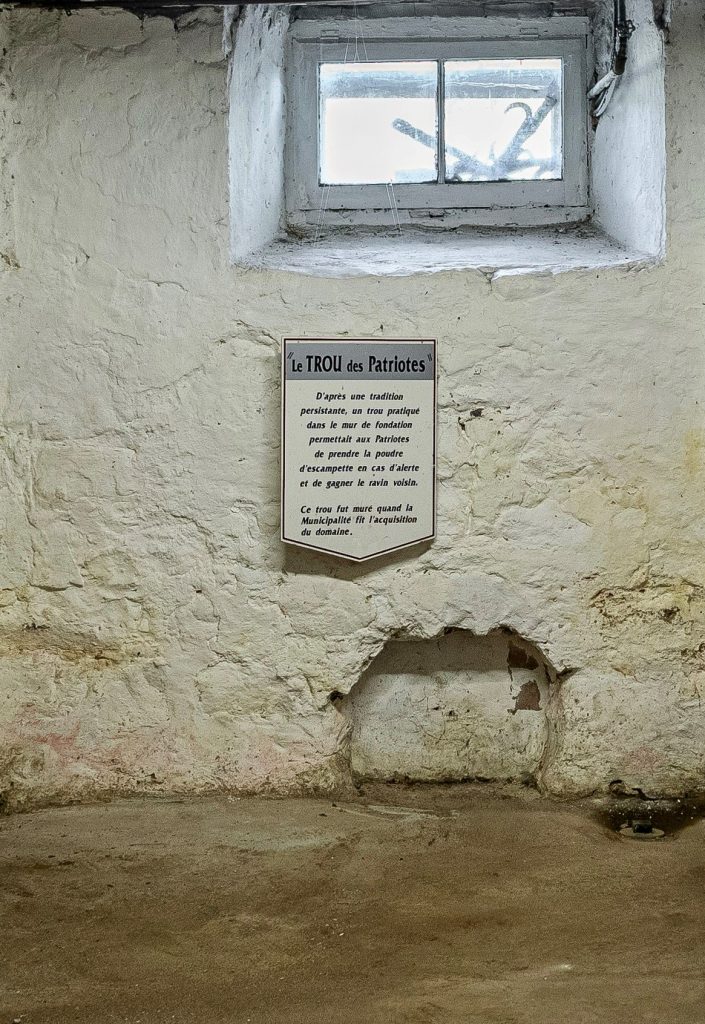Comme la pizza napolitaine, le couscous, la bière belge et le kimchi, la baguette française a désormais sa place au patrimoine immatériel de l’humanité de l’UNESCO, dans une volonté de la protéger.
C’est le 30 novembre dernier, des mois après que la candidature ait été déposée et après des années de travail des boulangers, que la baguette a fait sa place au milieu d’autres aliments du monde pour lesquels on estime que les savoir-faire sont précieux.
L’organisation, dont les membres se sont rassemblés au Maroc, honore des traditions à sauvegarder plus que les produits eux-mêmes. Ainsi, elle ne reconnaît pas que la baguette de pain appartient au patrimoine mondial immatériel, mais que «les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette» en font partie.
Sur le site de l’UNESCO, on souligne donc que le procédé de fabrication traditionnel comprend plusieurs étapes: dosage et pesage des ingrédients, pétrissage, fermentation, division, détente, façonnage manuel, apprêt, scarification et cuisson. Puis, on rappelle que la baguette se distingue des autres pains car elle est composée de seulement quatre ingrédients, soit de la farine, de l’eau, du sel et de la levure ou du levain.
On peut aussi y lire que la baguette génère des modes de consommation et des pratiques sociales qui la différencient des autres pains, par exemple, un achat journalier et une forme longue qui nécessite des présentoirs spéciaux.

La baguette, en voie de disparition?
Même si la baguette, apparue au début du 20e siècle à Paris, est aujourd’hui le pain le plus consommé en France, cette reconnaissance est primordiale étant donné les menaces qui pèsent sur les savoir-faire liés à sa fabrication. En effet, l’industrialisation et la baisse du nombre de boulangeries en inquiètent plusieurs. En 1970, on comptait environ 55 000 boulangeries artisanales, soit une boulangerie pour 790 habitants, alors qu’aujourd’hui, il n’en reste que 35 000, soit une pour 2000 habitants.
Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO, estime qu’il est important de conserver le mode de vie lié à la consommation de la baguette et que c’est ce que vient appuyer l’UNESCO avec cette reconnaissance qui est selon elle «un acte symbolique fort».