Crise des médias: le gouvernement doit agir, les citoyens doivent réagir
La faillite de Groupe Capitales Médias, qui menace les principaux journaux régionaux du Québec, n’est pas seulement l’affaire des gens de Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Saguenay, Granby et Gatineau. Elle est l’affaire de tous parce qu’elle illustre parfaitement les deux problèmes de la presse traditionnelle à l’heure du web: le vampirisme et l’indifférence.
La presse est un rouage essentiel de notre système démocratique et il est urgent que les gouvernements et les citoyens réagissent. En particulier les citoyens, qui doivent affirmer qu’une presse qu’on affame n’est plus une presse libre. L’écosystème journalistique, qui se délite depuis 20 ans sous l’effet de la concurrence déloyale de Facebook et de Google, arrive à un point de bascule qui deviendra bientôt irréversible. Il n’est pas trop tard pour corriger 20 ans de laisser-faire désastreux, mais il commence à se faire tard.
Il n’est pas exagéré de parler de vampirisme quand on parle de l’effet de Google et de Facebook sur l’écosystème médiatique. Une large part de leur modèle repose sur du contenu journalistique produit de la manière la plus traditionnelle qui soit par toutes sortes de médias d’information et répercuté dans leurs réseaux. On est saisi de vertige devant la cupidité bête et insensée des géants du web, qui accaparent plus de 70% des revenus de publicité au Canada, où ils ne paient ni impôt, ni taxe, ni redevances d’aucune sorte. Ce n’est pas un comportement parasitaire: c’est du vampirisme. Le parasite, au moins, laisse vivre son hôte. Le vampire, lui, suce le sang jusqu’à ce que mort s’ensuive.
Faut-il s’étonner que l’époque soit si fascinée par le zombie, dont la figure se retrouve partout? Le zombie est la métaphore parfaite de ce que nous devenons tous. Devant le sort de la presse, le cynisme et l’indifférence qui entourent le sujet dans la population sont inquiétants. Car sauver la presse – et plus largement le journalisme –, c’est aussi se sauver nous-mêmes en tant que citoyens avant de devenir des zombies hallucinés, nourris aux algorithmes distillant partout les mêmes infos, les mêmes musiques, les mêmes images.
Le journalisme, ce n’est pas seulement une job pour quelques dizaines de milliers de personnes. C’est surtout une institution capitale pour toute démocratie fondée sur une économie de marché. Les élections, le gouvernement responsable et la justice autonome ne sont pas possibles sans une presse libre. Car de toutes les institutions, la presse est la seule qui carbure à la vérité et aux faits sans autre considération. Les élus sont constamment tentés par les considérations électoralistes. La loi cherche aussi la vérité et les faits, mais elle vise à punir: le journalisme, lui, ne cherche que les faits.
Les influenceurs, les potineurs et les donneurs d’opinions, qui font leur miel des réseaux sociaux, ne sont pas des journalistes. Les journalistes demandent des comptes et révèlent ce que d’autres voudraient cacher. Ils ne sont pas prisonniers de l’agenda des politiciens, qui distillent de l’information quand cela fait leur affaire. Dans de nombreuses petites villes, la presse est bien souvent le seul contre-pouvoir face à des mairies autoritaires, et parfois malheureusement corrompues. Ils sont aussi très utiles face aux entreprises, autre institution importante de notre système, mais dont les réflexes sont rarement démocratiques – leur premier mandat étant de chercher leur profit. Les bons journalistes sont même capables de travailler contre l’opinion du plus grand nombre au service de la vérité.
Contrairement aux influenceurs, petits et grands, les journalistes sont tous surveillés par une rédaction, qui demande des preuves et qui répond à une déontologie, qui est ni plus ni moins qu’un code d’honneur. C’est ce savoir-faire que la crise des médias menace. La presse est tellement forte que chaque fois qu’une démocratie faiblit quelque part, la première institution qu’on établit, c’est la censure; et la première institution qui saute, c’est la presse libre. Ce n’est pas pour rien que l’ONU, dans sa charte des droits, consacre la liberté de presse comme un droit fondamental.
Dans la crise actuelle des médias, ce n’est pas seulement l’espèce journalistique qui est en danger, mais le système même qui a permis toutes les avancées de nos sociétés depuis deux siècles. Sans une presse libre, il n’y aurait jamais eu de Révolution américaine ou de Révolution française. On n’aurait jamais rien su du magouillage politique des entreprises du secteur de la construction au Québec – et il n’y aurait jamais eu de commission Charbonneau pour faire la lumière là-dessus. Il n’y aurait pas eu de mouvement #MeToo. Il n’y aurait jamais eu de Panama Papers, ni de Watergate. Sans compter toutes les petites révélations que tant de journalistes déterrent quotidiennement – dont certaines produisent de véritables avalanches politiques et sociales.
Le droit à l’information, un droit fondamental, appelle à la responsabilité. Les citoyens devraient être les premiers à exiger que leurs élus mettent en place des mécanismes fiscaux et légaux pour garantir l’accès à une presse libre et de qualité. C’est pourquoi il est inquiétant de voir que tant de nos concitoyens, y compris bien des politiciens, faire si peu de cas de leur droit fondamental. Abreuvés à la mamelle de Facebook et de Google, ils sont devenus insensibles à l’importance du journalisme et des médias. Ils ne perçoivent plus l’importance de la pluralité des sources d’information. Ils ne comprennent plus qu’ils ont, en tant que citoyens, un devoir de faire la démarche de s’informer, de cliquer sur l’hyperlien et de lire l’article au lieu de faire des likes, et des likes de likes.
Contrairement à l’idée véhiculée par ses détracteurs, la presse et les médias ne sont pas des dinosaures qui refusent de s’adapter. Au contraire, depuis 20 ans, tout a changé; la recherche, l’écriture et les rédactions ont entièrement modifié leurs processus. On pourrait même argumenter que certains médias sont allés trop loin en produisant une information destinée à «faire du clic». Mais cela fait partie du jeu médiatique: il a toujours existé ce que l’on appelait une «presse jaune», peu scrupuleuse des faits, voire inculte et hostile au progrès. Jadis, elle ne visait qu’à faire tourner la presse à imprimer; aujourd’hui, elle fait du clic. Mais il faut que les citoyens et les élus puissent discerner la différence entre cette presse jaune et une presse de qualité, et il faut que le gouvernement dise son importance.

Un jeu qui se joue à deux
La situation actuelle a de multiples causes qui se ramènent toutes au fait qu’on a laissé les géants du web tout bulldozer sans avoir eu la prévoyance d’imposer des limites et d’exiger des comptes sous forme d’impôts, de taxes et de redevance. Dans un livre phare publié au début de 2019, The Age of Surveillance Capitalism (non traduit en français), l’auteure Shoshana Zuboff, qui est professeure à Harvard, fait valoir qu’on est à deux doigts de créer un monstre dont nous sommes sur le point de perdre le contrôle.
Dans la crise des médias, l’intervention du gouvernement sera essentielle parce que tout le monde y participe, y compris les médias eux-mêmes. Au milieu des années 1990, les médias se sont laissés convaincre, stupidement, de mettre leur contenu gratis sur le web. Il s’agissait de profiter d’une nouvelle «vitrine», arguait-on alors. Enfirouapés dans leur propre naïveté, ils ont amorcé gratis un mouvement publicitaire qu’ils n’ont pas pu endiguer, et dont ils sont désormais prisonniers et victimes.
On atteint des sommets de contradiction: le gouvernement encourage l’achat local et les commerçants québécois veulent qu’on achète chez eux, mais ils envoient le gros de leurs publicités sur Facebook et Google. Le gouvernement a même abandonné la publication des avis publics dans la presse régionale. Les grandes campagnes de publicité gouvernementales passent toutes, désormais, par les réseaux sociaux – auxquels l’État ne réclame aucune contrepartie.
Shoshana Zuboff démontre à quel point les Google et Facebook ont non seulement brillé au plan technologique, mais aussi excellé dans la cohérence de leur discours libertaire refusant toute forme de régulation.
La vérité est que le cyberespace est un nouvel espace de liberté et de vie dans lequel les gouvernements doivent réinventer leur mode d’intervention. Ce dont il est question, c’est bien évidemment que le gouvernement y fasse jouer les mêmes règles que dans le reste de la société. Mais il s’agit aussi de restaurer une certaine éthique technologique.
Après tout, ce n’est pas parce qu’une chose est possible qu’elle est nécessairement bonne. Cela fait longtemps que l’on sait qu’un moteur à explosion, tout utile qu’il soit, ne peut pas être laissé à n’importe qui pour faire n’importe quoi n’importe où. Il faut un Code de la sécurité routière, de la sécurité aérienne, de la navigation – minimalement.
Il en va de même du web. Airbnb, c’est très utile dans certains contextes, mais cela tue l’industrie touristique en plus de faire grimper le prix de l’immobilier. Uber tue le taxi et pousse des chauffeurs au suicide, sans offrir rien de plus. Facebook et Google, on ne s’en passerait plus, mais cela peut tuer l’information et la démocratie. Il est temps que les gouvernements s’en mêlent.
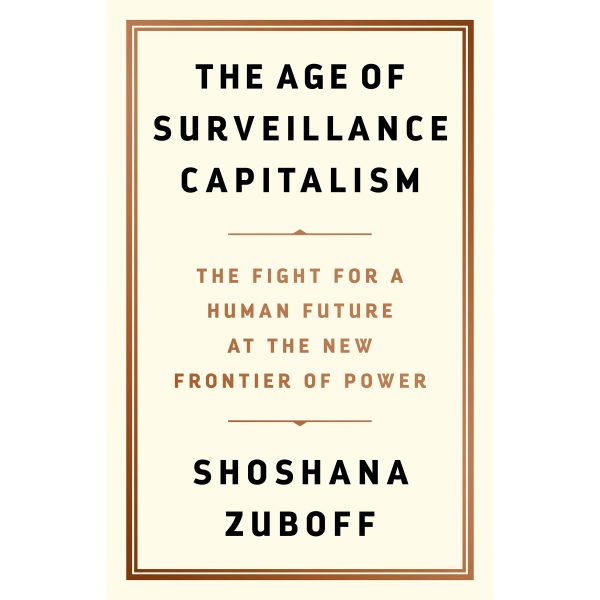
Pourquoi il faut agir
L’éviscération de la presse a tardé au Québec. Sans doute parce que la barrière de la langue et le peu d’attraction des petits marchés ont joué dans une certaine mesure. Mais le Québec est en train de rejoindre très vite le Canada anglais. Et c’est du Québec que l’action commence à surgir au Canada. On a vu le gouvernement du Québec taxer Netflix et imposer des règles à Airbnb, ce qui donne au gouvernement du Québec plusieurs coups d’avance sur Ottawa. La Commission sur l’avenir des médias était une autre initiative importante, mais il faudra plus – à Québec et surtout à Ottawa.
On ne reviendra pas en arrière sur 20 ans d’inanité, mais on peut bâtir quelque chose. Il est possible de sauver ce qu’il reste d’une presse libre et viable, à condition d’y mettre une action énergique. Il faut que cesse le vampirisme.
La presse a besoin d’une action cohérente et surtout musclée. À court terme, des subventions, certes, et des avantages fiscaux. Mais à moyen terme, il faut que le gouvernement rétablisse l’équilibre et cesse de laisser Facebook et Google profiter d’avantages déloyaux. Cela doit commencer par la restauration des impôts et des taxes, mais il faudra établir des systèmes de redevances culturelles et de perception de droit d’auteur. Il faudra modifier les règles du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et la loi sur le droit d’auteur pour créer de nouvelles catégories de droits voisins comme l’Union européenne vient de le faire au bénéfice de la presse européenne. Enfin, le gouvernement devra embaucher des «patrouilleurs» qui ne savent pas se servir d’un pistolet, mais qui sont des magiciens du clavier – pour bien jouer son rôle d’arbitre.
Il faut évacuer l’idéologie technocapitaliste ultra-libertaire et asociale. Les gouvernements en sont capables puisqu’ils ont su s’attaquer à la cybercriminalité, à commencer par la pédophilie. L’État doit réglementer cet espace au même titre qu’il le fait pour tous les autres aspects de la société. Lui seul, en fait, a le pouvoir d’amener les citoyens à accepter une éthique qui dise clairement que le free-for-all n’est plus possible et que l’on n’a rien pour rien. Il en va de notre avenir démocratique.



