Quand Annie Ernaux parle
«Il n’y a pas d’âge pour la passion», déclarait le 4 novembre la très grande écrivaine française Annie Ernaux alors qu’elle donnait une conférence aux Beaux-Arts de Paris. En revenant sur la récente adaptation au cinéma de Passion simple, elle déplorait que la différence d’âge entre la femme (48 ans) et l’homme aimé (35 ans) de son célèbre récit ait été «gommée», comme si une telle histoire d’amour et de désir était peu plausible, comme si après 40 ans, la femme devenait raisonnable et qu’un homme plus jeune ne puisse pas être attiré par une femme au seuil de la cinquantaine.
En revenant sur cette passion – pas si simple – éprouvée à l’endroit d’un homme qui ne reste jamais, qui refuse toutes formes d’engagement, dont on parlerait aujourd’hui comme d’un être toxique, Annie Ernaux assurait avoir «décidé de vivre cette passion jusqu’au bout, jusqu’à la souffrance […]». L’absence de sa mère, morte, lui donnait l’élan pour vivre enfin ce qu’elle s’était jadis interdit sous l’œil censeur de son aïeule.
Non, je n’étais pas à Paris pour l’entendre. J’aurais couché dehors dans mon sac de couchage pour être sûre d’avoir une place... Or, ma préférée, il va sans dire, était aussi présente en virtuel via un Facebook live, pour la plus grande joie de ses fans du monde entier. Je savais qu’elle lancerait quelques bombes, il ne fallait pas les manquer.
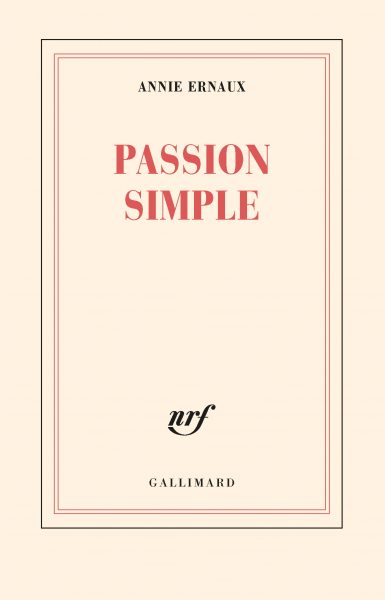
L’écrivaine, qui vient de remporter le prix Prince Pierre de Monaco, n’a jamais tenu à faire l’unanimité. Contrairement à notre Margaret Atwood nationale, une autre octogénaire primée, très vive, actuelle et toujours pressentie pour le Nobel de littérature, Annie Ernaux n’est pas sur les réseaux sociaux, elle refuse les mondanités et préfère de loin son Cergy d’adoption à Paris, où elle ne se sent pas à sa place, si loin de son petit jardin.
«Pour avoir traversé des moments où ce regard était déterminant, j’ai une forme d’indifférence profonde du jugement d’autrui. Ce rejet déjà ressenti me donne cette liberté.» Pourquoi devrait-elle correspondre à des attentes alors qu’issue d’un milieu modeste, s’en éloignant pour étudier et rejoindre les rangs d’une certaine élite intellectuelle, elle n’a jamais eu l’impression qu’elle prenait part à un groupe social ou un autre? C’est pour ça qu’Annie Ernaux est toujours aussi pertinente: elle n’adhère à aucun effet de mode. Et puis, parce qu’elle part de ses propres histoires pour raconter le monde entier avec grand art. «Je suis traversée par des choses. Si elles me traversent, je me dis qu’elles en ont traversé d’autres gens.»
L’écrivaine n’a jamais cherché à s’exposer pour s’exposer, même si elle est adepte de photographie, matériau précieux dans sa démarche pour restituer des souvenirs. Voilà qui tranche aussi avec le temps présent. «Écrire, c’est d’abord ne pas être vu.» Une citation qui vient d’elle et que j’aurais envie de dire à celles et ceux qui publient pour être connus avant même d’aimer lire et écrire.
Le Goncourt percutant
Un autre, plus jeune celui-là, qui n’écrit certainement pas pour épater la galerie, Mohamed Mbougar Sarr, remportait le 3 novembre le prestigieux prix Goncourt de cette année pour son roman La plus secrète mémoire des hommes (Philippe Rey/Jimsaan), quatrième opus du Sénégalais de 31 ans qui vit en France et qui devient le premier écrivain d’Afrique subsaharienne à être consacré par le Goncourt.
À mi-chemin entre enquête et réflexion sur le métier d’écrivain, Sarr a pour narrateur Diégane, un écrivain sénégalais qui lui ressemble et qui se rend à Paris pour retrouver la trace de T. C. Elimane, auteur d’un livre mythique, paru en 1938: Le labyrinthe de l’inhumain. «Après ces ouvrages consacrés au djihadisme, à la crise migratoire et à l’homosexualité au Sénégal, il livre ici un roman brillant, fiévreux, sensuel, travaillé par des questions littéraires et existentielles, qui transporte loin et marque longtemps», note Le Monde.
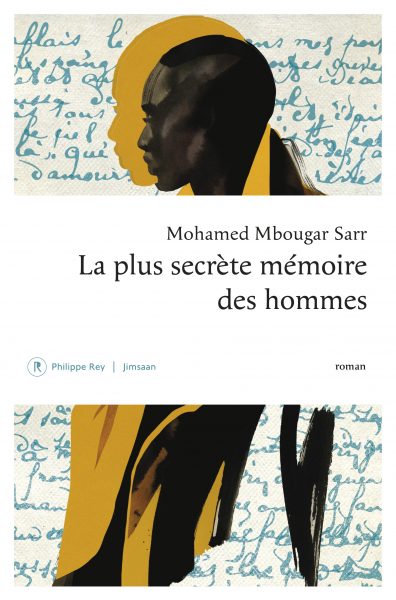
«On aime particulièrement sa petite vacherie sur l’écrivain qui "à force d’être dans l’air du temps, finira enrhumé". On souhaite à Mbougar Sarr de garder longtemps sa bonne santé», pouvons-nous lire dans Nouvel Obs. Je n’ai malheureusement pas lu ce titre de la rentrée. Mon attention s’était attardée sur Voyage dans l’Est de Christine Angot, récompensée de son côté par le Médicis et dont j’ai encensé le travail dans une chronique.
J’ai quand même parcouru rapidement le texte de Mbougar Sarr pour en saisir l’essence et je suis tombée sur cette perle. Je ne peux pas m’empêcher de partager ce bijou d’autodérision. Je me demande si la formidable Annie Ernaux serait d’accord, elle qui a certainement dû croiser quelques moineaux du genre… «Voilà ton erreur. Voilà l’erreur de tous les types comme toi. Vous croyez que la littérature corrige la vie. Ou la complète. Ou la remplace. C’est faux. Les écrivains, et j’en ai connu beaucoup, ont toujours été parmi les plus médiocres amants qu’il m’ait été donné de rencontrer. Tu sais pourquoi? Quand ils font l’amour, ils pensent déjà à la scène que cette expérience deviendra. Chacune de leurs caresses est gâchée par ce que leur imagination en fait ou en fera, chacun de leurs coups de reins, affaibli par une phrase. Lorsque je leur parle pendant l’amour, j’entends presque leurs "murmura-t-elle".»


