La région du Bas-Saint-Laurent est à son apothéose en fin d’été, quand la foule des vacanciers est rentrée au bercail et que la nature est à son apogée de verdure. Entre Kamouraska et Rimouski, la bucolique route 132, dite Route des navigateurs, garde presque toujours un œil sur le fleuve Saint-Laurent. Entre terre et mer, partez à la découverte de trois sites de choix pour une aventure plein air.
Perché sur un monadnock
Kamouraska, porte d’entrée ouest du Bas-Saint-Laurent, a pour trait naturel distinctif la présence de plusieurs «monadnocks» dominant l’estuaire fluvial. Ces «montagnes isolées», en langue abénakise, sont aussi localement appelées «cabourons». Ces collines se succèdent, présentant un relief où affleure le roc couleur blanchâtre, à haute teneur en quartzite. Rescapés de l’érosion glaciaire au retrait de la mer de Champlain, les monadnocks font le bonheur des marcheurs et grimpeurs, notamment à Saint-André-de-Kamouraska et Saint-Germain-de-Kamouraska.
Sur le territoire de cette dernière commune, j’ai fait un arrêt dernièrement aux Perchoirs du Cirque, juste après l’entrée du Cirque de la Pointe-Sèche, lequel poursuit jusqu’au 1er septembre la présentation en plein air de son spectacle L’étranger. Haut en couleur, il met en vedette des acteurs-acrobates sur une scène bien particulière: une paroi rocheuse.
À deux pas, on pénètre sur le site des Perchoirs du Cirque, projet d’hébergements insolites qui s’inspirent des prouesses acrobatiques des artistes circassiens. Leurs sept «perchoirs» portent très bien leur nom. Ils sont quasiment suspendus au roc, bien intégrés dans leur milieu naturel et suffisamment éloignés les uns des autres pour préserver l’intimité. La créativité architecturale est à l’honneur pour chacun. Bienvenue dans ces nids aériens aux formes vraiment originales, avec vue sur le Saint-Laurent.

Sac au dos, j’ai moi-même grimpé sous la pluie pendant une quinzaine de minutes de marche en forêt depuis le stationnement avant de déboucher sur l’un des deux derniers-nés de ces hébergements: l’Ovum.
Quelques marches d’escalier en bois conduisent à une terrasse dominant le fleuve et les îles du Kamouraska, d’un côté, les collines où roches et arbres se disputent la vedette, de l’autre. Entièrement plastifiée de tous côtés, la «chambre» de l’Ovum sera pour moi comme un phare dans la nuit, la pleine lune de ce soir-là (même voilée) créant une luminosité sans pareil côté fleuve. À chaque réveil, on se serait cru dormant à la belle étoile, mais c’est bien à l’abri de la pluie battante (et des moustiques) dans un lit tout confort qu’on rejoint les bras de Morphée.

Pour ces séjours minimalistes côté luxe (sans douche, ni eau courante, ni appareil de cuisson), on vous reçoit néanmoins avec tout ce qu’il faut pour un bon apéro (vin, bière locale, produits alimentaires locaux) et le petit déjeuner pour deux.

Pour agrémenter le séjour, rien de tel qu’un petit tour sur le tout nouveau Sentier du Monadnock (2,5 km environ) aménagé depuis le site dans l’arrière-pays. Il permet de bien profiter du relief des monadnocks et de leur ambiance particulière. Aménagé au minimum, le sentier débute sur le chemin menant aux perchoirs et grimpe vers le nord en forêt. Il redescend pour traverser le chemin Rankin, puis joue de nouveau les montagnes russes pour s’élever à 190 m de haut en opérant une jolie boucle de 1 km. Elle permet de s’en mettre plein la vue à 360 degrés avant de revenir sur le sentier de départ, en pleine forêt.
En prime, on peut traverser la route face au stationnement du Cirque de la Pointe-Sèche, pour se rendre au bord du fleuve via le marais littoral qu’affectionnent les oiseaux. À vous l’air marin!
À noter: les Perchoirs du Cirque sont en location jusqu’au 15 octobre inclus.

À la recherche du béluga
Tout nouveau, tout beau à Cacouna, le Site d’observation des bélugas Putep ’t-awt entame la dernière ligne droite de sa première saison (avec fermeture le 2 septembre), mais on espère bien que l’année 2025 verra ce formidable projet, à la fois scientifique et récréotouristique, jouer les prolongations avec ouverture élargie au printemps comme en automne.
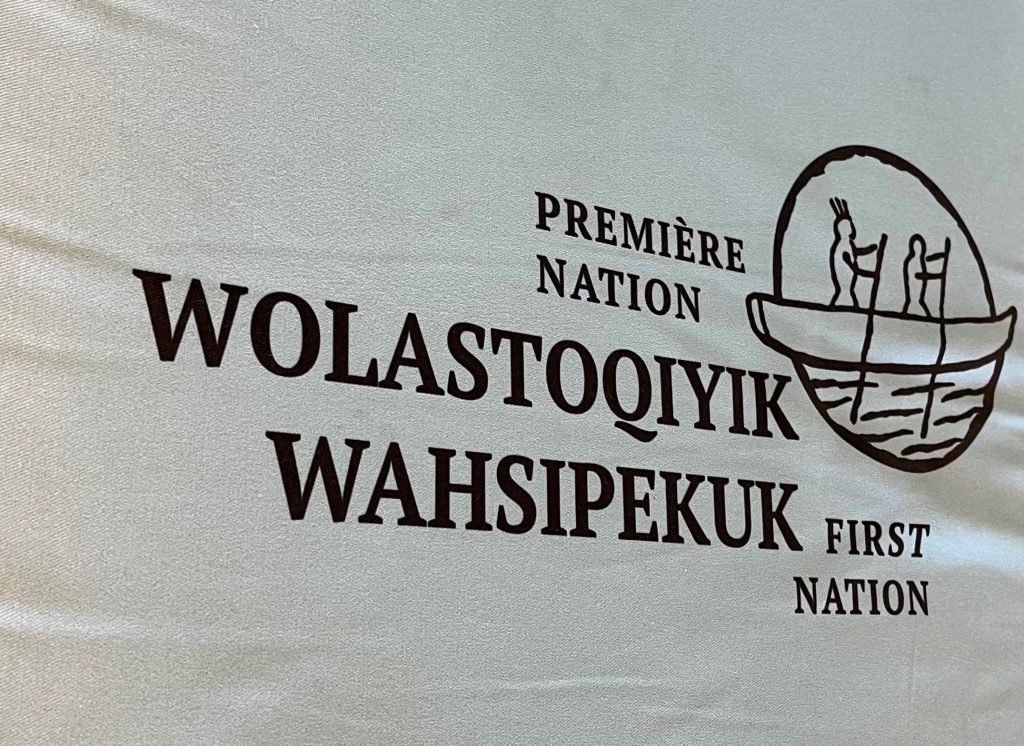
Le lieu donne un accès privilégié à la partie ouest de la montagne de Gros-Cacouna, qui domine le port de Gros-Cacouna et une baie réputée être l’un des meilleurs sites d’observation des bélugas. On le rejoint en bus-navette depuis la boutique de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, maître d’œuvre du projet, ou à pied depuis le stationnement du Site ornithologique du marais de Gros-Cacouna. Belle occasion d’observer des oiseaux avant de poursuivre sur le chemin de gravier menant au pied de la colline. De là, on peut emprunter le Sentier de la falaise, qui file sur 2 km vers les hauteurs, ou se contenter d’un plus court chemin de gravier.

Agrémentés de panneaux d’interprétation sur la culture Wolastoqey et la nature environnante, tous deux conduisent à des belvédères dominant le Saint-Laurent. Au terme de la promenade, on atteint l’observatoire terrestre des bélugas, bâtiment en deux espaces distincts, l’un dédié à la recherche sur les bélugas et l’autre réservé aux visiteurs. En compagnie d’un guide-interprète, l’activité «Fenêtre sur les bélugas» est bien conçue, avec beaucoup de vidéos, et permet d’en apprendre plus sur ce mammifère marin qui fréquente assidument les eaux du Saint-Laurent.

Fruit d’un partenariat étroit avec le GREMM (Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins, basé à Tadoussac) et le ROMM (Réseau d’observation des mammifères marins), l’observatoire permet – avec un peu de chance – d’observer des bélugas avec des jumelles, mais aussi de profiter du travail des chercheurs. Nouveauté des dernières années: ceux-ci utilisent des drones pour parfaire leurs connaissances des bélugas et les images rapportées sont retransmises à l’écran dans la salle de l’observatoire. Le drone est bien utile pour observer les bélugas de haut, en transparence dans leur habitat marin, alors qu’ils ne sont pas dérangés par les moteurs de bateaux. La photo-identification, avec traits distinctifs, en est facilitée, de même que l’étude de leurs comportements. Lors de notre participation à l’activité «Fenêtre sur les bélugas», la guide-interprète nous a même fait entendre un surprenant enregistrement de sons et vocalises de bélugas intercepté cet été depuis un voilier à l’aide d’un hydrophone.
À Cacouna, on peut aussi explorer la partie est de la montagne de Gros-Cacouna à partir du Parc côtier Kiskotuk, via la boucle du Sentier de la Montagne (4,6 km), accessible par la Route de l’île.
Les deux pieds dans le fleuve
De la marina de Rimouski, quelques minutes suffisent pour se rendre en navette maritime à l’île Saint-Barnabé, à moins de 2 km à vol d’oiseau. L’île est un véritable joyau, un havre de paix qu’on découvre à la journée ou en camping rustique. Longue de 6 km, elle n’a jamais plus de 300 m de large. Elle présente un certain relief au centre, mais on y marche largement sur le plat, en sentier ou sur la grève, en respirant l’air marin, rempli d’effluves d’algues à marée descendante, mais aussi de doux parfums de rosiers sauvages.

Du lieu de débarquement sur l’île à sa pointe est, une première boucle de 3 km permet de de découvrir le nord de l’île – le plus sauvage, face au grand large de l’estuaire du Saint-Laurent – et de rentrer par la rive sud, où les milieux humides sont plus nombreux et avec la ville de Rimouski en arrière-plan.

Au choix: on peut suivre un sentier, en lisière de littoral, ou marcher sur la grève. Le sol y est bien particulier, tout en strates rocheuses nées de la collision des plaques tectoniques qui ont créé la chaîne des Appalaches. Résistante aux conditions maritimes, l’épinette blanche est reine du couvert forestier côté nord, tandis que le littoral s’avère un vrai jardin floral qu’embaument les rosiers sauvages, les gesses maritimes, iris et séneçon faux-arnica, entre autres.

Une deuxième boucle de 4,5 km englobe le secteur des campings rustiques tandis que la troisième ouvre à l’exploration complète de l’île (en 12 km), avec sa partie ouest, plus sauvage encore, au programme. Après un long périple par la rive nord de l’île, on vire alors à la pointe ouest pour découvrir le Lac à Canards, site d’observation ornithologique de renom, notamment pour plusieurs espèces de canards nicheurs.

L’île en entier est un repère d’oiseaux, tant terrestres qu’aquatiques. Plus de 180 espèces y ont été observées. Leur abondance et leur diversité s’expliqueraient à la fois par sa situation unique dans l’estuaire du Saint-Laurent, où transitent les oiseaux migrateurs, et par la présence d’habitats bien diversifiés sur une île isolée, relativement à l’abri de prédateurs terrestres.

Les sentiers sont dotés de nombreux panneaux d’interprétation sur la faune et la flore de l’île, mais aussi sur son occupation humaine, retracée également dans deux espaces muséaux. Lieu de contrebande, site de nombreux naufrages, refuge pour un ermite du nom de Toussaint Cartier, terre de cultures, d’exploitation forestière ou de pêche à la fascine: l’aventure humaine a aussi marqué cette île si bien préservée.

Bon à savoir: traversées à bord du Rimouskois jusqu’au 29 septembre, mais seulement du jeudi au dimanche à partir du 2 septembre. Camping sur plateformes, à 1,5 km à pied de l’accueil, avec chariots à disposition.

Une bonne adresse
Domaine Floravie: ce site écotouristique occupe une bonne partie de la presqu’île située à l'embouchure de la Rivière-Hâtée, à Rimouski. Dans ce lieu enchanteur, face au fleuve, de jolis «chalets sur roues» sont offerts à la location, de même que deux chalets et six cabines (chambres pour une personne avec toilettes).
En plus de profiter du terrain donnant accès à pied à la Pointe à Santerre, on peut aussi emprunter le Sentier de la montagne (4,5 km) qui court en forêt sur les hauteurs du Domaine Floravie. Il aboutit sur le chemin de la Pointe, dans l’archipel du Bic. Un belvédère côté fleuve se trouve à 1 km du départ.
Vient de paraître
Randonnée pédestre au Québec est en quelque sorte la «bible» du marcheur québécois. Les Guides Ulysse publient la dixième édition de cet ouvrage recensant l’ensemble des sentiers accessibles dans les 20 régions du Québec, de Montréal aux Îles-de-la-Madeleine, en passant par l’Outaouais et Eeyou Istchee Baie-James, avec force détails pratiques sur les sites de plein air ou sentiers visés.
Les randonnées, classées faciles, difficiles ou très difficiles, vont de la courte balade à la longue randonnée sur plusieurs jours. Créé par l’auteur Yves Séguin, le guide a été entièrement revu et bonifié par Simon Deschênes, et «dynamisé par une présentation en couleurs agrémentée de splendides photographies», précise l’éditeur.
Il est assorti d’une bonne dose de trucs et conseils pratiques sur la randonnée, l’alimentation, l’équipement, l’entraînement, le rythme de marche à adopter, les blessures, l’hypothermie… On y trouve également une liste de «coups de cœur Ulysse» et d’autres sur les randonnées accessibles avec un chien, celles propices à l’observation de la faune et de la flore, les randonnées à caractère historique, les balades pour les familles, celles qu’on peut faire proche de l’eau ou qui offrent les meilleurs points de vue, les sites propices à la course en sentier, sans oublier les randonnées hivernales.















































