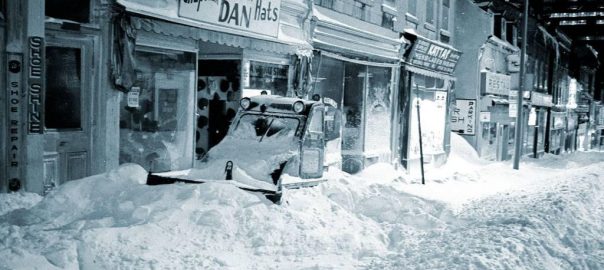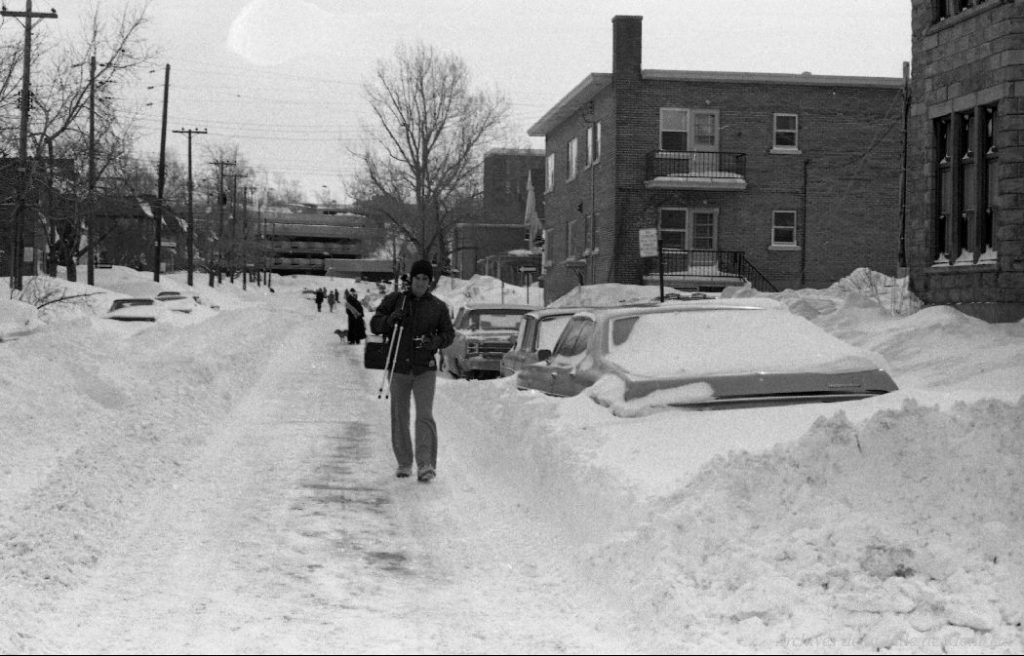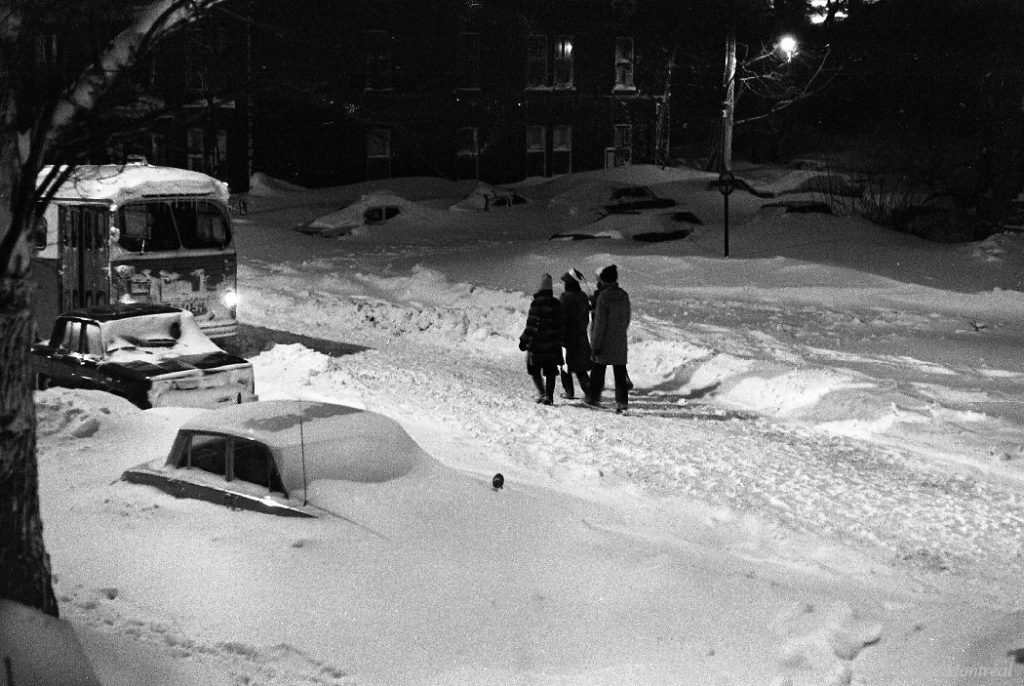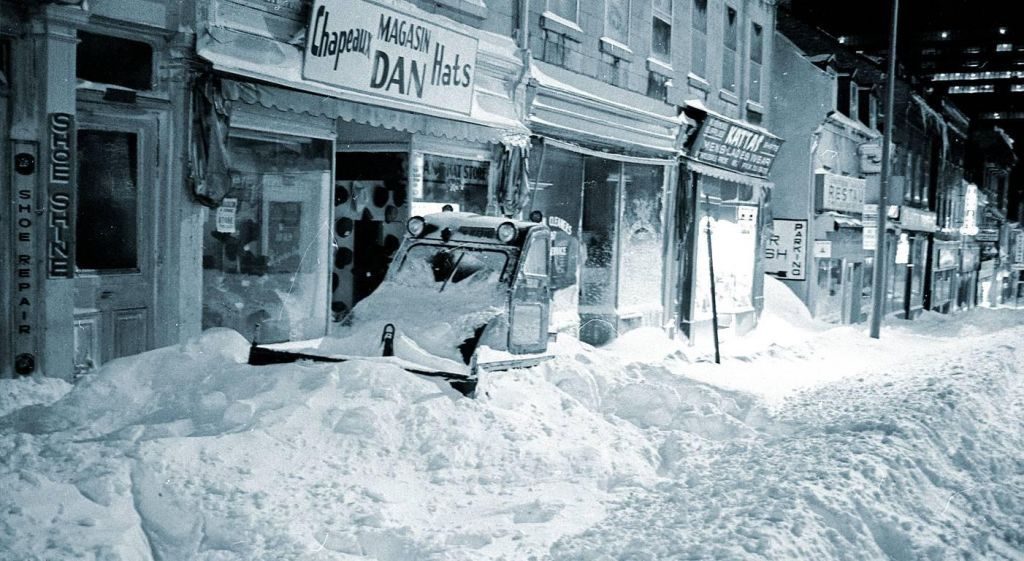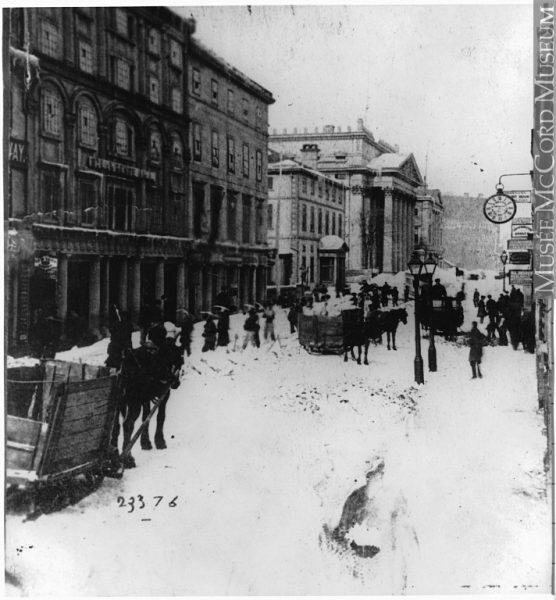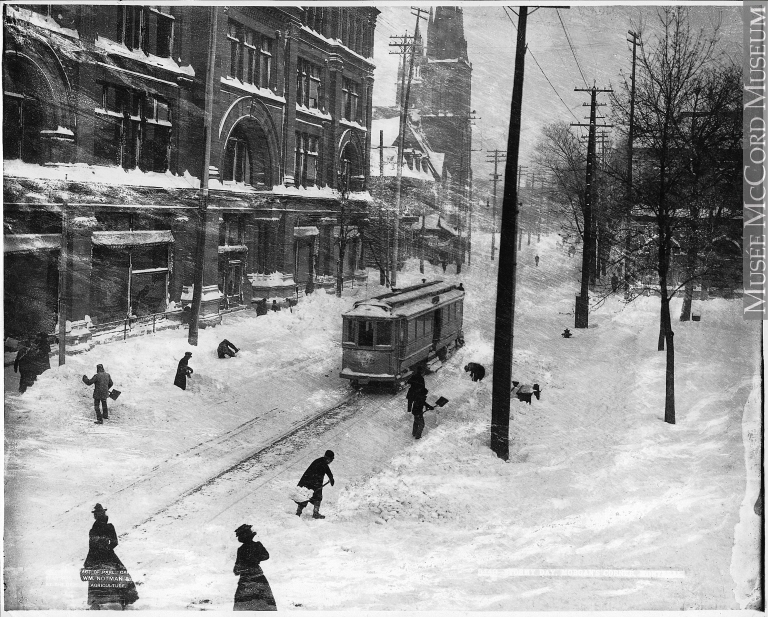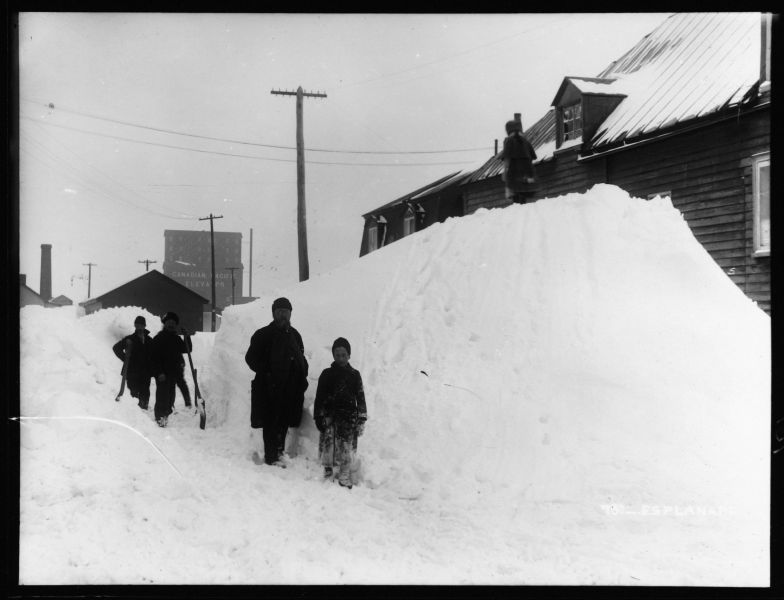Si la neige a quasiment disparu de Montréal, tel n’est pas le cas partout dans la province. Les amoureux de la glisse, de la raquette ou du fatbike ont encore de beaux jours devant eux. Tour d’horizon, en invitant cependant au respect des normes de la Santé publique concernant les déplacements non recommandés d’une région à une autre et le port du couvre-visage... même s’il fait chaud!
Météo, spéciale «giboulées de mars»
On a beau s’y attendre année après année, le mois de mars et ses giboulées nous surprennent toujours. Les températures jouent au yoyo entre - 10 et + 20 degrés dans la même journée... mais ce n’est pas pour longtemps! Dès cette fin de semaine, il faudra remettre le Goretex (ou l’imperméable) pour sortir jouer dehors.
En début de semaine, Météomédia prévenait qu’«alors que le réchauffement des températures semble bien amorcé, avec trois records de chaleur le week-end dernier… c’est la neige qui pourrait faire son retour d’ici la fin de la semaine». Des bordées de neige sont en effet attendues dans plusieurs coins du pays, de l’Abitibi-Témiscamingue à la Gaspésie, en passant par la région de Québec d’ici fin mars. Ne rangez donc pas trop vite vos skis alpins, skis de fond, raquettes ou fatbikes… Sinon, vous risquez de trouver le temps drôlement long jusqu’au vrai printemps!
Ski alpin de printemps
Quel bonheur de se dévêtir un peu pour profiter de la glisse sur une piste de ski alpin! Les stations proches de Montréal sont en voie de fermeture, mais ailleurs, plusieurs vont continuer leurs opérations jusqu’au 5 avril, voire bien au-delà.
Le Valinouët
Au palmarès de l’enneigement, la station Le Valinouët, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, est toujours la championne du Québec avec 461 cm reçus au 22 mars, selon l’Association des stations de ski du Québec, qui compile les statistiques de ses 75 membres. Elle en avait reçu le double l’hiver passé, mais il en reste tout de même pour quelques semaines sur ses 32 pistes de neige naturelle.
Le parc régional de Val d'Irène
Deuxième sur le podium de l’enneigement, avec 436 cm reçus, le parc régional de Val d’Irène, en Gaspésie, se glorifie aussi d’offrir un terrain de jeu avec 100% de neige naturelle. Il devrait demeurer ouvert jusqu’au 18 avril, du vendredi au dimanche!
La station touristique du Massif du Sud
Troisième pour l’enneigement, avec 374 cm reçus cet hiver, la station touristique du Massif du Sud, dans Chaudière-Appalaches, prévoit pour sa part ne pas fermer avant le 18 avril et peut-être même le 25. «Il y a encore du très beau ski à faire» sur ses 33 pistes, avec 10 en sous-bois, précise-t-on sur le site. La montagne étant orientée face au nord, la neige fond moins qu’ailleurs.
La station Gallix
La station Gallix, à Sept-Îles, sur la Côte-Nord, fermera ses portes le 4 avril cette année. Pour ceux qui vivent sur la Côte-Nord, voilà une belle petite station qui se mérite année après année un superbe enneigement (370 cm cet hiver), avec des tempêtes de neige souvent mémorables en avril.
Mont-Tremblant
Mont-Tremblant, dans les Laurentides, arrive au cinquième rang pour l’enneigement cette année (354 cm). La station vient d’interrompre le programme «premières traces», qui permet aux lève-tôt d’aller skier avant les autres, mais sinon, la plupart de la centaine de pistes de la station sont ouvertes jusqu’au 18 avril.
Stoneham
À la station de Stoneham, à 20 minutes au nord de Québec, le ski de soirée est terminé pour la saison, mais une bonne part des 43 pistes vous attendent pour encore deux bonnes semaines, jusqu’au 5 avril, avec conditions printanières assurées.
Mont-Sainte-Anne
Au Mont-Sainte-Anne, fort de 340 cm de neige reçue depuis décembre, on garde la date du 11 avril comme limite d’ouverture cette saison.
Mont Sutton
Nappée d’une belle neige fraîche mi-mars, la station du Mont Sutton «en a encore beaucoup même si la surface est un peu rigide et rapide». Elle avait encore cette semaine 56 pistes sur 60 ouvertes. «Dans l’ensemble, du beau ski vous attend», promet encore la station des Cantons-de-l’Est.

Massif
Finie la luge, mais pas le ski alpin au Massif, dans Charlevoix, où la saison de glisse perdure jusqu’au 11 avril, avec vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent!
À noter: Plusieurs stations mettent en vente depuis quelques jours leurs cartes de saison pour l’hiver prochain, avec des réductions allant parfois jusqu’à 25% et la possibilité d’utiliser ces cartes pour skier dès maintenant.
Ski de fond, randonnée alpine, raquettes, crampons, fatbike
La plupart des centres de ski de fond terminent ces temps-ci le traçage des pistes, mais plusieurs sont encore ouverts pour la pratique de ski de patin comme de ski classique. Même chose pour la raquette, encore bien utile pour randonner en forêt et éviter de trop s’enfoncer dans la neige molle. Là où la neige est plus tapée, l’utilisation des crampons est indispensable, surtout à l’approche de sommets où les plaques de glace peuvent être dangereuses. La plupart des lieux de pratique de randonnée alpine (montée avec peaux d’ascension, descente sur pistes damées ou non) accueillent aussi les skieurs. Quelques exemples ci-dessous:
Parc national du Mont-Mégantic
Le parc national du Mont-Mégantic annonce que «les sentiers de ski de fond ne sont plus tracés», ce qui n’exclut pas de les emprunter. «Le port de raquettes à crampons est recommandé pour tous les sentiers», précise-t-on également sur le site de la SÉPAQ.
Parc national de la Gaspésie
Au parc national de la Gaspésie, où la neige est reine souvent jusqu’en mai, les sentiers de raquette et de ski nordique, notamment pour grimper sur les hauteurs des Chic-Chocs, sont ouverts et les sentiers de ski de fond sont toujours tracés.
Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie
Le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, dans Charlevoix, interdit désormais toute activité sur la rivière elle-même (par souci de sécurité), mais l’ensemble des autres sentiers sont praticables, avec raquettes ou crampons «fortement recommandés». Les locations d’équipements (fatbikes, raquettes, ski-hok et crampons) sont encore possibles également.

Parc régional de la Montagne du Diable
Dans les Hautes-Laurentides, les conditions de neige sont aussi «printanières». Au parc régional de la Montagne du Diable, tous les sentiers de ski de fond, de ski nordique et de raquette sont ouverts, mais l’entretien des pistes est fini depuis le 21 mars. Le parc annonce de très bonnes conditions encore pour le ski de patin mais, au contraire, difficiles pour le ski classique. Quant aux sentiers pédestres, les raquettes sont encore de rigueur.
Mont-Saint-Anne
Le centre de ski de fond du Mont-Saint-Anne poursuit sa saison sept jours sur sept jusqu’à ce dimanche, avec 13 pistes «aux conditions variables». Dernières chances pour le ski de fond: le long week-end de Pâques, puis les 10 et 11 avril «si les conditions le permettent toujours à cette date». Pour le fatbike, six pistes sont encore praticables pour quelque temps aussi.
Sentiers du Moulin
Quant aux Sentiers du Moulin, près de Québec, le fatbike n’y est plus autorisé que le matin. Le traçage des pistes de ski de fond est terminé. Elles sont encore accessibles pour le ski de patin, mais qui peut déjà prendre parfois des allures de «ski de roches». Gare aux égratignures! La raquette est obligatoire pour marcher dans les sentiers dédiés, sauf dans le secteur Maelstrom, où «les bottes sont tolérées lorsque le fond est durci».
Domaine du Radar
Au Domaine du Radar, dans Chaudière-Appalaches, c’en est fini de la luge autrichienne pour cette année, mais on peut encore «visiter» le territoire en raquettes et en ski hors-piste.
Tremblant
À la station Tremblant, les sentiers de randonnée alpine seront en principe praticables jusqu’à la fermeture de la station, le 18 avril, et ceux de raquette, tant qu’il y aura de la neige au sol! Là comme au Domaine Saint-Bernard, le ski de fond et le fatbike ne sont plus possibles, sauf sur la piste du P’tit Train du Nord, où les conditions de neige varient de «glacées le matin à potentiellement mou l’après-midi».