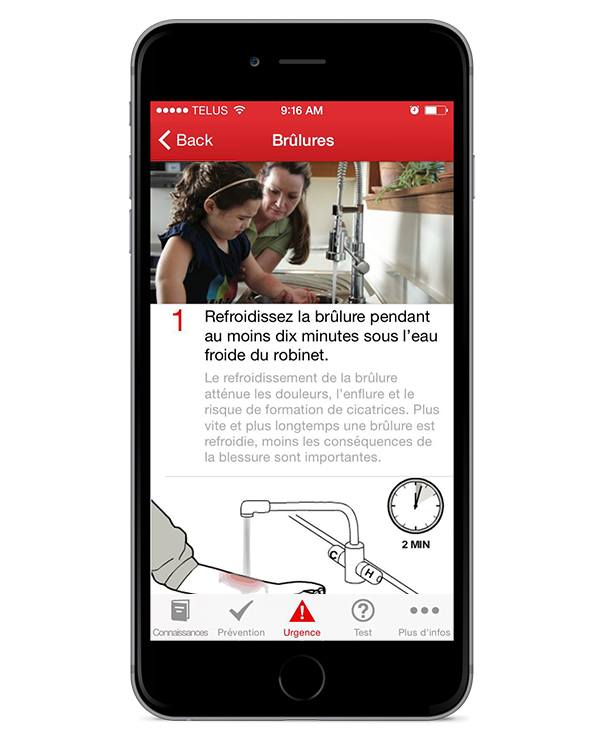Les plus belles scènes arrivent souvent à l’improviste, c'est pourquoi la photographe Annie Rossano capte la plupart de ses clichés avec son iPhone.
Passionnée de portraits humains, j’ai réalisé en regardant mes photos que je transposais cette passion à la faune. Je suis une photographe passionnée, mais paresseuse, qui n’a pas trop envie de s’embarrasser de son appareil photo plein capteur, parce que, de toute façon, les plus belles scènes arrivent à l’improviste.
Comme le disais Normand, un de mes profs de photo, ce qui fait une bonne photo, ce n’est pas l’appareil, c’est le choix du sujet, de la lumière, du cadrage, et d’être en mesure d’utiliser l’appareil au meilleur de ses possibilités. Je travaille généralement avec mon téléphone (iPhone 8, puis 11) pour faire de la photo de nature et d’insectes, puis, ensuite, je fais généralement mes retouches dans Snapseed, une application gratuite.
La famille des appareils mobiles (téléphones portables ou tablettes) constituent de puissant outils: lentilles de qualité avec beau piqué dans les images, possibilité de réduire la profondeur de champ, images Raw, histogramme très performant grâce aux modes HDR ou faible lumière. Puis en postproduction, les tablettes permettent de traiter les images grâce à des applications de plus en plus complètes.
À part quelques exceptions prises à Montréal, la majorité des photos de cette galerie ont été prises à Rawdon, où j’ai la chance d’avoir accès à un plan d’eau très vivant et à ses environs.
1- Joli bourdon
J’ai toujours adoré les bourdons, ils ont l’air de gros toutous volants. Pour réaliser cette photo, j’ai zoomé légèrement à 1.5x, puisqu’au-delà de ce facteur, la photo se détériore rapidement. En postproduction, j’ai légèrement saturé les jaunes, oranges et roses.

2- Une abeille au Jardin
Pour cette image prise au Jardin botanique de Montréal, j’ai zoomé légèrement, toujours en prenant soin de ne pas dépasser 1.5x, ce qui m’a permis de créer un effet de faible profondeur de champ.

3- Une tortue sur la route
Je rentrais à Rawdon avec mes amis Karine et Pablo quand on a vu cette immense tortue serpentine qui traversait lentement la route. Comme ces tortues ont la réputation de croquer les doigts, je ne pouvais pas trop m’approcher, mais sa grosseur a joué en ma faveur, et même si je n’ai pas pu prendre une photo en hyper grand-angle (du téléphone, on s’entend), j’ai tout de même réussi à prendre l’image à 0.8x afin d’avoir la texture qui l’entoure. J’ai eu de la chance pour la lumière, même si je suis un peu allée réduire le contraste entre la tortue et sa carapace. Si vous croisez une tortue, sachez que vous pouvez la signaler sur le site carapace.ca.

4- Araignée pêcheuse
Les Dolomèdes Tenebrosus, aussi appelées araignées pêcheuses, sont parmi les plus grandes araignées du Québec. J’essaie toujours de m’en approcher au maximum, mais souvent, je dois zoomer légèrement parce qu’elles sont farouches.

5- Nouveau lieu de chasse
Tetragnatha en train de visiter son nouveau lieu de chasse, où elle tissera sa toile. Pour cette image, je n’ai pas joué avec le zoom, cependant, pour l’éclairage, j’ai utilisé le mode «spot mètre» de l’appareil, en cliquant sur les fleurs, afin d’éviter de perdre du détail dans les blancs. En postproduction, je suis allée chercher un peu plus de lumière dans les zones d’ombre.

6- Vieux corps nouveau
Je me trouvais vraiment très chanceuse de tomber sur cette scène, juste après la mue, dans ce qui me paraissait être un adieu à son ancien corps avant de repartir pour de nouveaux projets. Pour éviter de déranger la libellule, j’ai fait plusieurs images à plusieurs «focales» de ma caméra de téléphone, puis celle-ci fut la dernière et la meilleure du lot. J’ai zoomé à 1.5x et, pour la lumière et la mise au point, j’ai appuyé sur l’écran pour être en mode «spot mètre». En postproduction, j’ai ajouté un vignettage.

7- Nymphe de libellule
Pour cette magnifique nymphe de libellule, j’ai zoomé à 1.5x pour m’assurer d’avoir une petite profondeur de champ. J’avais pris une photo la veille, mais je n’aimais pas la lumière. J’étais très heureuse de la retrouver le lendemain matin, parce que la lumière met bien en valeur la carcasse vide.

8- Sauvée de la noyade
Cette grosse libellule sauvée de la noyade se sèche les ailes avant de repartir, pendant que je la surveille pour m’assurer qu’elle ne se fasse pas attraper par une dolomède. J’ai profité de son état léthargique pour approcher mon appareil le plus près possible avec un zoom de 1.5x pour réduire la profondeur de champ.

9- Déjeuner sur l'eau
Une des choses que j’adore est d’aller prendre mon déjeuner sur l’eau avec mon chat. Le matin, les nymphéas, fleurs de nénuphars, sont magnifiques et remplis de vie et, surtout, la lumière du matin est magnifique.

10- Araignée d'eau
J’ai suivi quelques instants la vie de cette petite araignée d’eau. Elle avait l’air de bonne humeur et bien occupée. J’ai zoomé à 1.5x pour éviter de lui faire peur, et avec le «spot mètre» de la caméra, j’ai appuyé sur le sujet (sur l’écran) afin d’être certaine d’avoir la petite araignée au point et bien éclairée. Le système HDR de la caméra est très efficace, parce que malgré le contre-jour, j’arrive à avoir un arrière-plan équilibré et du détail dans mes hautes lumières.

11- Champignons architecturaux
Cette photo prise à Montréal détonne un peu comparée aux autres, mais j’adorais l’angle qui donnait des airs architecturaux de grands musées d’art contemporain. Pour obtenir cet effet, j’ai utilisé le grand-angle de la caméra, 0.5x, puis j’ai renversé ma caméra pour qu’elle soit le plus près du sol possible, afin de donner de l’ampleur aux champignons. Ensuite, j’ai mis la photo en noir et blanc dans un logiciel de postproduction.

12- Magnifique chenille
En sortant les sacs de la voiture, mon œil a été attiré par cette magnifique chenille du papillon du céleri en train de se prélasser dans le feuillage de mon fenouil. Je l’ai déplacée sur le balcon parce que j’adorais le contraste, puis, en utilisant la focale normale de la caméra iPhone, je me suis approchée d’elle.

13- Une sacrée frousse!
Une des dolomèdes qui m’aura sans doute le plus fait crier au cours des dernières années. Évidemment, j’ai utilisé le zoom 1.5x pour faire cette photo. Même si elle ne m’aurait pas sauté dessus, je préférais me tenir à distance.

14- Docile grenouille
J’adore photographier les grenouilles, ce sont de petits modèles étonnamment dociles, ce qui m’a permis de calmement mettre ma caméra très près de son visage et de la photographier à grand-angle.

15- Grenouille x 3
Pour ces trois images, j’ai pris la photo sans utiliser le zoom, simplement en me rapprochant le plus d’elle. En postproduction, j’ai augmenté le détail afin d’avoir plus de définition dans l’image.



18- Sauterelle et brins d'herbe
Ici, j’ai fait un zoom de 1.5x, puis j’ai utilisé le «spot mètre» de l’écran pour être certaine que la caméra ne fasse pas le focus sur les brins d’herbe autour d’elle.

19- Plante carnivore
Pour cette photo de Drosera Rotundifolia, je n’ai pas utilisé de zoom. J’ai fait un peu de travail en postproduction pour aller éclairer les ombres sans trop les déboucher, mais juste assez pour avoir un peu de détail, ce qui donne un peu l’effet d’une peinture.

20- Araignée en serre
En visitant la serre de la pépinière DS, j’ai vu cette magnifique araignée dans sa toile. J’ai zoomé à 1.5x pour avoir un arrière-plan flou et la mettre en valeur.

21- Manne poilue
Ce beau spécimen a été photographié avec le zoom 1.5x pour réduire la profondeur de champ.