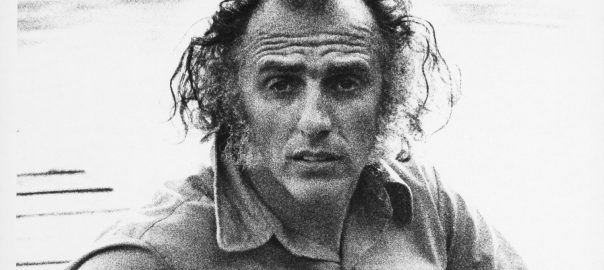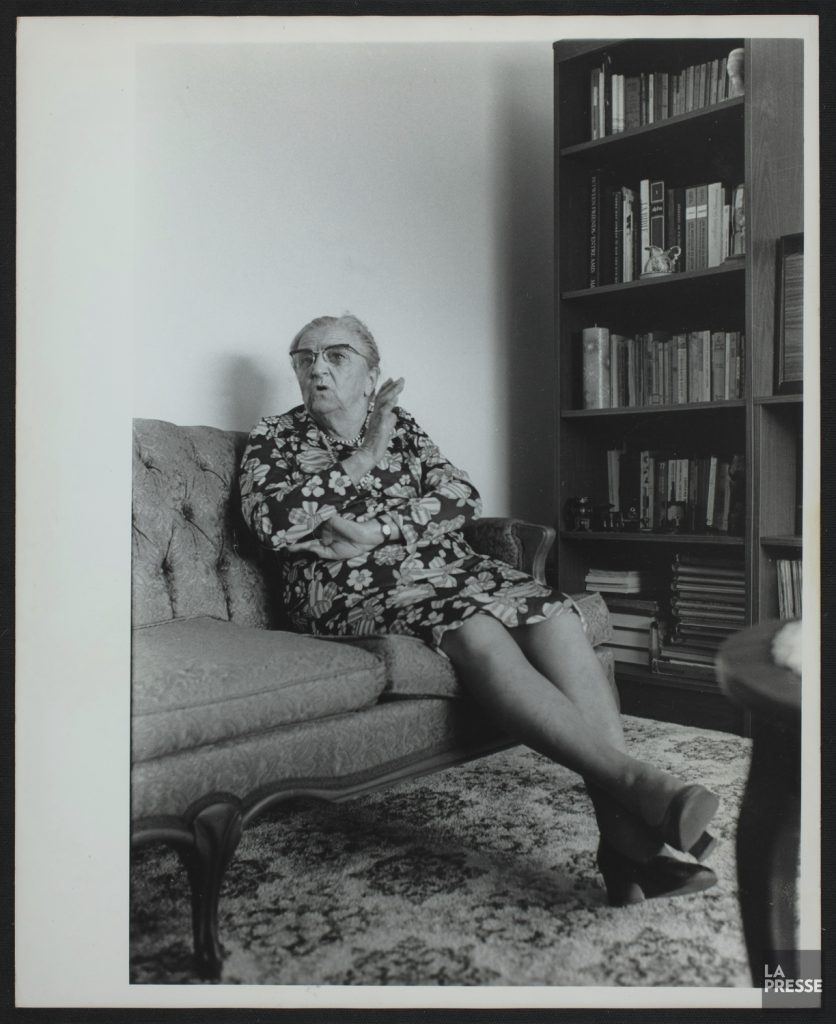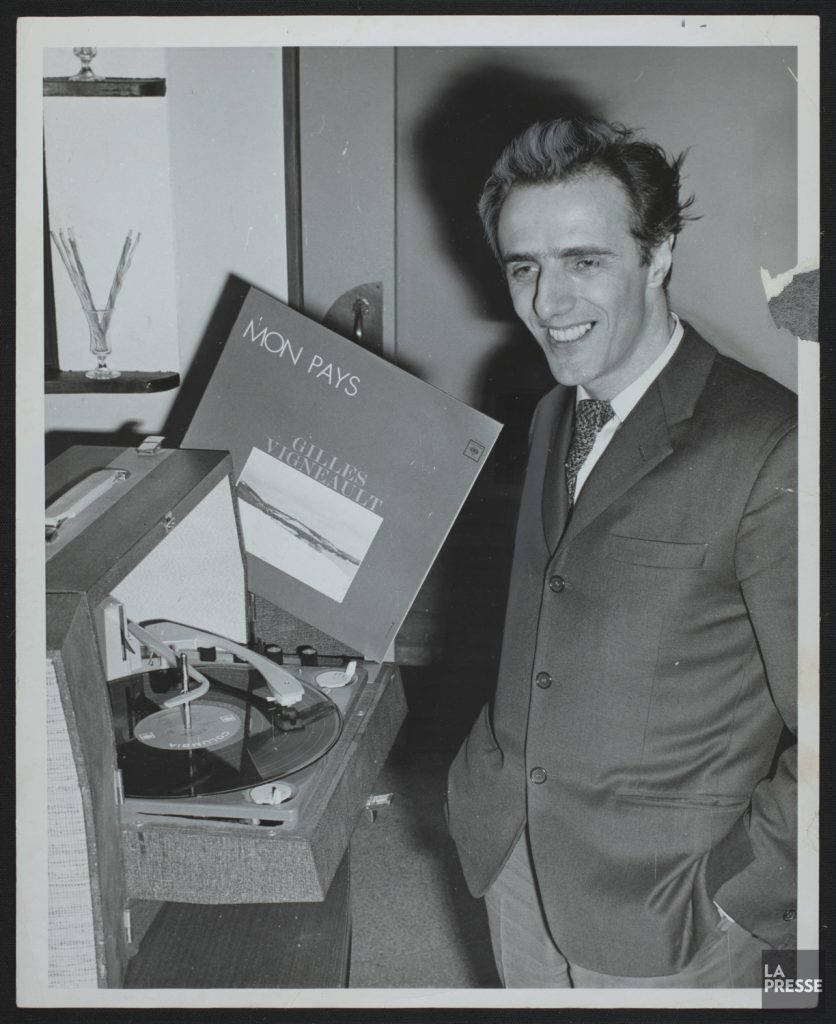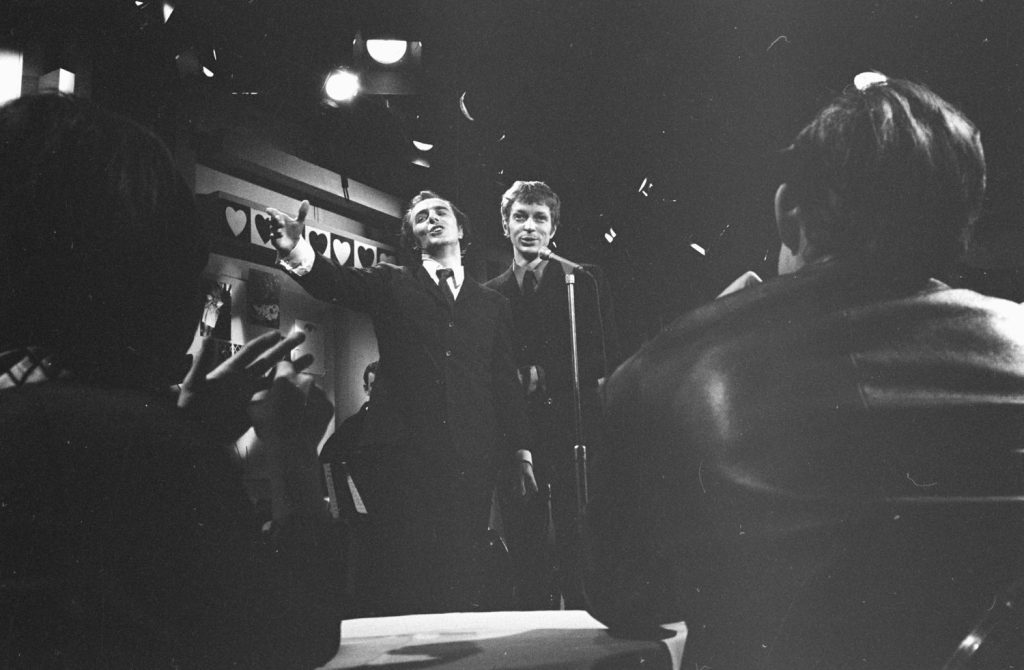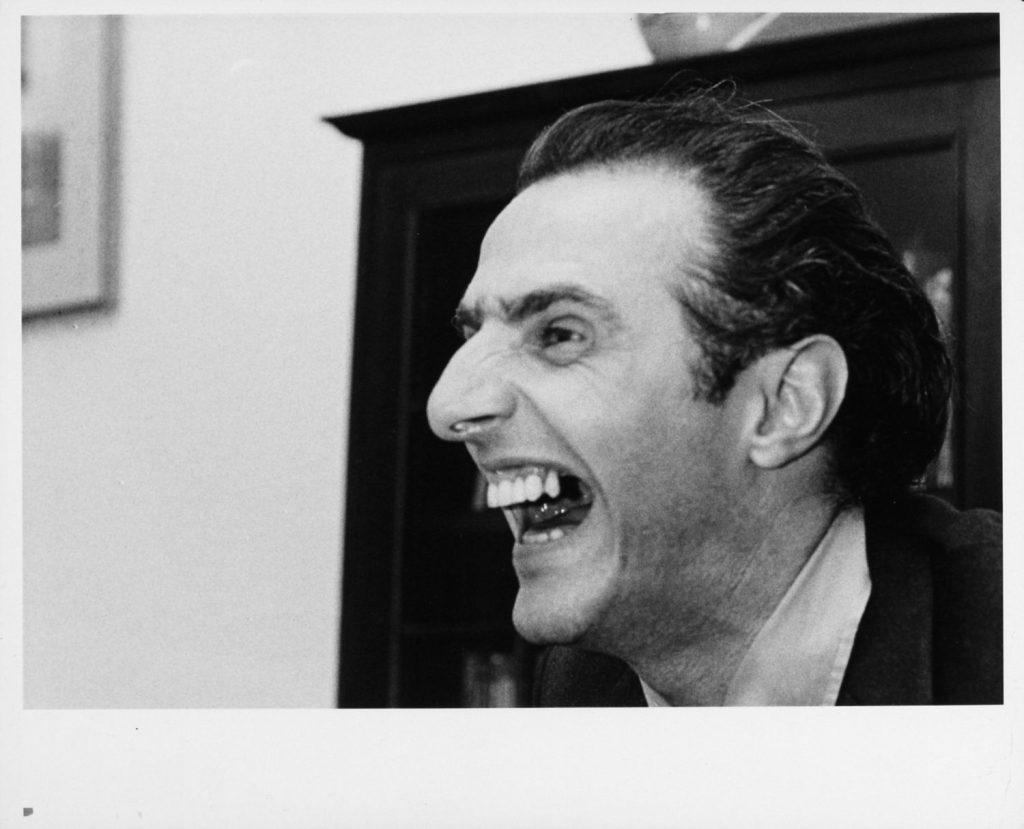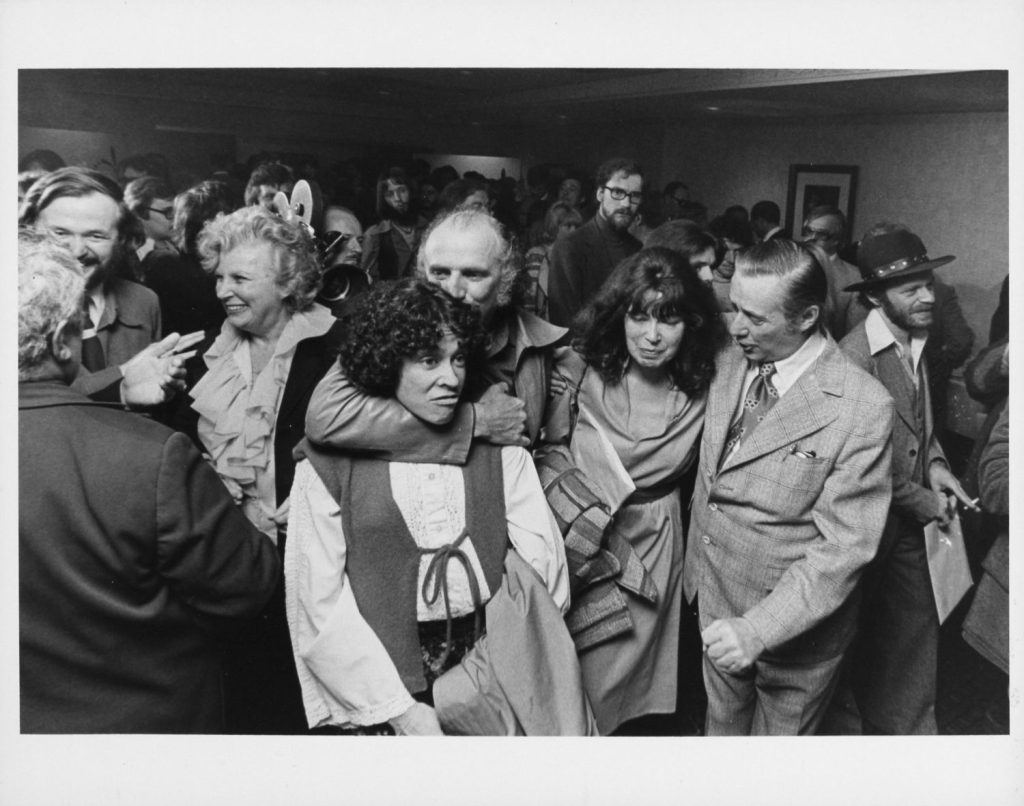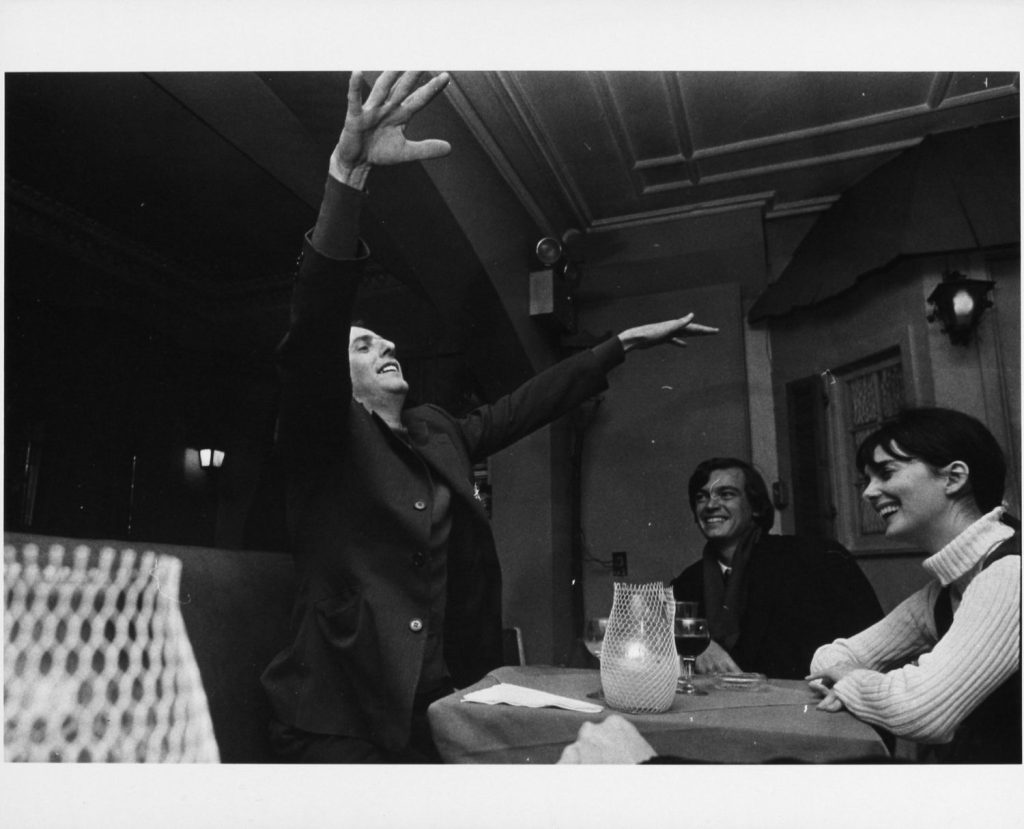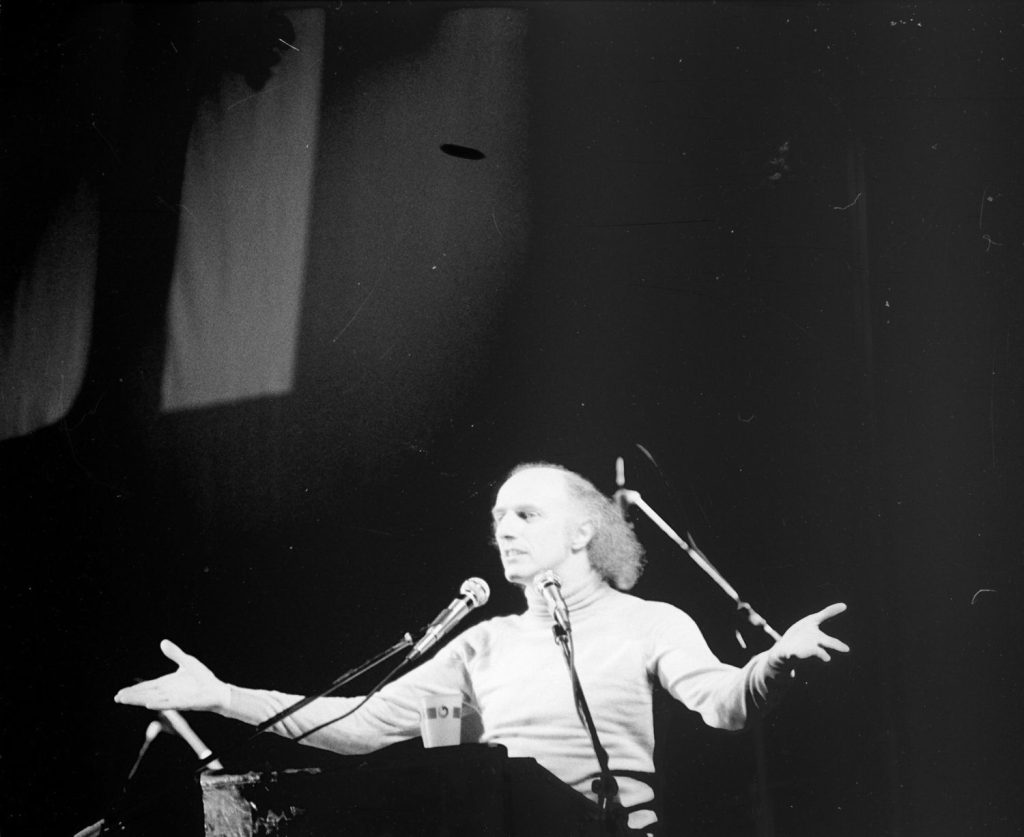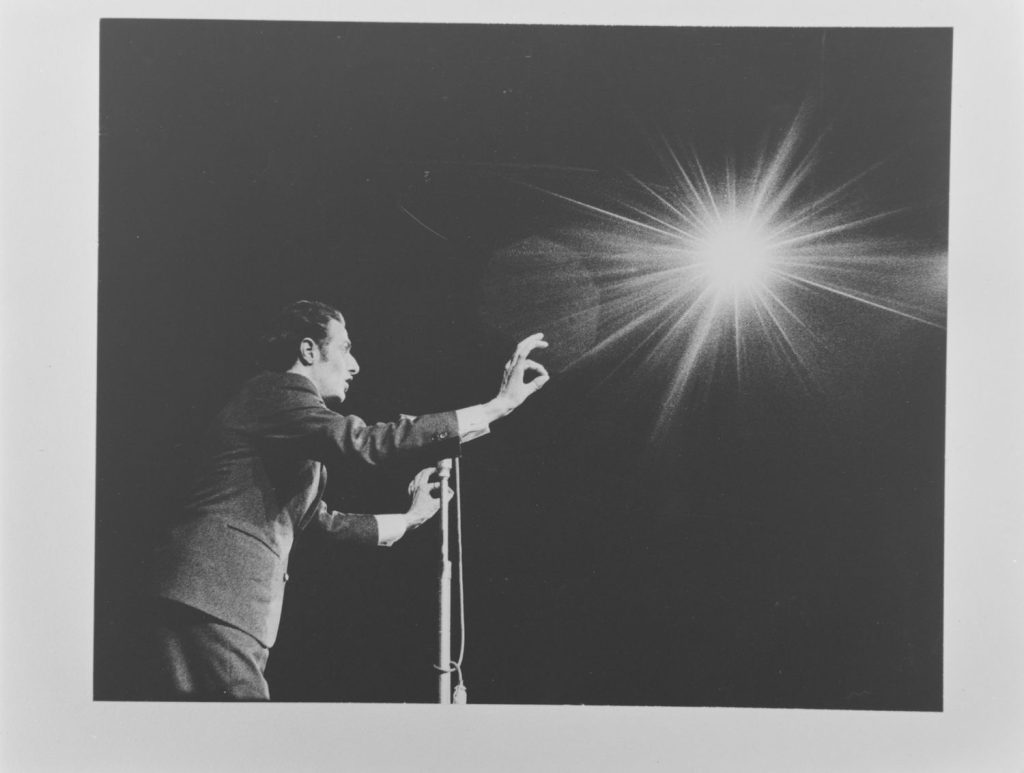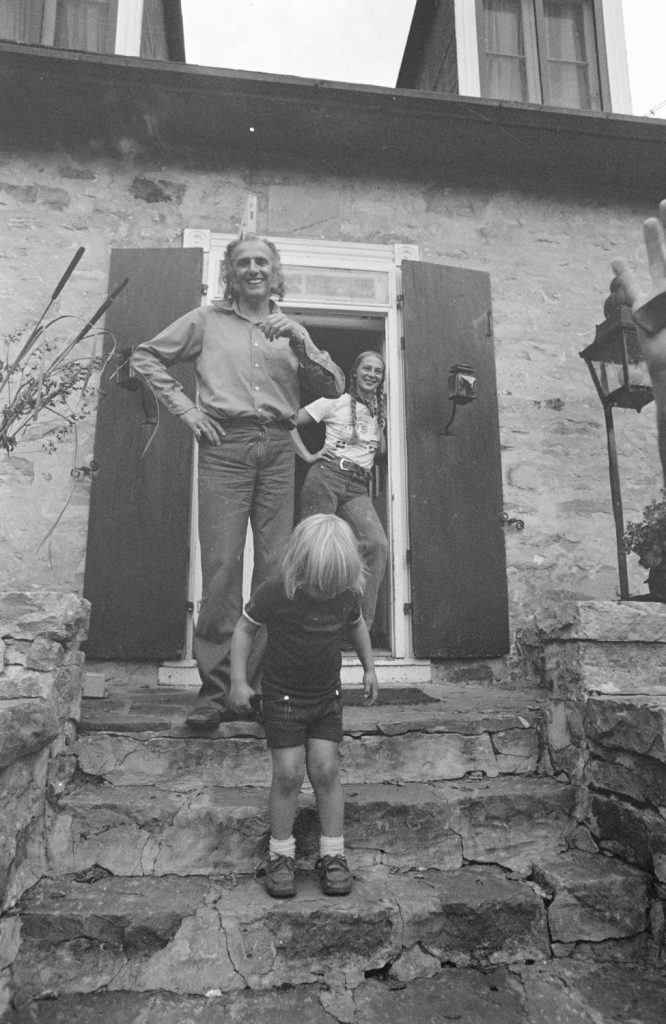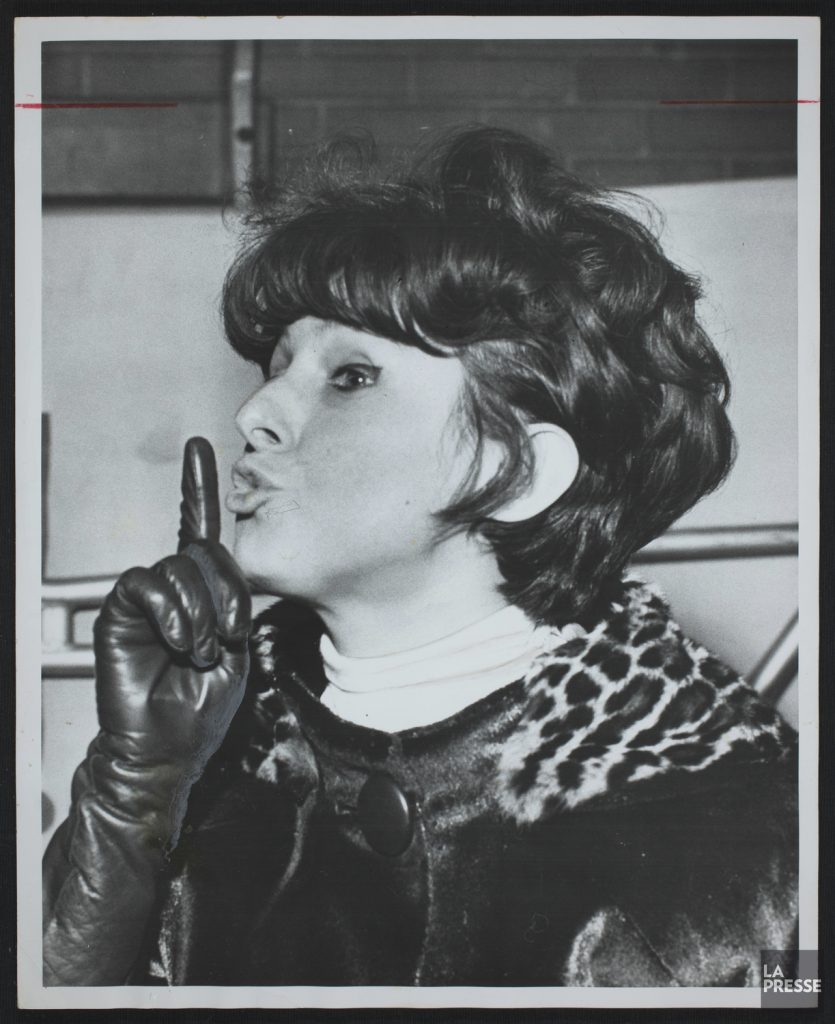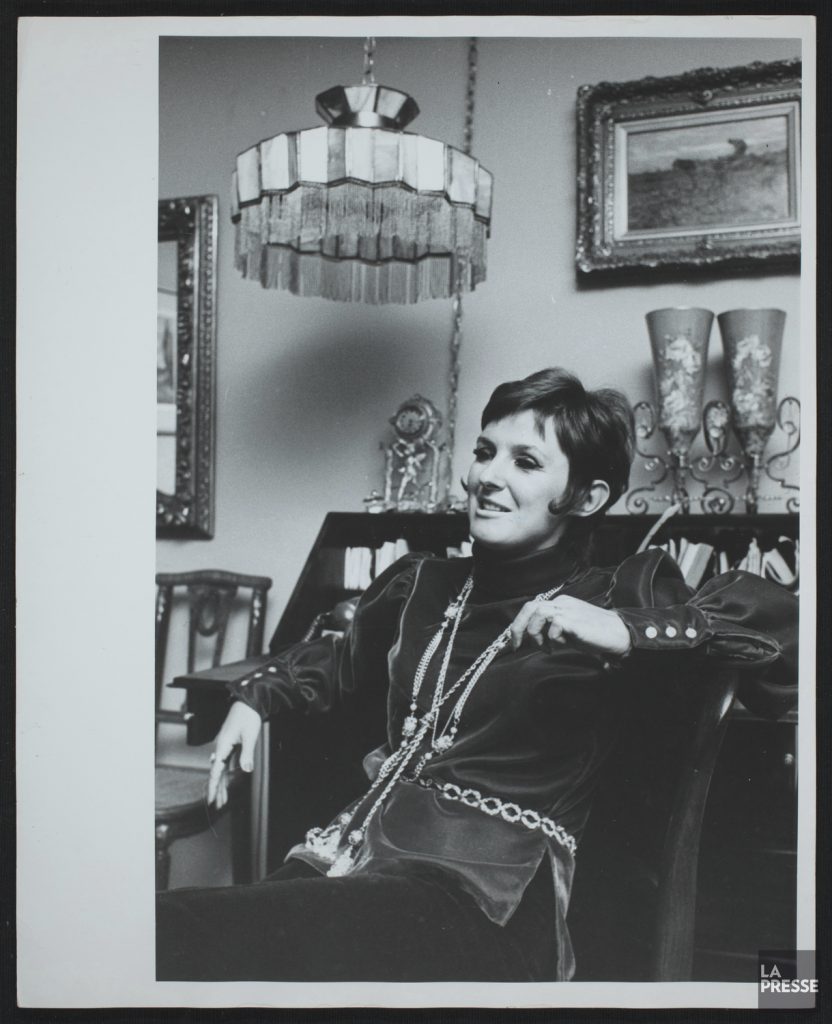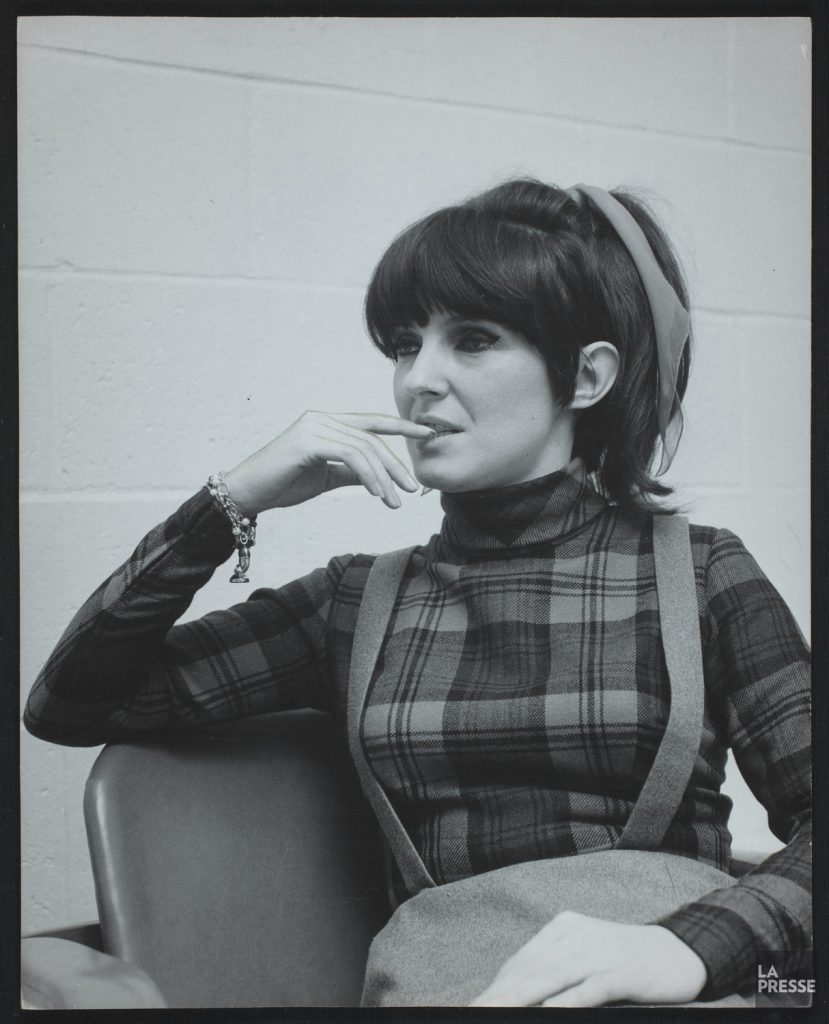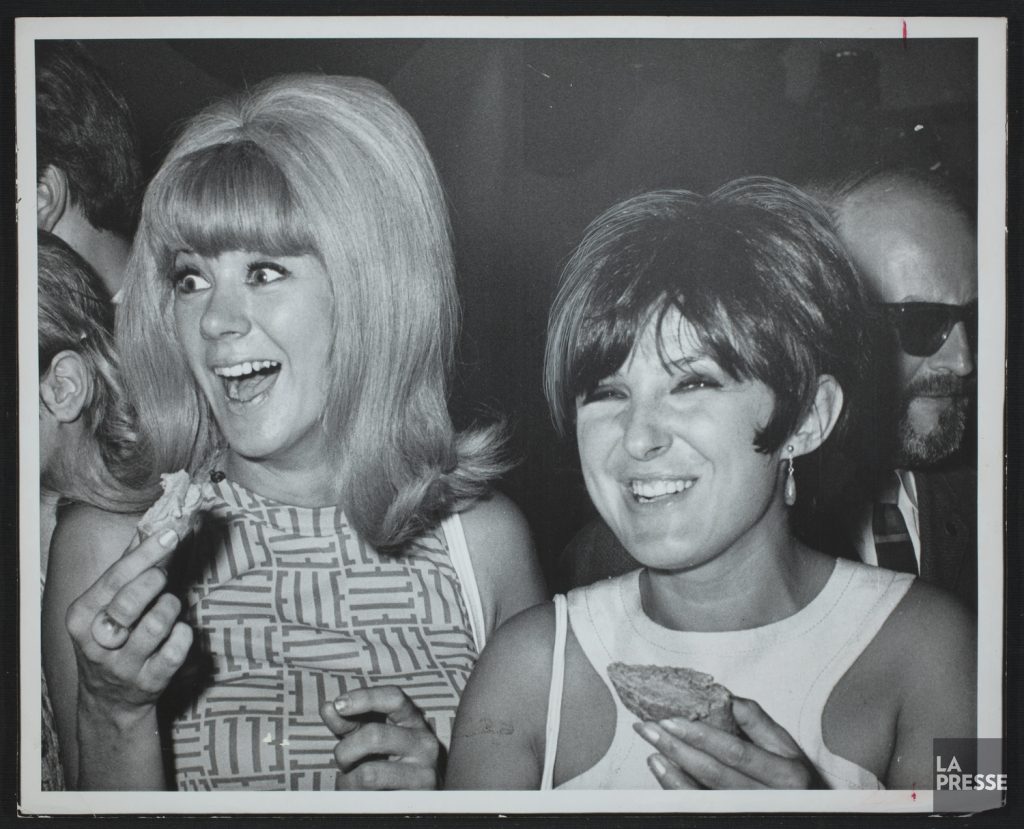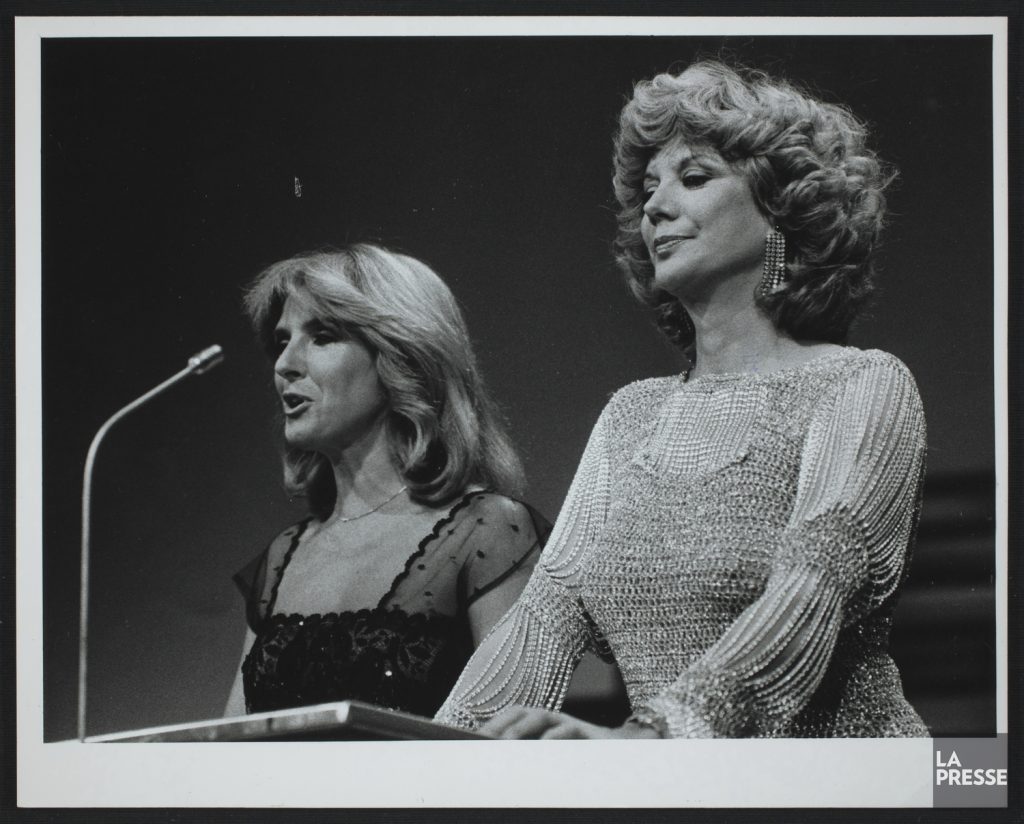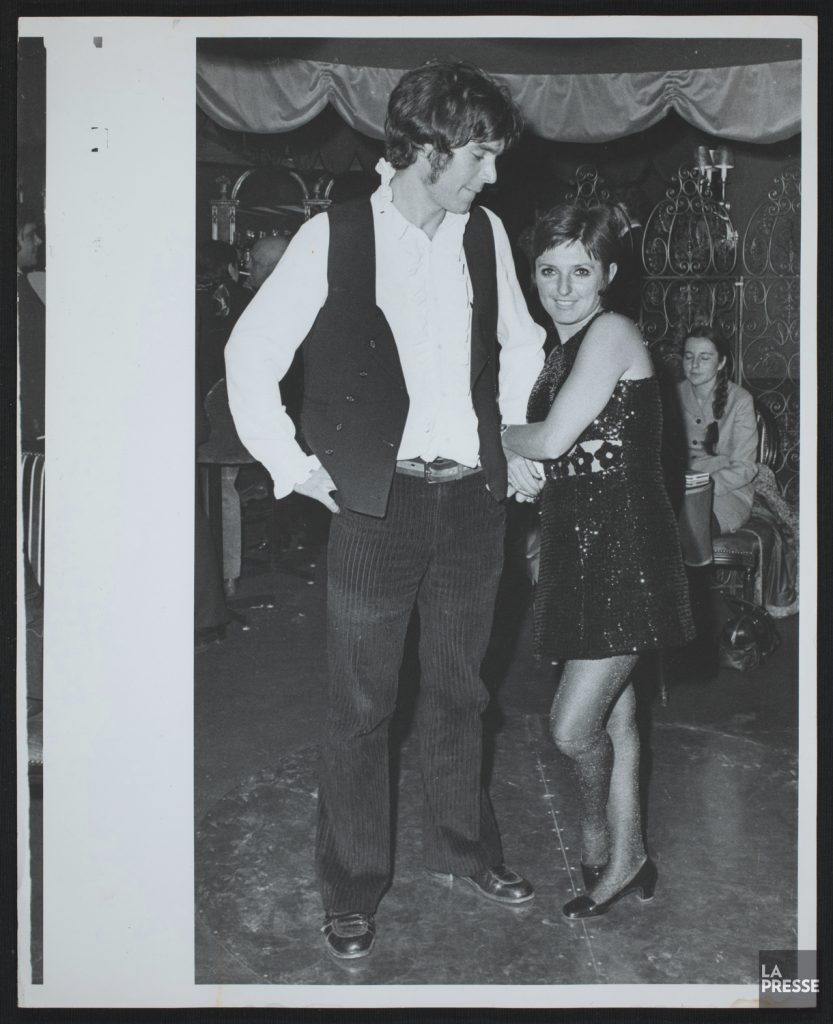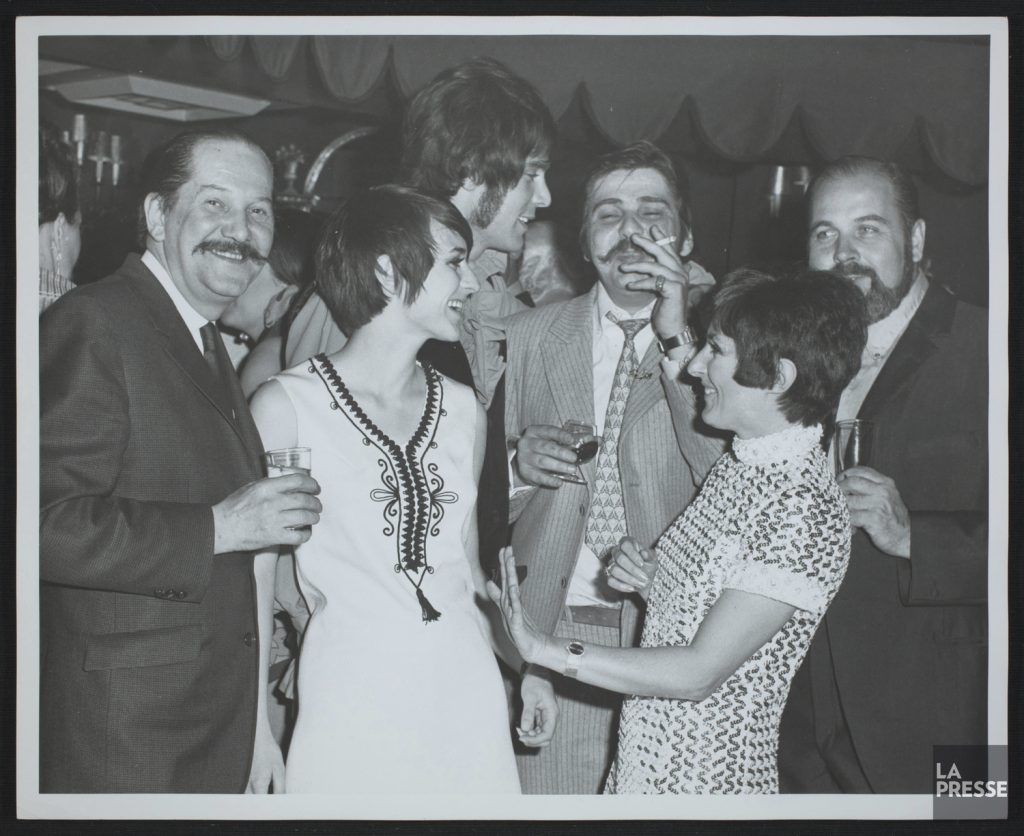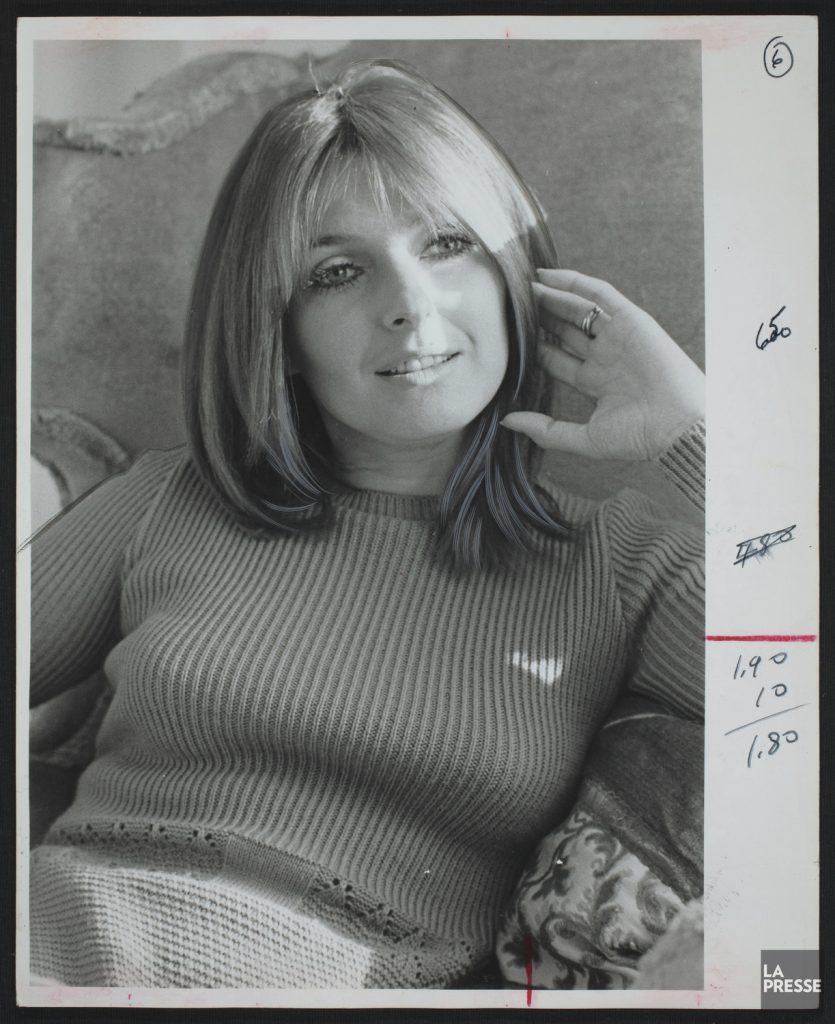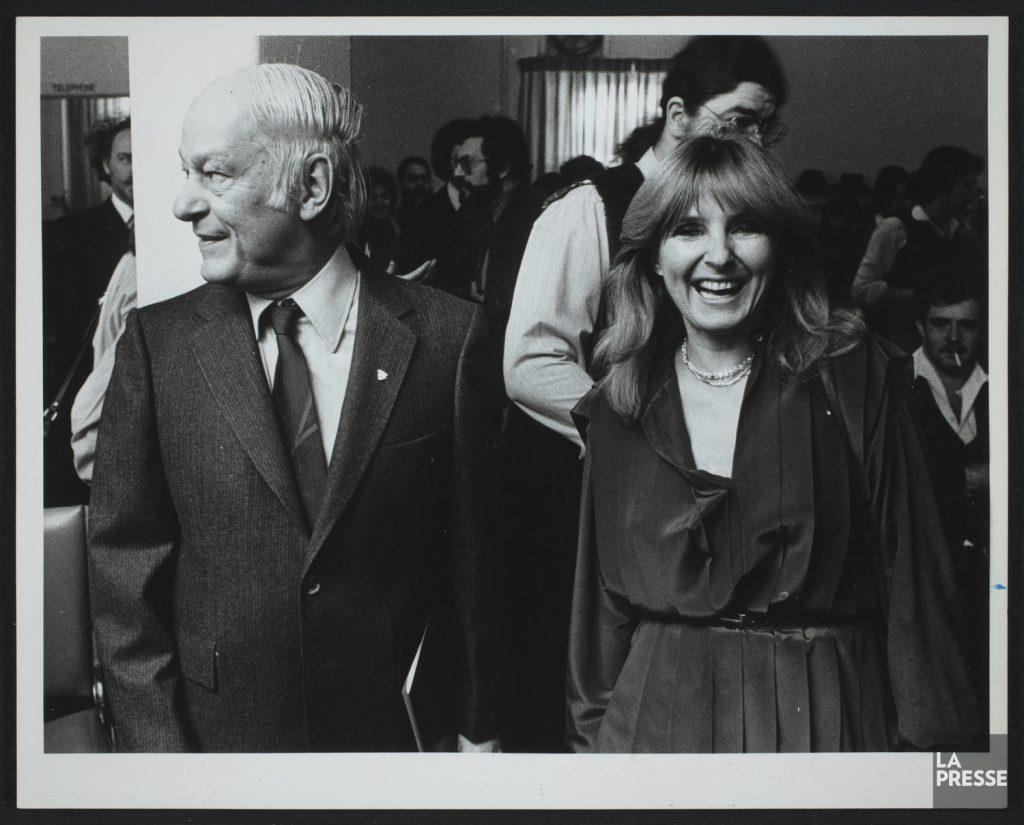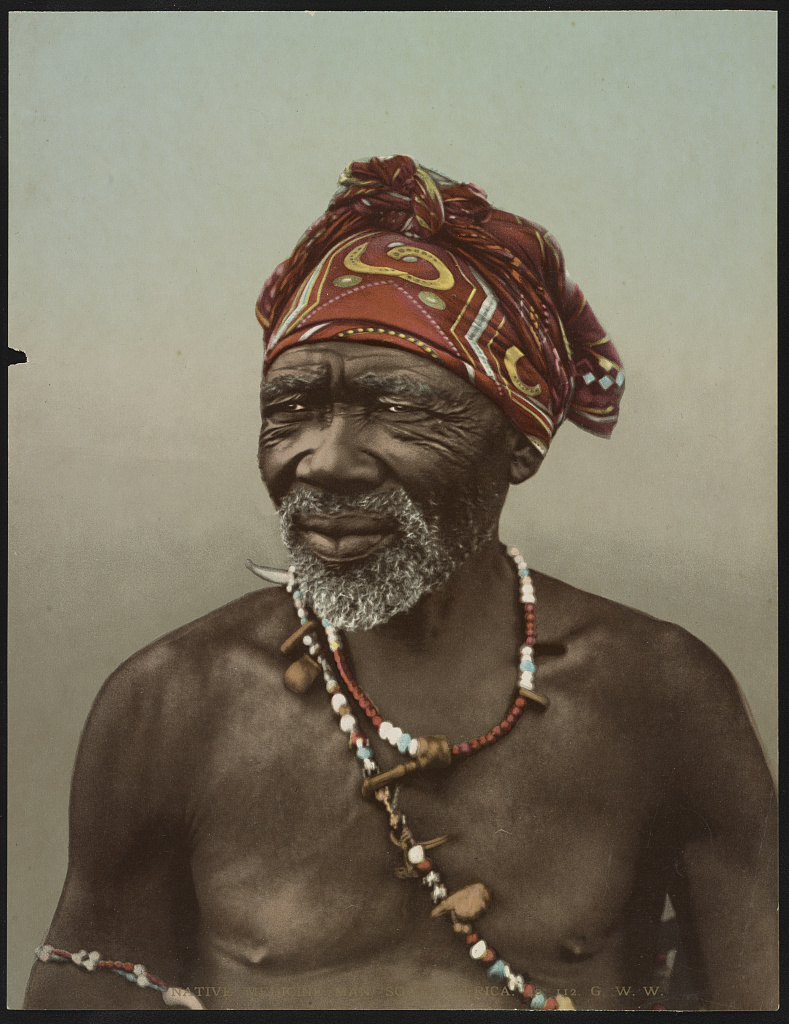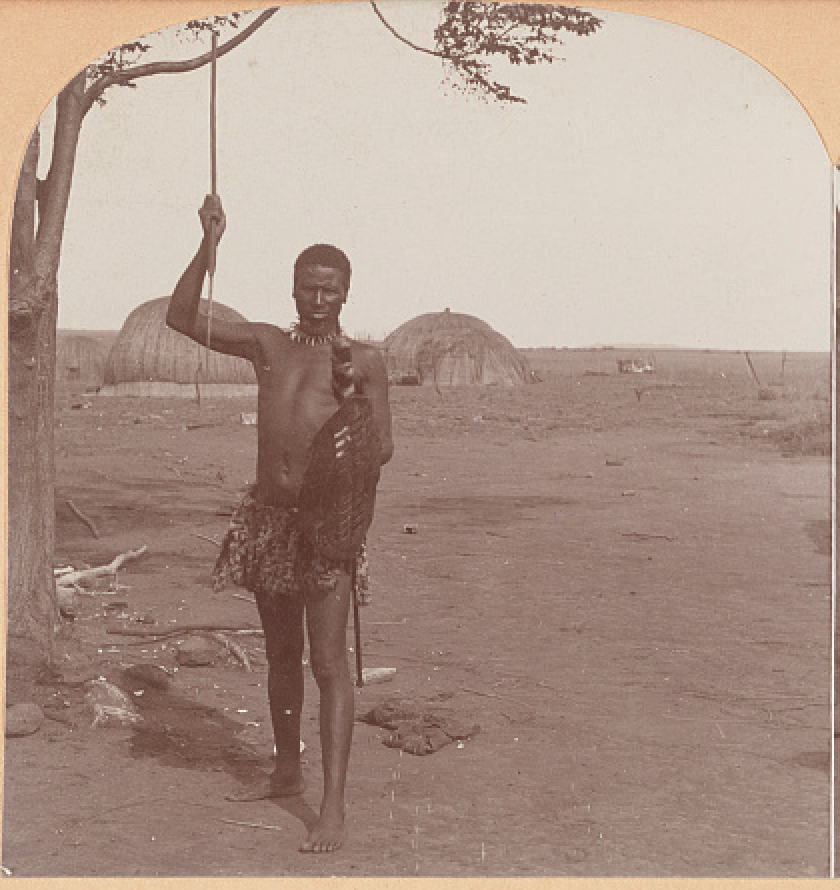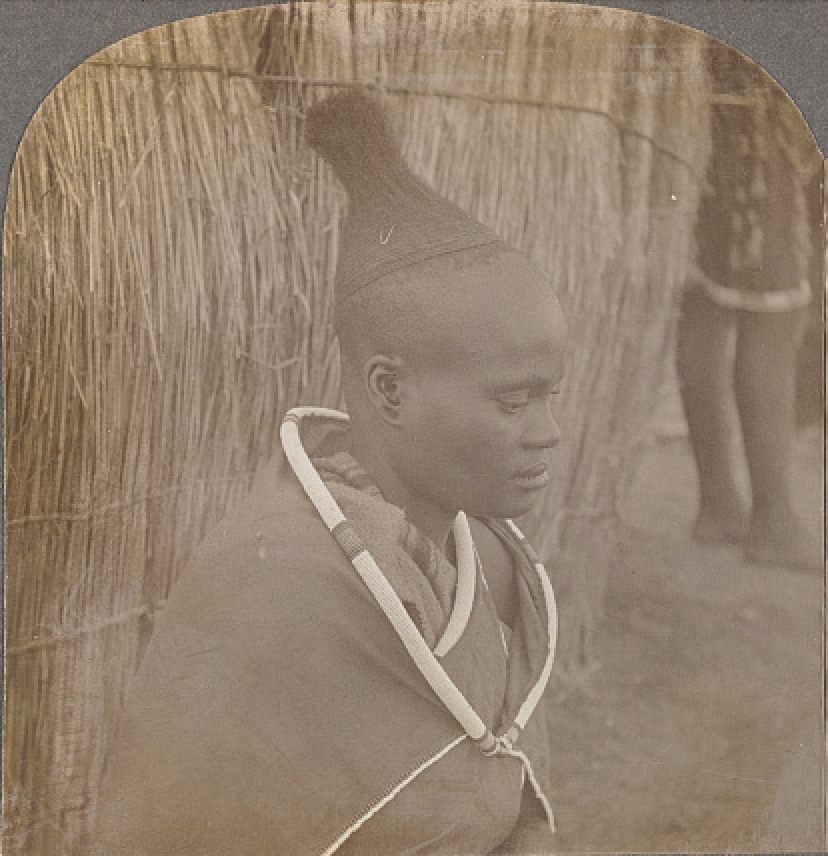Indissociable de l’histoire de Montréal, la Basilique Notre-Dame attire fidèles et visiteurs depuis sa construction, il y a 200 ans. Ses murs trahissent toutefois son âge. Des travaux sans précédent devraient lui redonner son lustre d’antan. Visite du chantier.
Pierres fissurées et infiltrations d’eau: la Basilique Notre-Dame de Montréal a grandement besoin d’une cure de jouvence. Les maçonneries, solins, clochers de même que d’autres éléments architecturaux devront être retapés. Il faut dire que cet emblème du Vieux-Montréal ne date pas d’hier. Sa construction remonte à deux siècles, soit entre 1824 et 1829. On doit son allure austère et néogothique à l’architecte James O’Donnell.

C’est par un mercredi frisquet que l’auteure de ces lignes a eu la chance de monter au sommet de la tour est, dite de la Tempérance. Les vents, pourtant cléments sur le parvis, prennent à cette hauteur de la vigueur puisqu’ils n’y rencontrent pas autant d’obstacles. De quoi donner un peu le tournis. La vue sur la métropole et le fleuve se révèle néanmoins impressionnante.

On constate l’avancée des travaux à 69 mètres d’altitude. Les pierres grises de près de 135 kilos, qui proviennent d’une ancienne carrière du Mile-End, sont enlevées une par une, numérotées puis descendues au sol. Elles sont ensuite réparées ou remplacées par de nouvelles, identiques, dénichées à la carrière de Saint-Marc-des-Carrières, dans la région de Québec. On les réinstallera à leur place par la suite.
«C’est un peu comme un immense casse-tête», illustre Pascal Létourneau, associé principal chez DFS.
Cœur de pierre
L’architecte pointe le centre de la tour en expliquant comment la construction s’effectuait quand on a bâti l’église. «Les murs étaient composés à l’époque d’une belle pierre taillée en surface, alors qu’à l’intérieur, on trouvait ce qu’on appelle des moellons, soit de la pierre grossière, des galets et du mortier. La qualité du cœur varie d’un édifice à l’autre. Ici, ça a été bien construit», assure-t-il.
Reste que le temps – sans compter les intempéries et les cycles de gel et de dégel – a fait son œuvre. L’eau s’est infiltrée un peu partout au cours des décennies et les solins (ces capots de métal qui empêchent la pluie de rentrer) datent quand même de 1940. «C’était devenu une passoire», ajoute l’architecte.

DFS ne vous dit peut-être rien, mais la firme d’architecture a elle aussi une longue histoire. Il s’agit de la plus ancienne en opération au Canada. Elle célèbre cette année ses 120 ans.
Le bureau a surtout fait sa marque au pays lorsqu’il portait le nom de Ross et Macdonald, au début du 20e siècle. Des clients comme les familles Ogilvy et Eaton, la compagnie ferroviaire du Grand Tronc et la Banque Royale lui ont confié des mandats. Plus récemment, les concepteurs ont participé à la restauration du Marché Bonsecours et du manège militaire Voltigeurs de Québec.
Un travail de moine, échelonné sur plusieurs années
Comme tout bâtiment d’âge vénérable, celui-ci a réservé des surprises à l’équipe de restauration. La détérioration des pierres calcaires était notamment plus avancée que ce à quoi les architectes s’attendaient. Certaines, trop effritées, ne survivent même pas au démontage.
Ces surprises ont fait grimper la facture de 30 à 50 millions de dollars. La Fabrique de la paroisse Notre-Dame assume presque en totalité ce montant.
Environ 2000 pierres ont dû être changées dans la tour ouest. «Ça représente à peu près le quart», croit Hugo Latrémouille, estimateur chez Maçonnerie Rainville et Frères. On peut d’ailleurs remarquer la démarcation entre les pierres neuves, plus pâles, et les anciennes. À noter que cette tour abrite un bourdon, une grosse cloche pesant environ 11 000 kilos.

Entre 2000 et 2500 pierres devront être remplacées dans la tour est, actuellement en chantier. Ce minutieux travail devrait se poursuivre au moins jusqu’en 2025. D’autres phases de travaux suivront, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Les préservateurs de notre patrimoine s’affairent dans l’ombre. Hugo Latrémouille souligne que, si le travail est bien fait, personne ne le remarquera dans 10 ans, comme si la Basilique n’avait pas été touchée. Ce métier d’artisan, d’une époque révolue, ne s’apprend plus à l’école. C’est sur le chantier que ces passionnés se font la main.