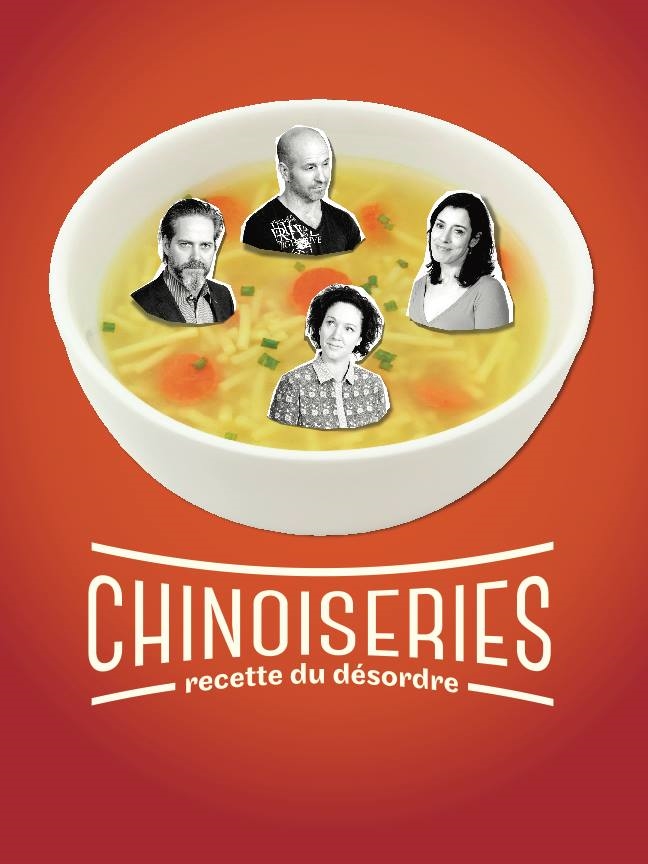Les cocus n’ont plus la cote cet été au théâtre
Fut un temps où maris et femmes cocus occupaient toute la place sur les scènes des théâtres d’été, avec en prime, des perruques grasses un peu croches, des portes qui claquaient, une spectatrice qui s’adressait directement aux comédiens pendant la pièce et un mononcle qui riait trop fort parce qu’il avait abusé du gros gin après la fondue chinoise offerte dans son forfait spectacle. C’était très souvent ainsi dans mes souvenirs de premières couvertures de théâtres en été, il y a de cela presque quinze ans, quand j’ai commencé en journalisme au Journal de Montréal. Comme les plus âgés et expérimentés étaient en vacances, c’étaient les petits jeunes qu’on envoyait à deux heures de chez eux pour assister à Ciel mon mari! ou à Winnebago en folie… C’était rarement spectaculaire comme résultat, mais puisque les gens qui y étaient, principalement des spectateurs de 65 ans et plus, se tapaient sur les cuisses, eux, moi, je modérais mes critiques un brin, consciente du clivage entre mes goûts de jeune et les leurs.
Or, qu’en est-il aujourd’hui de ces fameux théâtres en été au Québec, seul endroit au monde où on présente une saison spéciale de pièces de juin à septembre? Plusieurs observateurs avaient prédit leur fin – ou leurs grandes difficultés – il y a quelques années en voyant disparaître les précurseurs comme Claude Michaud ou Gilles Latulippe, leur fidèle public habitué au burlesque, ainsi que les autobus qui les transportaient.
Changement de standards
Si certains théâtres d’été traditionnels ont fermé leurs portes, d’autres se sont transformés et quelques granges et cabanes à sucre en sont finalement restées à leur vocation première. Selon les dires de Mario Provencher, président de l’Association des producteurs de théâtres privés et lui-même producteurs de spectacles, les plus forts, ceux qui offraient des infrastructures plus modernes, accueillantes et confortables, ceux qui ont osé aller chercher de nouveaux auteurs, metteurs en scène et qui ont proposé soudain autre chose aux spectateurs habituels, sont demeurés, eux, mais non sans repenser à leurs affaires; cherchant mille et une manières de garder les fidèles au rendez-vous, tout en accueillant les baby-boomers plus exigeants côté contenu qui ont envie de se divertir après des années de labeur, et leurs enfants, eux-mêmes devenus parents, les plus difficiles à faire sortir parce que trouver une «p’tite gardienne», la payer pas mal plus que 2$ de l’heure, se coucher tard quand on est debout aux aurores le lendemain, c’est loin d’être une sinécure, je sais de quoi je parle. Alors, le show, il est mieux d’être très très bon…
J’avoue que c’est un peu parce que j’avais peur d’être déçue et de rentrer trop tard après une pièce à l’extérieur de la ville, bredouille après m’être tapée le trafic de la réfection des autoroutes en soirée, que je remettais désormais toujours à plus tard mes rendez-vous avec le théâtre d’été. J’avais peur. Peur aussi que rien n’ait vraiment changé, que les buffets ou la fondue chinoise goûtent comme dans le temps, qu’on me serve les mêmes vieilles blagues que je jugeais jadis plates à travers la bouche de comédiens que je savais capables de tellement plus. J’avais peur de maudire le texte qu’on allait me servir et le public qui allait peut-être au passage me rappeler ma défunte grand-maman, et je n’avais pas envie de me mettre à pleurer, faute de pouvoir porter mon attention sur autre chose que les souvenirs cheezy du passé.
L’exigence de la mère de famille occupée
Parce que j’étais devenue hyper exigeante en voyant en saison régulière d’excellentes pièces comme 887 de Robert Lepage, des créations merveilleuses de jeunes compagnies déjantées, sans compter ma fréquentation des festivals de haut calibre situés à quelques stations de métro de chez moi, je me voyais mal m’extasier après une journée d’ouvrage à Beaumont St-Michel ou au Théâtre des Cascades. Sans parler de tous les spectacles de quartier gratuits pour la famille, comme la fameuse Roulotte, où je peux, en plus d’avoir ma gamine de 3 ans à mes côtés, sourire en la voyant, elle, s’amuser.
Pourtant, pourtant, à voir tous ces jeunes comédiens que j’adore se joindre aux plus anciens en été dans des pièces comme L’Emmerdeur, du même auteur que Le Dîner de cons, en sachant surtout que les producteurs de théâtres privés qui ne sont pas subventionnés doivent présenter des produits impeccables (textes costauds, fortes distributions avec vedettes) pour rivaliser avec l’offre abondante qui se distingue chez nous par les temps qui courent, ça me titille de plus en plus de retourner à ces anciennes amours, dont plusieurs se sont refait une beauté, me promet le producteur Mario Provencher, qui a toujours eu la volonté de penser et d’offrir grand, conscient des volontés du public actuel. OK. J’y retournerai. Ça me donnera l’impression d’être un peu en route vers des vacances improvisées en prenant la 15 ou la 40, fenêtres ouvertes et couettes au vent. En plus du show, la tarte au sucre du buffet est mieux d’être aussi bonne que dans mes souvenirs.
JE CRAQUE POUR…
La série policière Marcella
C’est depuis le 1er juillet que Netflix diffuse en exclusivité sur sa plateforme cette série britannique mettant en vedette Marcella, une enquêteuse à l’aube de la quarantaine du Metropolitan Police de Londres qui réintègre la section criminelle du Met après une dépression et la fin brutale et douloureuse de son couple. Avec Anna Friel dans le rôle titre, cette série écrite par le scénariste et romancier à la renommée internationale Hans Rosenfeldt (The Bridge) est bien ficelée, envoûtante au plus haut point, tissée de personnages qu’on soupçonne tous les uns après les autres d’avoir commis l’impensable. Les amoureux de séries policières me remercieront de leur avoir fait découvrir celle-ci.